Livres-Addict.fr
Livres
"Hemlock" de Gabrielle
Wittkop (Quidam éditeur)
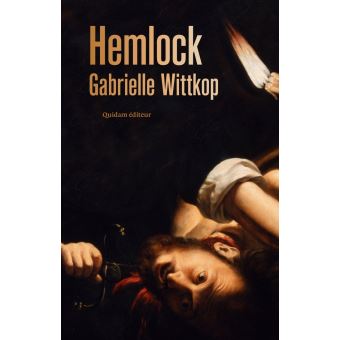 Voici
une lecture – et elles ne
sont pas si nombreuses – dont on sort modifié. On a affaire à un texte
qui vous
empoigne pour ne plus vous lâcher, qui vous infiltre (au sens presque
policier
du terme), qui vous retourne, vous met à sac et vous essore pour votre
plus
grand bonheur.
Voici
une lecture – et elles ne
sont pas si nombreuses – dont on sort modifié. On a affaire à un texte
qui vous
empoigne pour ne plus vous lâcher, qui vous infiltre (au sens presque
policier
du terme), qui vous retourne, vous met à sac et vous essore pour votre
plus
grand bonheur.
Le
récit, qui se déploie à
travers plusieurs époques, mais aussi sur plusieurs strates
signifiantes,
procède par poussées successives et fait affleurer de profondes couches
sédimentées. Il s’agit des destins juxtaposés, mais aussi subtilement
entrecroisés, de trois femmes, trois empoisonneuses livrées à leur
passion
vengeresse. Trois portraits grandioses se succèdent : Beatrice
Cenci, une
aristocrate, qui s’illustra violemment à la fin de la Renaissance,
Marie-Madeleine
Dreux d’Aubray, la marquise de Brinvilliers, française qui opéra durant
le
Grand Siècle, et Augusta Fulham, anglaise de l’époque édouardienne. A
chacune
de ces femmes, Gabrielle Wittkop offre un écrin somptueux qui est aussi
un
Tombeau. Les descriptions semblent presque relever de la narration
classique (et
ce, d’autant plus que la langue, flambante et d’une étourdissante
virtuosité,
nous confond par son élégance) mais elles sont infusées d’une angoisse
sourde
qui les décale imperceptiblement et fait du texte un prétexte pour
plonger dans
des abîmes et des vertiges inassignables. Entre les trois récits, un
subtil jeu
d’échos se met en place qui nous alerte sur le cœur battant du texte,
lequel
est moins la course inexorable vers la tragédie que la mise au jour
d’un
mystère qui relie obscurément les êtres. Les phrases sont chargées
d’une
puissance occulte et peut-être même que le propos majeur est la
substance
profondément vénéneuse de la langue dont Gabrielle Wittkop fait ses
délices –
et les nôtres.
Les
trois récits qui, entre eux
se répondent, sont entrecoupés d’une évocation, autre et hypnotique,
dans
laquelle ils sont enchâssés. C’est Hemlock (le poison éponyme du titre)
qui est
l’héroïne véritable du texte dont elle orchestre l’architecture. Cette
femme
contemporaine assiste à la déchéance de H. (atteint d’une maladie
dégénérative),
avec qui elle partage plus que l’initiale liminaire qui les désigne
tous deux.
H est, en effet, l’aimé, l’alter ego de Hemlock qui éprouve, face à sa
dégradation
progressive, des sentiments violemment ambivalents. Sentiments qu’elle
livre sans
peur, avec une grande crudité et une insolence crâne. L’amour
inconditionnel
que voue Hemlock à H. se mêle d’aversion profonde et cette matière
émotionnelle
trouble, cette tourbe au cœur de laquelle elle se débat, semble dicter
les récits
meurtriers qui se déploient en forme d’exutoire, de catharsis
gourmandement
féroce.
Le
texte est donc soutenu par une
structure magistrale qui multiplie les résonances, les dépôts secrets,
les
couches alluviales, mais ce qu’il convient avant tout de célébrer,
c’est la
langue, unique, mystifiante, et proprement stupéfiante (dans toutes les
acceptions de termes) que développe Gabrielle Wittkop et dans laquelle
elle
concocte ses brouets de sorcière. Car les phrases sont des bijoux et
leur
agencement des pièges orfévrés qui véritablement nous ensorcellent.
C’est ici,
au cœur de la langue même, que se loge le poison le plus subtil. Langue
fastueuse, aussi luxuriante que luxurieuse. Langue qui n’exclut aucun
registre,
aucune nuance, aucune tonalité puisque s’y niche, outre tous les
accents
théâtraux, pélagiques et même orphiques, un humour subtil et caustique.
Langue
totale, donc. On est embarqué dans une expérience médiumnique qui est
aussi une
chorégraphie baroque, un ballet de bacchantes aux modulations
shakespeariennes.
On est pris dans une transe quasiment érotique car les phrases sont
gorgées
d’une sombre sensualité qui éclate à chaque page, et Gabrielle Wittkop,
au
sommet de sa maestria, se délecte en menant sa filature aussi
jubilatoire qu’éblouissante.
La beauté baudelairienne des turpitudes nous saisit.
Un hymne jouissif aux ressources inépuisables de la langue. Un chef-d’œuvre.
BH 11/20
"Neiges intérieures" d'Anne-Sophie Subilia (Zoé)
 C'est
un texte si
pur, à ce point
ciselé, qu'il semble taillé à même la mer de glace que la narratrice va
longer.
C'est
un texte si
pur, à ce point
ciselé, qu'il semble taillé à même la mer de glace que la narratrice va
longer.
Jeune architecte, elle embarque, en effet, aux côtés de trois collègues (deux hommes et une femme) sur un voilier qui va frayer aux confins du cercle polaire.
Le but de l'expédition : élaborer une cité alpine après avoir pratiqué une immersion en milieu glaciaire.
Mais ce qui touche au dessein professionnel proprement dit occupe, in fine, assez, peu de place. L'objet du texte est d'ailleurs. Il s'agit, pour l'auteur, de saisir, avec un regard affûté, d'une précision redoutable, ce qui se joue dans ce huis-clos, entre les six personnages confinés, quarante jours durant, en milieu fermé. Car, aux quatre architectes susmentionnés s'adjoignent le capitaine du voilier et son second. Les notes prises épousent au plus près les sensations (vives) et les émotions (contenues). Le texte, lapidaire (comme saisi par le gel ou pétrifié de peur) restitue, outre les mouvements et événements marins, les inconforts et difficultés physiques (le froid, la faim, l'humidité, la fatigue, l'exigüité des lieux, les irritations générées par la promiscuité) ainsi que les heurts entre les personnalités présentes.
Lesdits personnages ne sont jamais désignés autrement que par des initiales comme s'il s'agissait, pour la narratrice, non pas tant de respecter leur intimité ou leur désir d'anonymat, mais plutôt de réduire leur épaisseur et le danger potentiel qu'ils représentent pour elle.
Au fil des notations laconiques, des profils se dessinent.
Il y a Z. le capitaine, passablement outrecuidant et dédaigneux, mais auquel la narratrice reconnait des compétences et une souveraineté incontestables. T., son second, apparait en revanche, comme un homme non seulement peu amène, mais aussi fourbe, retors, capable de manipulations et de flagorneries. Le moins que l'on puisse dire est qu'il n'emporte pas les suffrages de la narratrice. S. et N., les collègues architectes, suscitent en elle davantage de sympathie et même, par moments, de vagues mouvements de tendresse, bien qu'elle prenne soin de se tenir le plus possible à distance.
Quant à C. , la seule autre jeune femme du groupe, bien plus féminine, souple, délicate et séduisante que la narratrice elle-même, elle provoque alternativement des accès de jalousie, des salves colériques, des désirs mimétiques et des désirs de rapprochement (aussitôt refoulés).
Ce qui se dégage peu à peu, au fil des détails sèchement consignés, c'est un portrait en creux, chaotique, heurté, douloureux, de la narratrice elle-même.
L'expérience la plus cuisante qu'elle est amenée à faire, au cœur des paysages glacés, c'est celle de sa propre froideur, de ce noyau gelé qu'elle recèle et qui la rend inapte à frayer avec autrui.
Cette impuissance profonde à être et à aimer, l'écriture, cinglante, diamantine et comme perpétuellement sabrée, la traduit admirablement.
C'est
un texte
poignant, d'une
beauté râpeuse, abrasive, et d'une humanité bouleversante.
BH
02/20
"Conversation à la
Catedral" de Mario Vargas Llosa
(Gallimard)
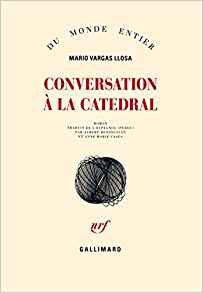 En apparence, il s'agit d'un
ouvrage intimidant, éventuellement fastidieux, puisqu'il brasse, au
milieu du
vingtième siècle, sur une dizaine d'années, les événements prégnants et
les mutations
sociales qui ont scandé l'histoire du Pérou.
En apparence, il s'agit d'un
ouvrage intimidant, éventuellement fastidieux, puisqu'il brasse, au
milieu du
vingtième siècle, sur une dizaine d'années, les événements prégnants et
les mutations
sociales qui ont scandé l'histoire du Pérou.
Pour autant, on ne trouve, dans ce roman rien de didactique. Il se présente d'abord comme une conversation à bâtons rompus entre le jeune Santiago Zavalta et l'ancien chauffeur de son père, Ambrosio.
Ce dialogue constitue la trame, le fil rouge de la narration.
Ce cadre étant posé, l'auteur s'empresse de le dynamiter en faisant surgir une multitude d'autres voix et en multipliant les strates temporelles, les personnages, principaux ou secondaires, les intrigues adjacentes.
Il s'agit de répondre à une question centrale : "A quel moment le Pérou a-t-il été foutu ?" Les fils narratifs se croisent et s'enchevêtrent, l'Histoire, celle du pays, se décompose en une foule d'incidents particuliers qui se suivent, s'entrelacent, se percutent, se répondent - ou non !
Ce texte, à l'image du Pérou en perdition, se désagrège pour mieux se ramifier autrement, déraille en tous sens, créant un tissage tentaculaire, des ruptures temporelles vertigineuses, et une confusion troublante entre les époques et les identités.
C'est, sur la corruption, la chute , la quête de rédemption et les rencontres manquées, un roman total, aux accents cubistes, au souffle si ample, à l'inventivité si folle, qu'il nous laisse suffoqués.
Et heureux infiniment.
BH 12/19
"Temps profond.
Essais de littérature
arrêtée" de
Denis Roche (Seuil)
 Voici que
, près de
cinq ans
après sa mort, nous parvient un texte de Denis Roche qui se distingue
par sa
force et frappe par sa singularité. Il s'agit de son journal qui couvre
les années
1977 à 1984.
Voici que
, près de
cinq ans
après sa mort, nous parvient un texte de Denis Roche qui se distingue
par sa
force et frappe par sa singularité. Il s'agit de son journal qui couvre
les années
1977 à 1984.
Denis Roche est alors célèbre à de multiples égards et célébré sous maintes formes (en tant que photographe d'avant-garde, écrivain expérimental, éditeur de premier plan...). Pour autant, il ne se repose sur aucun laurier mais poursuit inlassablement sa quête de dispositifs inédits, d'une langue de pointe, d'images authentiques, le tout au fil d'une pensée tranchante qui ne transige sur rien.
En témoignent ces pages de diariste qui, si elles recueillent faits et pensées au ras du quotidien, répondent toujours à une haute exigence de mise en forme et de vision réflexive. Jamais Denis Roche ne cède à la tentation du moindre effet. L'écriture est d'une austérité et d'une pureté parfaites. Rien de sec, pour autant : la pensée est nourrie, tout du long par un courant lyrique contenu.
Il est question des lectures et des relations de l'éditeur avec ses auteurs, bien sûr, mais aussi des rapports qu'il entretient avec des écrivains de haute stature (Bernard Noël, Duras, Ponge, etc ...), de son travail de photographe et, motif central autour duquel s'articule l'ensemble de l'œuvre : sa vie, amoureuse et sexuelle, avec sa femme et modèle, Françoise. Denis Roche approche cette part de sa vie (indissociable et indissociée de son œuvre) avec l'œil du photographe et ses notations sont aussi crues que parfaitement visuelles. Il consacre de nombreuses pages à rendre compte des gestes très concrets que les amants accomplissent en faisant l'amour. Il en ressort le sentiment très fort (souvent bouleversant) qu'on se trouve face à un couple d'exception : un homme et une femme soudés en esprit au-delà du pensable et qui continuent, au bout de 15 ans d'union, de développer une sexualité sauvage, gourmande, inventive.
Denis Roche a crée une œuvre étourdissante d'inventivité, parfaitement inédite mais on a le sentiment, en lisant ces pages, que cette prouesse a été rendue possible essentiellement parce qu'il a inventé avec Françoise une vie qui est, elle aussi, est sans équivalent.
Ce régime d'exception qui définit la vie des époux Roche justifie sans aucun doute la sévérité implacable avec laquelle il juge certains artistes, ceux qu'il estime trop "courts". Il stigmatise sans merci ceux qui, à ses yeux, entrent dans la catégorie des "petits esprits" (Roger Laporte, Henri Thomas, Philippe Jaccottet, Georges Perros, Roland Barthes) et qu'il déclare coupable de rétrécir et la vision et la vie.
Cet
homme est animé
d'une
aspiration si altière que seuls trouvent grâce à ses yeux les vrais
révolutionnaires, ceux qui bouleversent la matière intime (ainsi de
Marguerite
Duras et Alix Cléo Roubaud).
BH
12/19
"L'amour du loup et autres remords" de Hélène Cixous (Galilée)
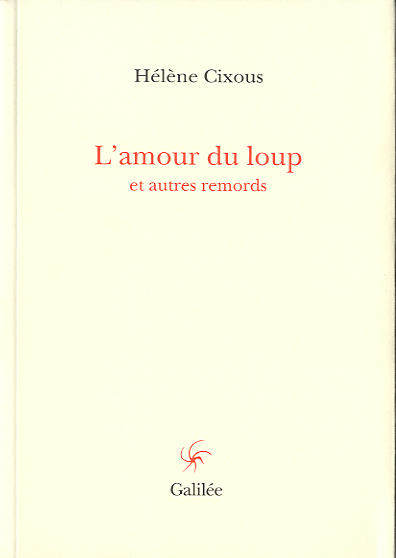 Face à un
tel livre,
qui déborde
de langues, qui déborde la langue, la tentation est grande de demeurer
coi.
Face à un
tel livre,
qui déborde
de langues, qui déborde la langue, la tentation est grande de demeurer
coi.
La stupéfaction le dispute à l'émerveillement au sortir de cet ouvrage qui est un précipité chimique innommable, une équation verbale sans équivalent.
Le loup est la figure principielle, archétypale qui file le long du recueil, mais il est rejoint et accru par d'autres animaux qui sont autant de prismes ou de prises possibles pour accrocher quelque chose des abîmes auxquels se collette incessamment Hélène Cixous.
Toujours, il s'agit de l'amour et des livres. De la férocité, véritablement animale, telle qu'elle se décline et se distribue à travers l'amour et la langue.
Les animaux présents dans le texte sont symboles, vecteurs de l'écriture, forces motrices. Ils figurent l'amour et sa rage mais ils sont aussi, littéralement, objets d'amour. Les animaux coexistent avec les aimés, les membres de la famille, notamment (mais pas seulement, la figure de l'amant est, elle aussi, sous forme humaine ou animale, prégnante), contre qui ils se percutent ou avec qui ils se confondent. On a droit à des échanges savoureux et vibrants, presque improbables de cocasserie mordante ou de tendresse vive, entre Hélène, son frère Pierre, et leur mère, déesse tutélaire et ordonnatrice de tous les récits.
Et, de nouveau, il faut en découdre avec les mythes et les autres textes fondateurs et, surtout, avec la langue telle que Cixous la remanie, la torture jusqu'à lui faire rendre gorge. Outre le loup, on croise par exemple l'âne qui nous guide de la cécité à la clairvoyance, voire à la voyance pure à quoi l'écriture véritable nous conduit. Il y a aussi, bien sûr, le petit chaperon rouge et son loup, aiguillon mordeur, principe de déchirement au cœur de l'amour et de l'écriture.
Chemin faisant, voici que surgissent des auteurs (Tsvetaïeva, Proust, Kafka, Thomas Bernhardt) et leurs textes incisifs retournés comme des peaux.
Ce qui est en jeu, in fine, dans ces textes protéiformes, polymorphes, à multiples entrées et aux prolongements vertigineux, c'est, ni plus ni moins, le processus de l'écriture elle-même, dont Hélène Cixous nous donne à voir, avec une générosité rare, les rouages, les strates sédimentaires, la dynamique créatrice, le principe organique et la nature, profondément ludique.
C'est une virevolte et une mise en abyme sans fin que nous convie l'écriture virale, sérologique, spéléologique, d'Hélène Cixous.
BH
11/19
"Le bikini de Caroline" de Kirsty Gunn (Christian Bourgois)
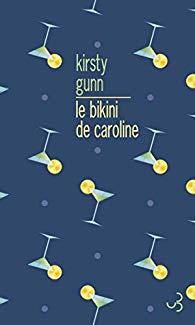 C'est
un texte à
faire tourner la
tête, une fantaisie littéraire en forme de facétie, une bascule sur
balançoire,
un tournoiement et piquetage mental qui, véritablement, donne le
tournis mais aussi
le sourire.
C'est
un texte à
faire tourner la
tête, une fantaisie littéraire en forme de facétie, une bascule sur
balançoire,
un tournoiement et piquetage mental qui, véritablement, donne le
tournis mais aussi
le sourire.
Dès l'abord, l'argument est étrange. On est face à deux amis d'enfance qui se retrouvent à l'issue de plusieurs années de séparation. Il s'agit d'Evan Gordonston lequel, après avoir vécu plusieurs années aux Etats-Unis, revient en Angleterre et reprend contact avec sa vieille amie Emily. Evan occupe un poste important dans la finance tandis qu'Emily, qui ambitionne de devenir écrivain, rédige, sans enthousiasme, des textes publicitaires aussi divers que triviaux.
Bien qu'il soit tout sauf nécessiteux, Evan décide d'emménager, en tant que locataire, dans la banlieue de Richmond. Et tombe éperdument amoureux de sa propriétaire ou logeuse Caroline Beresford, éblouissante jeune femme dotée d'un mari avantageux et de deux enfants.
L'objet du texte est le suivant : Evan sollicite Emily pour qu'elle écrive à sa place le roman de son amour pour Caroline. Dès lors, le récit se déploie au gré des rendez-vous successifs qu'Evan et Emily se fixent dans des bars pittoresques et improbables.
Evan, chaque fois, arrive riche d'une pleine brassée de feuillets : il s'agit de la documentation sur l'histoire d'amour en cours d'élaboration. Emily, quant à elle, est chargée de débroussailler, élaguer, reformuler cette prose emphatique et brouillonne afin que prenne forme le roman rêvé.
Car tout, en effet, est du ressort du rêvé, du fantasme presque pur, dans cette histoire. La vérité, c'est qu'il ne se passe presque rien entre Evan et Caroline, que rien de décisif ne se développe au fil du temps, mais c'est sur ce "presque rien" qu'Evan et Emily s'attardent et glosent pendant des centaines de pages.
La singularité du roman tient au fait que c'est Emily qui rapporte toute l'histoire. A la fois les propos fougueux et désordonnés d'Evan et sa propre perplexité, les tourments qui lui viennent face à cette tâche qui lui est dévolue : mettre en forme l'informulable. Outre le scénario statique de l'intrigue amoureuse qui se nourrit de moins que des miettes, Emily note scrupuleusement les signes extérieurs de l'évolution physique et psychique d'Evan (il maigrit, dépérit, se néglige) ainsi que la sienne propre : elle se soustrait de plus en plus aux demandes insistantes et rappels répétés de ses employeurs. Autrement dit, Evan et Emily s'enfoncent ensemble dans une spirale insensée qui les aspire entiers alors que la teneur et les ressorts de l'histoire qui les occupe sont des plus ténus. Simultanément, les sentiments, entre eux, bougent, connaissent une imperceptible révolution.
On se trouve face à une double mise en abyme, un vertige narratif étourdissant auquel s'ajoute un métatexte (toute une série de notes en bas de page prises par Emily et qui s'adressent au lecteur).
Enfin, le roman se clôt sur une cinquantaine de pages de notes, un paratexte, une partie herméneutique, qui développe des aspects à peine effleurés dans le récit.
Une
pétillante et
magistrale
acrobatie - intellectuelle et verbale. Une œuvre ébouriffante.
BH
11/19
"Bêtes
féroces, bêtes farouches" de
Karen Köhler
(Actes Sud)
 Neuf
nouvelles comme autant
d'astéroïdes, des météores littéraires. Une écriture comme on n'es
trouve pas.
Pas avec cette rapidité d'exécution, cette précision du trait, cette
économie
de moyens alliée à un sens aigu de la poésie celée dans les choses
triviales.
Neuf
nouvelles comme autant
d'astéroïdes, des météores littéraires. Une écriture comme on n'es
trouve pas.
Pas avec cette rapidité d'exécution, cette précision du trait, cette
économie
de moyens alliée à un sens aigu de la poésie celée dans les choses
triviales.
Tout va très vite, les dialogues, l'évolution des situations, les trouées vertigineuses dans le temps (ellipses qui percutent le lecteur) ou dans l'espace (tournée géographique panoptique). Les personnages sont aux prises avec ce qu'il est convenu d'appeler des malheurs ou des situations de crises ou, au minimum des écueils : maladie grave, rupture ou réconciliation amoureuse ou suspension d'une relation capitale, deuil, dénuement, tentatives éperdues pour se tailler une place dans le monde...
La réponse apportée par l'auteur à ces constats originels peu encourageants est toujours d'une originalité confondante. Elle privilégie les détails très concrets et tangibles, les notations intimes à la fois infimes et familières, si bien que le lecteur a presque le sentiment qu'on lui chuchote à l'oreille, il a presque le sentiment que cette voix qui lui parle est la sienne propre.
Les formes déclinées successivement ne sont pas moins frappantes et inattendues. Les supports choisis sont des fragments de lettres ou des cartes postales, des dialogues à l'arraché, des énumérations lacunaires et cependant hypnotiques et qui procurent une sensation d'exhaustivité. L'émotion surgit toujours au détour d'un détail saillant.
C'est un premier recueil et c'est un tour de force devant lequel il convient de s'incliner.
(BH 09/19)
"Le bleu du ciel est déjà en eux" de Stéphane Padovani (Quidam éditeur)
 Ce sont des
textes
délicatement
soufflés, comme secrètement gonflés à l'hélium et qui, tout de suite,
s'élèvent
au-dessus de la ligne de flottaison.
Ce sont des
textes
délicatement
soufflés, comme secrètement gonflés à l'hélium et qui, tout de suite,
s'élèvent
au-dessus de la ligne de flottaison.
Un léger déraillement est inscrit, dès l'origine, dès la mise en bouche, dans ces partitions mélodieuses, raffinées, empreintes d'une douce et discrète sensualité. Mais l'exécution est si fluide et subtile, qu'on se laisse déporter sans broncher dans ces territoires qui affleurent à la pointe, très finement dessinée, du réel familier.
C'est la langue, surtout, magnifiquement imagée, infiniment poétique et déroulée en veloutes langoureuses, qui opère le décrochement et nous entraîne sur des pistes jamais foulées. Ces brefs récits sont écrits sur le fil de notes aussi cristallines qu'inusitées, des notes qui distillent un charme trouble, troublant comme un nectar. Une sorcellerie arachnéenne, un envoûtement diaphane auquel on ne peut s'arracher. Les personnages de ces nouvelles sont meurtris, étiolés par les épreuves mais ce qui, en eux, s'est effrité a créé une transparence et une perméabilité nouvelles. Les frontières en eux se dissolvent et ils entrent, sans transition, en contact avec l'invisible.
Ce sont des hommes et des femmes déplacés, essentiellement, décrochés, poreux, vivant dans une profonde inadéquation. Ou dotés d'antennes aptes à capter ce qui vibre, juste à côté ou un peu au-dessus ou en contrebas, et que le commun ne perçoit pas.
Il y a un traducteur frappé d'opprobre et de damnation parce qu'il a pris le parti de joindre deux langues réputées inconciliables. Une enseignante lasse qui retrouve dans un vagabond crasseux le corps intact de son frère défunt. Une jeune femme, Juliette, chargée par sa propriétaire, l'exigeante et péremptoire Katryn, d'établir un dialogue avec le fantôme de Matti, fils de ladite Katryn qui hante l'appartement mais choisit soigneusement ses interlocuteurs ainsi que les modalités de ses apparitions. Ou un homme, chauffeur de taxi et féru de cinéma jusqu'à l'absurde (que son nom, par trop mimétique, surligne), qui se réverbère en son frère jusque dans le pire. Ou encore une jeune femme qui parvient peu à peu à desceller Nathan, gardien de musée réduit, par un amour trépassé, à l'état de statue de sel. Jusqu'au jour où Nathan lui-même, rappelé par d'invisibles impératifs, se dissout à son tour.
Tous ces protagonistes le sont à peine, ils vivent dans un monde décalqué, une réalité à la géométrie déformable, en proie au basculement constant.
Ce sont des textes ciselés dans l'étoffe des rêves et cependant ancrés dans une réalité tranchante. On est à l'orée du fantastique mais la vie immédiate tenaille et cisaille.
L'écriture, vaporeuse et orfévrée, est d'une élégance rare et d'une beauté foudroyante. Ces pans de vie évoqués sont poignants et l'auteur porte sur ses personnages, chahutés et vulnérables, un regard empli d'une profonde tendresse.
BH
12/18
"Les hémisphères" de Mario Cuenca Sandoval (Seuil)
 C'est
un
texte conçu
comme le
creuset des métamorphoses. Un brassage incessant de formes, visions et
sensations exacerbées. C'est
une
navigation, minutieuse et hallucinée, entre les figures, les époques,
les
émotions et perceptions mêlées et contraires.
C'est
un
texte conçu
comme le
creuset des métamorphoses. Un brassage incessant de formes, visions et
sensations exacerbées. C'est
une
navigation, minutieuse et hallucinée, entre les figures, les époques,
les
émotions et perceptions mêlées et contraires.
C'est une quête, trépidante, frénétique, sauvage, éperdue, menée par des esprits secoués et désaxés. C'est un texte sous l'empire d'un corps de femme qui conditionne des vies, façonne des destins, déporte, transforme et modèle des corps jusqu'à la difformité, la tératologie.
Ce sont des vies cabossées, pulvérisées à cause d'un accident inaugural et d'une figure féminine élevée instantanément au rang de femme fatale. Soit deux jeunes hommes, Hubert et Gabriel, unis par une étroite amitié, qui, à l'issue d'un été orgiaque vécu à Ibiza, se retrouvent, lancés à plein régime et en état d'ébriété, sur une route nocturne. Leur véhicule, hélas, percute de plein fouet un corps. Qui meurt. Il se trouve que ce corps mort est celui d'une jeune femme qui a pour caractéristiques d'être sublime, dotée de jambes interminables et dépourvue de nombril. Cet événement infléchira les destins au-delà même des existences terrestres des deux jeunes hommes et de leur formes visibles.
Trente ans plus tard, Hubert, devenu documentariste de renom, charge Gabriel, écrivain en déshérence, de s'occuper de Carmen, sa très jeune femme, toxicomane en proie à des pulsions automutilatrices. Carmen qui, sans répit, marque et tatoue son corps. Gabriel, médusé, découvre en Carmen la réplique de la morte dont l'image continue de régner sur sa vie comme, manifestement, sur celle d'Hubert. Carmen investit alors à plein temps la vie de Gabriel, lequel s'éprend inconsidérément de ce double détraqué de "la première femme". Mais la situation évolue tragiquement Gabriel se retrouve dénué de femme fétiche à célébrer. Qu'à cela ne tienne, il ne tarde pas à découvrir un nouvel avatar de son fantasme en la personne d'une dénommée Meriem, jeune maghrébine croisée fortuitement dans une parc. Meriem est comme la version lissée, édulcorée et asthénique de Carmen et Gabriel peine à la faire fulgurer comme il le souhaiterait et à s'électriser pleinement à son contact. Mais elle aussi, trop vite, se volatilise.
Dans une troisième partie, comme née d'une transe hallucinatoire, les personnages devenus, cette fois, les avatars quasi méconnaissables d'eux-mêmes, évoluent dans un décor apocalyptique sous un régime cauchemardesque. C'est une dystopie brutale et raffinée.
C'est un texte virtuose, foisonnant, bourgeonnant, érudit, truffé de références livresques et cinématographiques. C'est un texte travaillé par de multiples mises en abyme, placé sous la haute garde et le signe de Borges, Hitchcock, Barthes et d'autres dont les influences conjuguées se distillent au fil des pages. C'est surtout, en soi, un texte cinétique et cynégétique d'une étourdissante inventivité, qui ne cesse de remanier sa propre forme tout en s'essayant à des genres divers et apparemment contradictoires (du thriller à la fantasmagorie fantastique en passant par la tragédie amoureuse classique).
Un récit hypnotique qui agit comme une substance entêtante et addictive.
BH 11/18
"Les petites mains" de Andres Barba (Christian Bourgois)
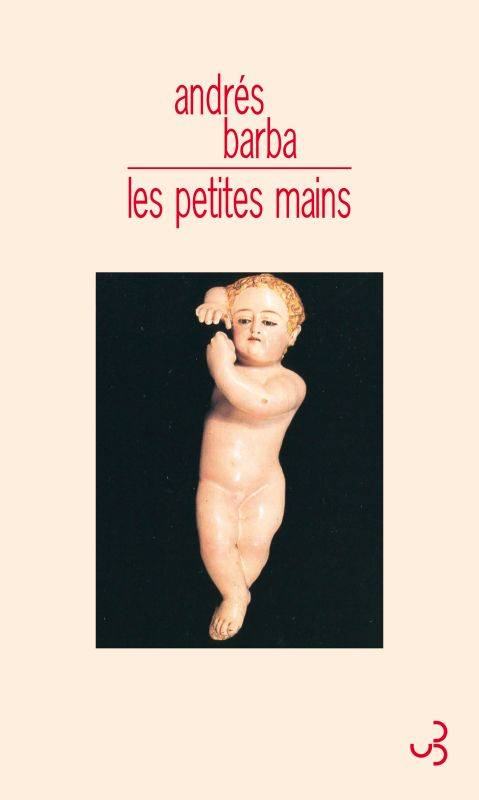 C'est
un texte
parachuté, chu du
ciel, mais sans être annoncé ou amorti, précisément, par aucun
parachute. C'est
un entrelacs et une succession de sensations aiguës, un tissage
minutieux,
point par point, d'un monde dévié, dérivant, mais qui est aussi d'une
précision
presque douloureuse, d'un réalisme saisissant.
C'est
un texte
parachuté, chu du
ciel, mais sans être annoncé ou amorti, précisément, par aucun
parachute. C'est
un entrelacs et une succession de sensations aiguës, un tissage
minutieux,
point par point, d'un monde dévié, dérivant, mais qui est aussi d'une
précision
presque douloureuse, d'un réalisme saisissant.
L'étrangeté est totale mais elle n'est en rien vaporeuse ou nébuleuse : au contraire, chaque instant, chaque détail sont d'une présence frappante.
Soit Marina, sept ans, qui perd accidentellement ses deux parents. Dès le départ, elle accueille l'événement sans l'absorber. Elle en fait une phrase abstraite , mécanique, métallique, qu'elle répète et décompose sans fin, jusqu'au vertige, à l'évaporation du sens. De même qu'elle place ainsi le drame à distance, elle transfère sa propre personne sur une poupée qu'elle baptise de son propre prénom : Marina.
Elle est bientôt placée dans un orphelinat où elle fait office de catalyseur et de détonateur. Sa présence, singulière et charismatique, cristallise les désirs, les envies, les hantises des autres filles. Elle introduit l'altérité au sein de la communauté. A son contact, les fillettes se découvrent distinctes, différentes, désirantes.
Marina devient l'objet de leur vénération et de leurs subtiles persécutions. Idole encensée et malmenée. La situation, relativement classique, prend une épaisseur et une dimension supplémentaires lorsque l'autre Marina, la symbolique, l'objectale, entre en jeu. Des rituels fascinants, dangereux, retors, se développent autour de la Marina spéculaire, mise en abyme.
Au travers de ce dispositif raffiné, c'est toute la dramaturgie du désir naissant, explosif, qui est explorée avec une rare maestria.
Et la langue, insinuante, suggestive, mais aussi racée, perçante, rend compte, avec une redoutable inventivité, de cette corrida miniature.
Un récit hanté porté par une prose sorcière.
BH
05/17
"Carnet d'une allumeuse" de Lydie Dattas (Gallimard)
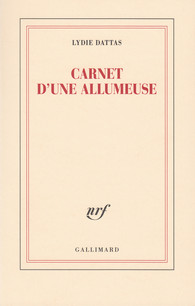 C'est
un petit précis
de lutte
incantatoire, le chant, non d'une sirène, mais d'une louve, d'une
incandescente
croisée de l'Absolu.
C'est
un petit précis
de lutte
incantatoire, le chant, non d'une sirène, mais d'une louve, d'une
incandescente
croisée de l'Absolu.
C'est un texte inclassable, proféré avec véhémence, à la croisée du pamphlet, du poème lyrique, du monologue théâtral.
Lydie Dattas arpente des territoires minés, fouille des zones névralgiques. En brossant un autoportrait incendiaire, elle s'attaque à la question brûlante du droit de penser accordé aux femmes. Elle s'insurge contre les poncifs et la tradition millénaire qui dénient aux femmes la faculté de voir, comprendre, savoir à hauteur métaphysique, autrement dit à hauteur d'homme.
Dans le même temps, elle pointe les pouvoirs occultes des femmes qui sont naturellement, essentiellement, sorcières, voyantes, et en prise directe avec les puissances primitives qui régissent le monde et gouvernent toute vie.
Le portrait de l'auteur en génie précoce (Lydie Dattas se dit affligée d'une intelligence dont l'ampleur l'écrase mais qui dispense, par un effet de vases communicants, les autres femmes de penser!) doublé d'une beauté foudroyante (et d'un pouvoir de séduction irrésistible) est un tantinet complaisant mais l'ensemble est un chant furieux, achilléen, qui s'élabore au fil d'une langue somptueuse, luxuriante: un velours sombre et sensuel, parfois comminatoire, qui envoûte.
Cela dit, les accents imprécatoires, s'ils impressionnent par leur force de percussion, peuvent aussi laisser perplexe. En effet, ils fusent au gré d'un discours dont les articulations sont parfois confuses.
On discerne mal la visée réelle de ce texte. Lydie Dattas souligne le pouvoir redoutable des beautés adolescentes, des nymphettes touchées par la grâce et la beauté du diable. Créatures fatales dont elle fut, de longues années durant. Simultanément, elle se dit frappée par un mal incommensurable : elle est capable de penser comme un homme, avec la même puissance, la même acuité, et ceci s'égale, selon elle, à une malédiction. Et si les autres femmes ont reçu le don de prescience, de divination qui fait défaut aux hommes, en revanche, elles sont dépourvues de l'intelligence spéculative, qu'elle seule, divine Lydie, a reçue en partage... Autrement dit, elle crédite, tout au long du texte, la thèse qu'elle entend prétendument dénoncer.
Une parole étrange, on ne peut plus singulière, qui mérite qu'on lui prête attention.
BH
04/18
"Le labyrinthe d'une vie" de Adam Foulds (Piranha)
 C'est
un récit qui
semble une
coulée lente, presque somnolente, et qui avance, trompeur, sous des
allures
classiques et les atours d'un style gourmé. Mais c'est en vérité un
sauvage
animal qui cavale à un rythme endiablé.
C'est
un récit qui
semble une
coulée lente, presque somnolente, et qui avance, trompeur, sous des
allures
classiques et les atours d'un style gourmé. Mais c'est en vérité un
sauvage
animal qui cavale à un rythme endiablé.
C'est un roman mais le texte a un caractère théâtral par sa densité, sa précision, sa force de percussion. Il y a unité de lieu : tout se déploie dans ou autour d'un asile psychiatrique où couvent, éclosent, se cristallisent de singulières passions.
Des personnages hauts en couleurs gravitent autour d'un centre névralgique absent ou pluriel et changeant.
On est en 1840 et on assiste aux expériences avant-gardistes menées par le docteur Allen, aliéniste intrépide et inventeur fantasque, qui entend effacer les frontières stigmatisantes entre fous et personnes saines d'esprit ou prétendues telles. Il est secondé par son épouse qui distribue son enjouement, son charme et ses éclats de rire avec une grâce égale. Il est père de trois filles, dont la seconde, Hannah, véhémente, passionnée, va s'éprendre du poète Alfred Tennyson, lequel s'est installé à deux pas de l'établissement psychiatrique.
Le docteur Allen a sous sa garde un autre poète, John Clare, qui souffre du peu de retentissement de son œuvre, qui fugue pour mener de grandes battues lyriques au cœur de la nature avec laquelle il communie de façon quasi surnaturelle. Il est également convaincu d'avoir deux épouses : la réelle, la légitime et Patty, son amour d'enfance avec qui il dialogue sans frein.
L'auteur nous donne à voir d'autres égarés, d'autres grands illuminés, en particulier la saisissante Margaret qui flagelle et affame son corps pour que, purifiée, elle puisse recevoir le Sauveur qui l'a élue.
L'intérêt du roman réside dans le regard que pose Adam Foulds sur ses personnages aux prises avec leurs tourments respectifs. Il les traite tous sur un pied d'égalité et pénètre avec la même maestria, et le même naturel, les embardées des forcenés, les interrogations et aspirations du docteur Allen, les émois furieux et rougissants d'Hannah...
La folie n'est pas banalisée pas plus qu'elle n'est magnifiée, elle devient simplement humaine et vivante.
BH
03/18
"Rien à voir avec l'amour" de Claire Gallen (Rouergue)
 Il y a
la mer, un
rade miteux,
une boite de nuit huileuse, une pincée de crapoteux, une mesure de
frauduleux,
une once de crapuleux. Une femme, Sandra, qui officie là-bas depuis
trop
longtemps et semble avoir oublié ce qui motive cette persistance. Il y
a
Samuel, le patron, le tenancier des lieux, présence massive et lasse
mais lame
dans le regard : redoutable alliage. Il y a l'été revenu et avec lui,
Rodolphe
qui fut, vingt ans auparavant, le mari de Sandra, le meilleur ami de
Samuel.
Il y a
la mer, un
rade miteux,
une boite de nuit huileuse, une pincée de crapoteux, une mesure de
frauduleux,
une once de crapuleux. Une femme, Sandra, qui officie là-bas depuis
trop
longtemps et semble avoir oublié ce qui motive cette persistance. Il y
a
Samuel, le patron, le tenancier des lieux, présence massive et lasse
mais lame
dans le regard : redoutable alliage. Il y a l'été revenu et avec lui,
Rodolphe
qui fut, vingt ans auparavant, le mari de Sandra, le meilleur ami de
Samuel.
Tout croupissait et macérait sous le soleil et la présence de Rodolphe, détonateur impromptu, va mettre le feu aux poudres enfouies.
On découvre un triangle, non seulement bancal, mais vénéneux, toxique dans toutes ses pointes. Il est question d'une enfant morte, d'une perte incompensable et, sous des dehors crasseux et glauques, d'un amour fatal.
C'est un peu la tragédie grecque qui s'invite dans les bas-fonds et touche des corps fanés, des âmes abîmées.
Et il y a la langue de Claire Gallen, sensuelle et acérée, qui excelle à saisir les failles et saillies des personnages cabossés. L'écriture épouse les pulsations des peaux, les saccades et syncopes du désir. Chaque phrase claque, chaque phrase cogne, chaque phrase est gorgée de sève, de suc. Et englue.
Le poison est inoculé, mot après mot, avec une précision chirurgicale.
Un envoûtement féroce dont on ne cherche pas à se défaire.
BH
02/18
"Imagine que je sois parti" de Adam Haslett (Gallimard)
 C'est un
texte qui
désoriente et
ne cesse de surprendre avec éclat tout en dessinant la cartographie
minutieuse
d'une poignante déroute.
C'est un
texte qui
désoriente et
ne cesse de surprendre avec éclat tout en dessinant la cartographie
minutieuse
d'une poignante déroute.
C'est l'histoire d'une famille étreinte par un mal funeste et dont les membres, diversement touchés, s'efforcent de faire front.
C'est une constellation familiale soudée par un risque d'éclatement, un risque atomique et constant.
Le récit s'étend sur une trentaine d'années et nous donne à voir, non seulement l'évolution des membres d'une famille, d'une fratrie, mais aussi les différents visages d'un mal chronique pareil à un monstre tentaculaire.
La première période couvre les jeunes années des enfants et décrit la lente dérive du père, John, aux prises avec une dépression gravissime qui culmine dans un suicide.
La suite répercute, au fil des années, en ondes de choc successives, les conséquences de cet acte sur la femme de John, Margaret, et leurs trois enfants, Michael, Celia et Alec. Margaret est forte, solide mais incertaine quant à l'attitude à adopter. Celia est résolue, athlétiquement forgée, presque anormalement volontaire et endurante mais secrètement écorchée. Alec est un homosexuel brillant, accrocheur, enclin à se donner en spectacle, déterminé à réussir sa vie. Reste Michael qui recèle le triste héritage paternel et se bat valeureusement contre "le monstre".
Les protagonistes s'expriment tour à tour, mettant en lumière combien ils sont ensemble et pourtant séparés, par l'incommunicable, l'intransmissible. Ils s'épaulent et tâchent d'arracher Michael à son marasme mais, c'est patent, chacun étant aux prises avec ses propres affres, voit son pouvoir d'action et d'expansion singulièrement réduit.
L'écriture percutante d'Adam Haslett restitue les étapes du drame avec une précision et une acuité poignantes.
Une approche inédite, d'une justesse et d'une humanité bouleversante.
BH
02/18
"Le passé" de Tessa Hadley (Christian Bourgois)
 C'est un texte
d'allure enlevée,
de facture délicate et qui recèle quantité de trésors.
C'est un texte
d'allure enlevée,
de facture délicate et qui recèle quantité de trésors.
C'est un entrelacement subtil entre des destins et des époques. Un feuilletage orfévré. Un récit aux accents presque victoriens et surannés par moments mais qui est aussi résolument moderne et pétille, un peu à la manière des films de Sofia Coppola, d'esquilles et d'éclairs pop. A cette différence près que le caractère vaporeux se double, ici, d'une investigation fouillée et d'une étude de moeurs d'une redoutable précision.
La trame est usée : les retrouvailles d'une fratrie vieillissante dans la maison de famille dont on se demande s'il faut la vendre ou non. Mais cet argument est le prétexte à des descriptions qui sont une fête de l'esprit et une jouissance sensorielle de chaque instant.
Quatre générations se heurtent, se percutent (car les ancêtres sont constamment présents sous forme d'évocations verbales ou de réapparitions directes) et on assiste à un ballet virtuose entre les âges et les personnages. Sans oublier la nature qui est un personnage à part entière et qui est célébrée avec un lyrisme aigu.
Il y a trois sœurs, très différentes et pourtant manifestement tissées des mêmes fibres, un unique frère, intellectuel détaché qui fait irruption flanqué de sa nouvelle et spectaculaire épouse. Il y a deux enfants gracieux, curieux, espiègles, qui s'adonnent à des jeux ingénus et féroces et débusquent des vérités interdites. Il y a deux adolescents, beaux, arrogants, ignorants et innocents, qui découvrent ensemble les voluptés de l'amour naissant.
Il y a Alice, la romanesque, l'actrice ratée qui chevauche des chimères, amoureuses et familiales. Il y a Harriet l'austère, la militante rigide, soudain foudroyée par un amour tardif et on ne peut plus insolite. Il y a Pilar, la seconde épouse, flamboyante splendeur qui anime, électrise et bouscule cette configuration un peu gelée dans ses aises et ses habitudes.
Et, bien sûr, un saisissant secret de famille est levé à l'issue d'une minutieuse plongée dans le passé.
Des fragments de comédie humaine saisis à la pointe sèche, prélevés avec un art consommé et fixés par le plus fin des regards.
Un régal.
BH
02/18
"L'Alphabet plutôt que rien" (poèmes) de Constance Chlore (Eoliennes)
 Les
poèmes de Constance
Chlore
sont des prières païennes, des chants de haute lutte, des chants
épiques dans
la mesure où ils se font l'écho d'un combat acharné pour élargir le
champ de la
perception, pour mettre en lumière les acuités et souligner les éclats.
Les
poèmes de Constance
Chlore
sont des prières païennes, des chants de haute lutte, des chants
épiques dans
la mesure où ils se font l'écho d'un combat acharné pour élargir le
champ de la
perception, pour mettre en lumière les acuités et souligner les éclats.
Constance Chlore dit la vie, sa pulpe, son tranchant, ses entailles et ses entrailles. Elle dit l'amour, son passage, ses empreintes éblouies, saignantes, meurtries.
Ce sont des incantations, des soulèvements, des brûlures, des insurrections de peaux, de langues, de pas. Ce sont des transes, telluriques ou inversées. C'est la vie, rendue à la pureté des sens, du sang, des sèves impératives.
La typographie, qui peut sembler arbitraire ou anarchique, répond à un ordre précis, de nature organique. De même pour les caractères, qui sont de tailles variable.
C'est une poésie qui n'a pas peur du vide, des coupes, des hésitations et vacillements. Et, s'il est beaucoup question d'assomptions charnelles, il y a aussi des percées et élévations purement verbales.
"Etreinte première, étreinte dernièreLe chant promet:
L'or à l'intérieur du corps
Par l'oreille acquérir une profondeur
Danse tressée dans l'ombre
Passer de l'autre côté. De quoi ?
Trop de jour, et déjà tombe
Cette eau que tu franchis
Dans la crainte et la vénération
Salive et mer en bouche
Tu embrasses et n'atteins plus
Déjà tu te quittes
Déjà tu habites la brûlure
Dans l'engloutissement où tu couches ton désir
Ton nom sera trop sombre pour le dire
Fais ce qui augmente la vie."
Une poésie de saisissement, exigeante, intrépide, en quête inlassable de l'élémentaire et du primordial.
BH 11/17
"Pour tout l'or du monde" de David Huddle (L'Olivier)
 C'est
un
roman qui, d'abord, agit
comme une coupe de champagne. Les phrases pétillent, éclatent en bulles
légères, translucides et distillent une légère euphorie.
C'est
un
roman qui, d'abord, agit
comme une coupe de champagne. Les phrases pétillent, éclatent en bulles
légères, translucides et distillent une légère euphorie.
On croit d'abord avoir affaire à un quintette vaudevillesque, une ronde ou farandole dans laquelle le désir circule entre cinq personnes, cinq narrateurs, successifs et alternatifs.
Il y a d'abord Robert, séduisant quadragénaire marié qui, au début du récit, entame une liaison avec Marcy, ravissante adolescente et fille d'un couple d'amis. Marcy, non contente, d'être une athlète accomplie et une beauté remarquable, dégage une intensité rare qui modifie l'atmosphère autour d'elle. Elle se laisse aimer quelques temps par Robert jusqu'à ce qu'elle rencontre Allen, jeune garçon tapageur et arrogant qui la séduit. La romance adolescente se muera en vie conjugale au grand dam de Jimmy, ami des tourtereaux, satellisé par le tyrannique Allen et secrètement amoureux de Marcy. D'abord animé par un mouvement de dépit, Jimmy épousera Uta, l'énigmatique, opaque et plutôt fascinante amie de cœur de Marcy. Or, ce mariage hasardeux tournera à l'amour profond et partagé. Mais, les deux couples étant proches, Allen ne pourra se défendre, au fil du temps, de l'attirance puissante qu'il éprouve pour Uta... Cependant que Robert, de son côté, ne se remettra jamais de l'abandon de Marcy.
Les protagonistes se livrent à tour de rôle à une introspection lucide, à la faveur d'un épisode critique ou significatif, et l'on voit ainsi le désir et l'amour se déployer dans des configurations diverses, inattendues, dangereuses.
L'intérêt du récit réside dans le pouvoir de contamination que l'auteur rend sensible. Chaque narration pointe à quel point les destins sont liés, à quel point les actes, pensées et intentions des uns se répercutent sur les autres, et souvent sous la forme d'ondes de choc.
Plus le récit s'enrichit, plus cet argent viral est mis au jour.
Et ce qui semblait être d'abord une aimable opérette devient une plongée des plus subtiles dans l'énigme des âmes connexes.
L'écriture précise, élégantes, incisive, achève de faire de ce roman un bijou.
BH
11/17
"Les femmes sont des guitares (dont on ne devrait pas jouer)" Clemens J. Setz (Actes Sud)
 C'est
un texte lent dans sa lancée horizontale mais
ultrarapide et même supersonique dans ses coupes transversales.
C'est
un texte lent dans sa lancée horizontale mais
ultrarapide et même supersonique dans ses coupes transversales.
Ce
sont des coups de sonde, des ressassements et tournoiements
obsessionnels qui brassent une matière si riche que l'obsession est
sans cesse
transcendée. C'est une approche sans équivalent de la folie ordinaire
et de la
folie extraordinaire.
L'héroïne
de ce texte en forme de puzzle, de jeu de piste
et d'exploration spéléologique se prénomme Natalie. Elle a 21 ans, un
emploi
d'aide-soignante dans un établissement psychiatrique et un cerveau
aussi
singulier que fulgurant qui lui joue des tours, sujet qu'il est à des
court
circuits, des épisodes épileptiques. La narration alterne entre la
recension
minutieuse du quotidien et des pensées de Natalie et sa découverte,
alerte,
curieuse, abasourdie, de l'univers psychiatrique. Le tour de force de
ce texte
réside dans la transcription des pensées et rituels de Natalie qui sont
hors
normes, qui vont fouiller dans des zones troubles, répugnantes, et ne
laissent
pas de dérouter le lecteur.
Le
narrateur ne se tient pas au plus près du mécanisme
mental de Natalie, il l'épouse, le restitue de l'intérieur. On est
ainsi convié
auprès d'elle quand elle est "en maraude" (chasse à caractère sexuel)
quand elle investit "le souterrain" (sorte de société secrète mais
informelle et ouverte), quand elle s'invente des jeux de rôle et de
langage
avec son ex petit ami Markus....
Et
cette jeune fille funambule et intrépide va être
confrontée à un défi de taille : on place sous sa garde Dorm un
"stalker"
ou érotomane qui harcela autrefois un dénommé Hollberg jusque ce que la
femme
dudit se suicide.
Or le
fameux Hollberg vient chaque semaine rendre visite à
Dorm, patient singulier s'il en fut.
L'un
des enjeux du texte, outre cette relation
véritablement folle (dont Natalie percevra peu à peu, sinon le sens, du
moins
le mécanisme) c'est le rapport de notre héroïne aux mots : ils
tourbillonnent
en elle comme des toupies, des prismes colorés, fascinants, et elle les
traque
avec une attention et une passion maniaques.
Et
l'auteur démonte, avec une attention minutieuse et une
habileté remarquable, le mode de fonctionnement de cet esprit étrange,
trépidant, quasi génial. L'opération est menée avec un humour mordant,
mâtiné
d'une tendresse palpable. Du reste, Clemens J. Setz enveloppe tous ses
personnages dans un regard qui oscille entre douceur, compréhension et
férocité
corrosive.
Un
texte qui joue sur tous les registres de l'inconfort et
se déploie avec une ampleur et maestria rares.
BH
10/17
"La nuit, la mer n'est qu'un bruit" de Andrew Miller (Piranha)
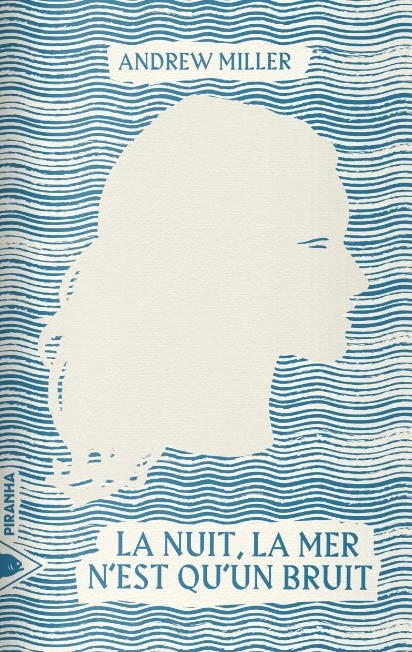 C'est
un livre lent,
profond,
ondoyant, qui enveloppe dans la même langue fluide les hommes et les
éléments.
C'est
un livre lent,
profond,
ondoyant, qui enveloppe dans la même langue fluide les hommes et les
éléments.
C'est un texte fait de ressacs heurtés et de longues langues d'écume mousseuse. L'opacité et la transparence se le partagent à parts égales.
Il est beaucoup question de la mer, de ses lois, ses pièges et ses envoûtements. La mer est une basse continue, une scansion, un thème décliné. Mais le cœur rougeoyant est ailleurs. C'est une femme, Maud, une étrangeté absolue, appréhendée à travers des prismes successifs et qui résiste à toutes les explications.
Maud est d'abord une jeune femme, une étudiante, dont Tim, jeune musicien vibrant d'amour et d'espérance, s'éprend follement.
Elle est ensuite la mère de Zoé, fruit d'une union avec ledit Tim. Elle est enfin, dans le sillage d'un événement terrible, d'un chagrin inapaisable, une femme en fuite et en quête, qui se mesure à la mer.
Tout au long du roman, Andrew Miller tient le pari de scruter une figure parfaitement opaque, de rendre intelligible et proche une femme indéchiffrable. Loin de sonder les mobiles qui l'animent, il s'applique à faire défiler sous toutes ses variantes apparentes, la surface lisse, inapprochable, qui lui tient lieu de présence au monde.
Il réussit le tour de force de nous faire entrer non dans l'intimité mais dans le mystère d'un étrangère moins camusienne qu'absolue.
Et, par la grâce d'une écriture poétique, sensuelle, méticuleuse, qui épouse et restitue les vibrations les plus subtiles, il rend cette femme, présumée monstrueuse, absolument bouleversante.
BH
10/17
"Cœurs silencieux" de Anne Brécart (Zoé)
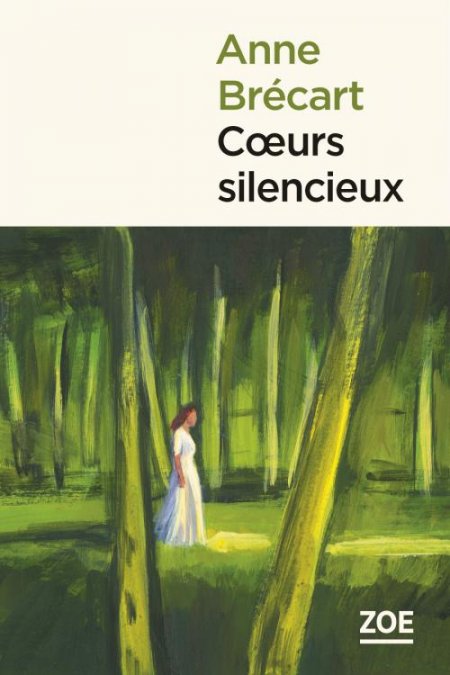 C'est
une
histoire
d'une
simplicité désarmante : une femme revient sur les lieux de sa prime
jeunesse et
retrouve son premier amour.
C'est
une
histoire
d'une
simplicité désarmante : une femme revient sur les lieux de sa prime
jeunesse et
retrouve son premier amour.
Mais Anne Brécart déjoue l'évidence apparente et ouvre, à partir de cet argument étroit, un champ d'une profondeur rare. Soit Hannah et Jacob. Ils se sont connus il y a de cela quarante ans et se sont aimés, violemment et mal.
Jacob, plus âgé, a cueilli Hannah, bourgeon de femme incertain, hésitant, au sortir de l'adolescence. Il est le maître, l'instituteur, celui qui détient le savoir. Elle possède le pouvoir de la richesse, le prestige attaché à une lignée, une famille de haute extraction.
Ils se rencontrent à la campagne, dans une bourgade où prévalent les valeurs paysannes et communautaires.
La passion est forte mais les âmes sont encore faibles, peu trempées, et les disparités se creusent, les malentendus s'accusent. Au travers de sa narratrice, Hannah, Anne Brécart raconte, quarante ans après, une tentative de renouement.
Les évocations d'un passé vivace alternent avec la saisie du présent. On a également accès à des pans de l'intériorité de Jacob au travers des fragments de son journal qu'il confie à Hannah. Des zones obscures du passé sont ainsi peu à peu élucidées mais ce qui frappe surtout, c'est combien Anne Brécart excelle à traduire les infimes vibrations de l'âme, les mouvements successifs et parfois simultanées d'attraction et de répulsion qui animent les anciens amants.
Il s'agit d'un apprivoisement mutuel sur terrain miné par la destruction mais gorgé de désirs inassouvis.
C'est un hymne à l'amour qui croît, se fortifie et s'affine infiniment avec le temps. Les corps retrouvés se cognent, se fuient, s'aimantent, se repoussent au fil d'une chorégraphie complexe qu'Anne Brécart orchestre avec une subtilité virtuose.
La langue, limpide, délicate, irrigue le texte d'une lumière qui s'imprime dans la mémoire du lecteur ébloui.
BH
10/17
"Almeria" de Olivier Dubouclez (Actes Sud)
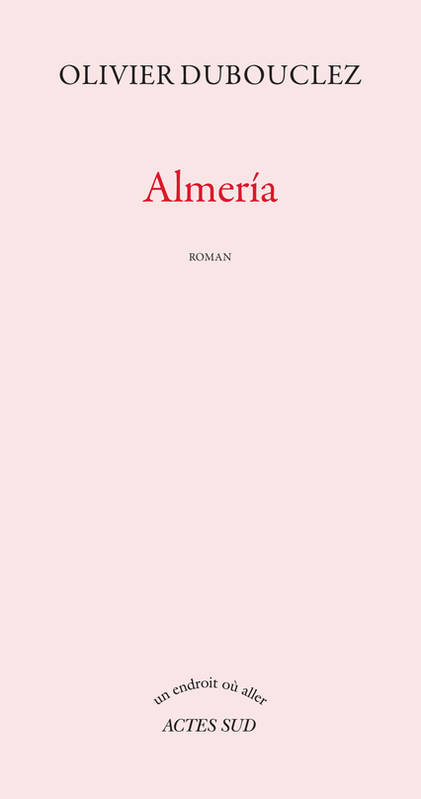 Voici
un étrange
roman de
formation, à la fois classique et marginal, dépaysant et suranné.
Voici
un étrange
roman de
formation, à la fois classique et marginal, dépaysant et suranné.
On se trouve dans le sud de l'Espagne, à Almeria, dans les années 90, mais l'écriture, très soignée, et les résonances de certaines pages nous transportent dans une époque indécidable et intemporelle.
Le narrateur adolescent vit dans la fascination de son frère aîné, Rodrigo, dont l'étrangeté, la brusquerie, l'aisance apparente et l'opacité qu'il oppose, le magnétise.
Il mène ainsi une existence satellisée, mendiant un signe qui pourrait aller dans le sens d'un possible pacte scellé, traquant les indices qui pourraient élucider ce frère indéchiffrable.
Dans le même temps, il s'initie aux féroces douceurs, aux cruelles voluptés et aux avanies du pensionnat.
Comme il se doit, le narrateur noue des amitiés ferventes et est en proie à de farouches émois. Une part de la ferveur dédiée à Rodrigo migre vers Iraï, l'ami élu, et Bettina, la jeune pétroleuse qui polarise tous les désirs.
L'une des singularité du roman tient dans la figure de Madame Issambra, la grand-mère du narrateur. Cette femme, de son vivant, est un refuge, un mystère, une fascination vaporeuse. Une fois morte, elle change de nature, elle devient une apparition sporadique et stellaire, un fantôme velouté mais impératif qui requiert fortement le narrateur. Elle est un pôle paradoxal entre envoûtement et épouvante. Dès lors, le texte sans pour autant basculer dans le fantastique, est émaillé d'éclairs surnaturels.
Le narrateur, délaissant la somptueuse Bettina, apprend l'amour ou ses simulacres auprès de Beatriz, jeune tanagra présumée laide mais dont le charme singulier et les pouvoirs occultes l'aimantent.
Il s'attache violemment et se détache tout aussi brutalement. Il traverse une ville, Almeria, et ses saisons et mutations, il traverse un âge et ses métamorphoses, escorté par la fantasque et immatérielle présence de madame Issambra. Une nostalgie poignante anime le narrateur : il éprouve, à l'égard de cette adolescence fondatrice un attachement féroce.
La langue est d'une grande élégance, limpide, tout en volutes douces et arabesques aiguës. Une sensualité subtile irrigue ce texte qui met à l'honneur les odeurs, saveurs et perceptions tactiles.
La douceur n'est qu'apparente : d'abruptes ruptures guillotines les pages. Cependant, c'est l'opulence qui domine et qui s'est délicatement déposée dans ces pages.
Un roman délectable.
BH
07/17
"L'un d'entre nous dort" de Josefine Klougart (Actes Sud)
 C'est
un livre qui
déjoue toutes
les attentes, qui se joue des balises, des règles et des codes de
l'exercice
imposé.
C'est
un livre qui
déjoue toutes
les attentes, qui se joue des balises, des règles et des codes de
l'exercice
imposé.
L'argument qui préside au texte est simple : il s'agit d'une femme, encore jeune qui, à la suite d'une rupture amoureuse, retourne chez ses parents, se réfugie dans le cadre et le cocon de son enfance.
Or desdits parents il sera à peine question et des causes et conditions de la rupture encore moins.
La narratrice se concentre exclusivement sur les sensations qui, dans le décor familier, l'assaillent et se télescopent avec des perceptions relatives à la relation amoureuse défunte.
La maison parentale se situe à la campagne et c'est au travers du prisme de la nature que l'amoureuse éconduite radiographie ses états et fluctuations. Au fil d'une chronologie éclatée, on est ainsi aux prises avec des lambeaux de paysages, de souvenirs cuisants et sensations saignantes.
Aucun ordre apparent ne gouverne ces fragments jetés, presque crachés, si ce n'est une logique organique qui épouse les sursauts et cahots du corps déchiré, de la mémoire à vif.
Ce texte est un enchevêtrement de boutures poétiques, un kaléidoscope d'instantanés intimes pris sur le vif et qui se court-circuitent les uns les autres.
Le chagrin s'exprime et s'épuise à travers des évocations de gestes, de moments, de parfums si singulièrement décrits qu'ils désarçonnent chaque fois.
Tout n'est qu'esquisses, amorces, ellipses : à charge pour le lecteur de combler éventuellement les lacunes. Mais il peut aussi choisir de demeurer dans cet univers fantasmatique et suspendu. Ces franges et parcelles de passé restituées sont à la fois vaporeuses, immatérielles et crues. Une sensualité forte, directe mais délicate, imprègne tout le texte.
C'est aussi un poème hérissé, rugueux, hirsute, comme mal taillé de partout.
Une curiosité. Une surprise de chaque instant.
BH
07/17
"Le pays dont je me souviens" de Anne Revah (Mercure de France)
 C'est
un texte qui
parle de
conquête, de réappropriation, d'affranchissement, mais sur un mode non
pas
guerrier et belliqueux mais poétique et même onirique. C'est l'histoire
de
Philippe qui, au mitan de sa vie, décide brusquement de partir, de
rompre avec
tout ce qui constituait jusqu'alors les fondements et les conditions de
son
existence.
C'est
un texte qui
parle de
conquête, de réappropriation, d'affranchissement, mais sur un mode non
pas
guerrier et belliqueux mais poétique et même onirique. C'est l'histoire
de
Philippe qui, au mitan de sa vie, décide brusquement de partir, de
rompre avec
tout ce qui constituait jusqu'alors les fondements et les conditions de
son
existence.
Plongé dans un état quasi létal à la suite de la mort précoce et accidentelle de ses parents, Philippe a mené, des décennies durant, une existence atone, indiscernable, sans saillie ni aspérité aucune. Il était une silhouette indécise, indistincte, qui se fondait dans les motifs tracés par d'autres. Il a ainsi épousé, en même temps qu'une dénommée Claire, toutes ses volontés et décisions au point de se muer en pur fantoche.
Le seul épisode qui l'arracha à sa torpeur se situe durant son adolescence, lors de sa rencontre avec Valentine, jeune fille rayonnante. Auprès de Valentine qui suscita en lui une dévotion intense, Philippe a entrevu ce qui pouvait être, non seulement l'amour, mais une vie pleinement étreinte. Et s'il désire avant tout en finir avec la servitude et l'effacement, c'est Valentine que, au terme de sa fugue impromptue il entend rejoindre.
Mais une rencontre insolite va, à la fois, déjouer et favoriser ses plans. Revenu dans sa ville natale en quête de Valentine, il va rencontrer, dans un café, un vieil homme qui va l'entraîner dans une histoire, la sienne. Il est, lui aussi, animé par une quête: celle d'un territoire perdu, baigné de lumière, piqué d'éclats fiévreux, gorgé de senteurs grisantes, traversé par des figures tutélaires ou des silhouettes d'une grâce fascinante. Un pacte tacite se scelle entre Philippe et Myor. Ils se reconnaissent, s'adoubent et s'adoptent mutuellement. Le récit alterne les évocations du passé irradié de Myor et celles de la vie fracturée, démise, de Philippe.
A mesure que Myor déroule sa narration, se dessinent les contours et les reliefs d'un pays de lumière, théâtre d'une étrange initiation aux accents fantastiques.
Magnétisé par la parole lyrique et exalté de Myor, Philippe épouse son rêve et s'engage à le ramener sur les rives du lac qui l'a fondé et qui le hante.
Un récit en forme de fable, semé d'éclats poétiques et qui se développe au fil d'une langue cristalline, infiniment délicate et enveloppante.
BH 06/17
"Gens
de Bergen" de
Tomas Espedal (Actes Sud)
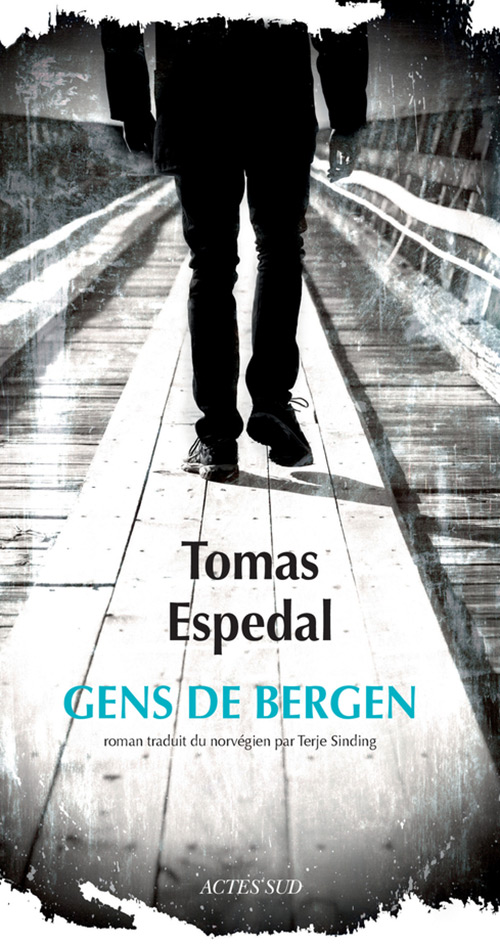 C'est
un livre de
chagrin ouvert.
Il procède d'une peine incompensable puisque l'auteur, ayant vécu un
grand
amour tardif, se voit congédié, à cinquante ans, par la très jeune
femme qui
avait transfiguré sa vie et sans qu'il ne pouvait plus effectuer le
moindre
pas.
C'est
un livre de
chagrin ouvert.
Il procède d'une peine incompensable puisque l'auteur, ayant vécu un
grand
amour tardif, se voit congédié, à cinquante ans, par la très jeune
femme qui
avait transfiguré sa vie et sans qu'il ne pouvait plus effectuer le
moindre
pas.
Eperdu de tristesse, il se met, comme on s'alcoolise, à écrire, au fil de ses voyages et humeurs, des fragments qui sont à la fois des dérivatifs et des occasions de verbaliser ce qui l'étreint.
Il écrit de brèves proses ou des échappées poétiques qui le figurent en alcoolique, en arpenteur éconduit et terrassé, en ami affamé de chaleur humaine, en père transpercé par le départ de sa fille (lequel vient s'ajouter à l'abandon de l'amoureuse). On le voit déambuler dans Rome, Madrid, New York ou Berlin, orpailleur du quotidien, toujours en quête des pépites poétiques à extraire, pépites qu'il polit et sertit dans les mots pour les présenter au monde.
Car notre homme a le chagrin sociable et magnanime. Ses voyages poignardés d'absence sont émaillés de rencontres et les prélèvements vibrants qu'il opère sont, la plupart du temps, dédiés et destinés à une personne précise de son entourage.
Ce vagabondage géographique et mental, ces voltes et chorégraphies verbales sont le fait d'un esprit libre qui transmue l'aliénation amoureuse en explorations infiniment ouvertes sur le monde. La langue sautillante et ailée semble celle des oiseaux.
Un
texte hors normes
qui
déconcerte et captive.
BH
05/17
"Cent jours de pluie" de Carellin Brooks (Les Allusifs)
 C'est
un texte sur la
lancinance.
Temporelle, météorologique, affective. La narratrice semble prise dans
une
boucle temporelle, un cycle obsessionnel, et soumise à des répétitions
mortifiantes et mortifères.
C'est
un texte sur la
lancinance.
Temporelle, météorologique, affective. La narratrice semble prise dans
une
boucle temporelle, un cycle obsessionnel, et soumise à des répétitions
mortifiantes et mortifères.
La narratrice se trouve, à Vancouver, aux prises avec une situation douloureuse Séparée de sa compagne, M. (désignée par cette seule initiale), elle doit faire face à des difficultés financières, à la précarité qui la menace, mais aussi aux querelles incessantes qui l'opposent à ladite M., sans compter qu'elle doit composer avec le père biologique de son fils. Le soutien de ses amies, pourtant prévenantes et magnanimes, et la présence dans sa vie de son amante S., ne suffisent pas à endiguer la tristesse qui tend à la submerger.
Le texte est composé de brèves séquences qui rendent compte des avanies qu'elle subit et, plus rarement, des brèves périodes d'accalmie qu'elle goûte.
Aux abois financièrement, en butte aux tracasseries de M. qui lui dispute la garde de leur fils, la narratrice, talonnée par une urgence anxiogène, écrasée de chagrin, semble prise dans les rets d'une fuite en avant immobile qui la plaque au sol. L'originalité du texte tient au fait que tous les épisodes sont perçus à travers le prisme de la pluie qui s'abat continûment sur Vancouver.
Selon un procédé cher aux romantiques, la nature se met au diapason des émotions de la protagoniste, si ce n'est qu'en l'occurrence, on ne sait plus ce qui est premier : la pluie qui englue et génère les idées noires ou la situation objectivement cruelle et qui semble stagner sans qu'une issue favorable se dessine jamais.
La langue est, en alternance, sinueuse, ondoyante, ou décapante. Poétique et suggestive toujours. Et l'auteur écrit au rythme, obsédant, de la pluie qui tombe. Elle décline toutes les variétés existantes de pluie si bien que le texte se mue en relevé presque méthodique voire en précis scientifique. Et on perçoit, physiquement, la scansion obsédante des gouttes de pluie, l'humidité pénétrante qui sévit. La langue est, tout ensemble, ciselée et aérienne, presque vaporeuse.
Un texte qui s'égale à une mélodie hypnotique et qui est aussi une quintessence de la tristesse et de la difficulté d'être.
BH 05/17
"C'est pourquoi les jeunes filles t'aiment" de Ariel Spiegler (Editions de Corlevour)
 Ariel
Spiegler
pratique une
poésie de la déroute et du cisaillement. Elle oscille entre l'incisif
et le
tendre, le culotté, le cocasse et le poignant et elle bascule de l'un à
l'autre
sans préavis.
Ariel
Spiegler
pratique une
poésie de la déroute et du cisaillement. Elle oscille entre l'incisif
et le
tendre, le culotté, le cocasse et le poignant et elle bascule de l'un à
l'autre
sans préavis.
Sa poésie peut avoir des accents romantiques, élégiaques et rêveurs mais elle peut être, aussi, très concrète, crue, mordante, attachée aux détails qui accrochent un regard peu rompu aux approches convenues et réductrices.
C'est une langue faite de ruptures, d'associations et de combinaisons inattendues. Le lecteur est pris par surprise et parfois à rebrousse-poil par cette poésie abrupte qui ne mâche pas ses images.
C'est aussi une langue ancrée dans le corps, amoureux et désirant, une langue qui dit la passion et la perte sans détours, avec une frontalité réjouissante.
"Ton rire empoignait mes cheveux
tu avais écrit
"nous
nous
sommes revenus"
Tu m'accusais d'être capricieuse, minaude,
inconstante et la plus perverse
de toutes les femmes que tu avais eues.
Mais, dans mes habits sales, fantôme,
J'ai chanté pour toi tout l'hiver."
C'est une langue franche et claire, mais qui a des passes obliques, des pointes pénétrantes, et qui renouvelle le regard.
"Détachez-moi de ma charrue
et je m'étendrai un instant
sur la terre.
Je basculais trop vite avant
d'admettre que j'étais fourbue.
Au désert j'ai passé mille ans
à embrasser des épines
et j'appelais l'achèvement."
BH
04/17
"Fergus, année sauvage" de Jaunay Clan (Les Allusifs)
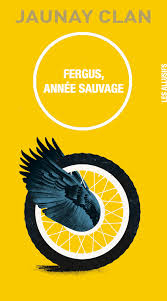 C'est
un texte qui
cavale, galope
et file au rythme de la lumière. Celle qui fuse dans l'esprit du
narrateur et
qui est d'une nature étrangère à nos lieux communs.
C'est
un texte qui
cavale, galope
et file au rythme de la lumière. Celle qui fuse dans l'esprit du
narrateur et
qui est d'une nature étrangère à nos lieux communs.
Celui qui raconte, c'est Fergus, un garçon qui est aussi une comète. On l'a placé dans un centre pour adolescents désaxés. Ce lieu, nommé Beauséjour, accueille des esprits singuliers et vibrants, inassimilables dans le monde tribal et trivial. Ces âmes trop vives portent sur le monde un regard décalé et poétique.
Fergus navigue entre Beauséjour et Les Saules le domaine familial où officie Carson Flanagan, mère de Fergus, figure majestueuse et friable, qui inspire à son fils une adoration sacrée. Aux Saules, Fergus retrouve aussi son frère Frany, sorte de corsaire intrépide, figure tutélaire, modèle indétrônable et infiniment admiré.
A Beauséjour, les personnages hauts en couleur abondent également, qui portent des noms peu usuels (probablement le fruit de l'inventivité galopante de Fergus) : Grain de riz, Double facette, Ben Affleck...
La narration, alternant entre la première et la troisième personne, se tient toujours au bord du dérapage et de la divagation hermétique. On est sur le fil d'un esprit funambule, au bord de l'inintelligible et l'auteur excelle à transcrire cet univers mental trouble, tremblé, d'une déconcertante beauté.
Les épisodes saillants se succèdent. Notamment l'irruption d'une gracieuse psy toute de rouge vêtue et opportunément nommée Tulipe Vassili. Laquelle Tulipe échauffe les corps et les esprits. Mais les péripéties importent moins que la langue, écarlate, éclatante, gorgée d'explosives trouvailles poétiques.
Un bijou.
BH
04/17
"Douce nuit" de Ragnar Hovland (Les belles lettres)
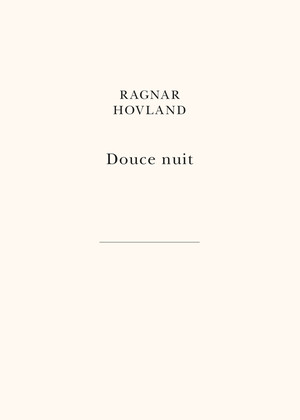 C'est
un roman en
forme
d'escroquerie charmante, de pierre lunaire ou de douce divagation qui
égare
plaisamment. C'est aussi une énigme et un piège qui crochète par
surprise.
C'est
un roman en
forme
d'escroquerie charmante, de pierre lunaire ou de douce divagation qui
égare
plaisamment. C'est aussi une énigme et un piège qui crochète par
surprise.
C'est une mosaïque étrangement agencée, un mobile prismatique et fascinant.
Le narrateur est un écrivain aux allures nonchalantes, au parler désinvolte, qui navigue entre passé et présent et entre les diverses cases, très compartimentées, de sa vie.
La famille tient, dans son récit, une place aussi prégnante qu'insolite. Il nous avertit d'emblée qu'ils étaient, à l'origine, cinq frères, mais que les deux derniers ne comptes pas et qu'ils se sont, du reste, volatilisés.
Reste "mon frère", son aîné, le seul qui ait droit à cette qualification distinctive, et le cadet, baptisé "Numéro trois". "Mon frère" est l'objet d'une espèce de culte bizarre ou d'adoration désolée et d'autant plus depuis qu'une crise inexplicable l'a placé, à perpétuité, aux portes de la folie. Quant à "Numéro trois" c'est l'élément rationnel et pragmatique de la fratrie et pourtant, devenu avocat, il a été jeté en prison à la suite de dangereuses transactions et, une fois sa liberté recouvrée, il se met en tête d'accomplir seul un périple sauvage à moto.
Le narrateur nous relate des épisodes peu cousus de son existence fantasque et chaotique. Une visite impromptue à ses parents. Un séjour auprès d'un ami aussi branque que lui. Ses tentatives, peu fructueuses, pour faire sortir "mon frère" de sa réclusion. Ses démêlés, désopilants, avec son éditeur. Sa vie amoureuse marquée par une trépidation, une frénésie et une imprévisibilité constantes. Le tout est narré sur un ton incisif et détaché, avec un humour qui décape autant qu'il déroute.
Et
cependant ce n'est
pas, ce
n'est jamais, la dérision qui l'emporte mais, contre toute attente, une
tendresse torrentielle qui, subitement, renverse toutes les mordantes
digues
érigées. C'est ce tour de force, au cœur de l'apparente légèreté qui
fait le
prix et la singularité de ce texte savoureux.
BH
03/17
"Les souhaits ridicules" de Pauline Klein (Allia)
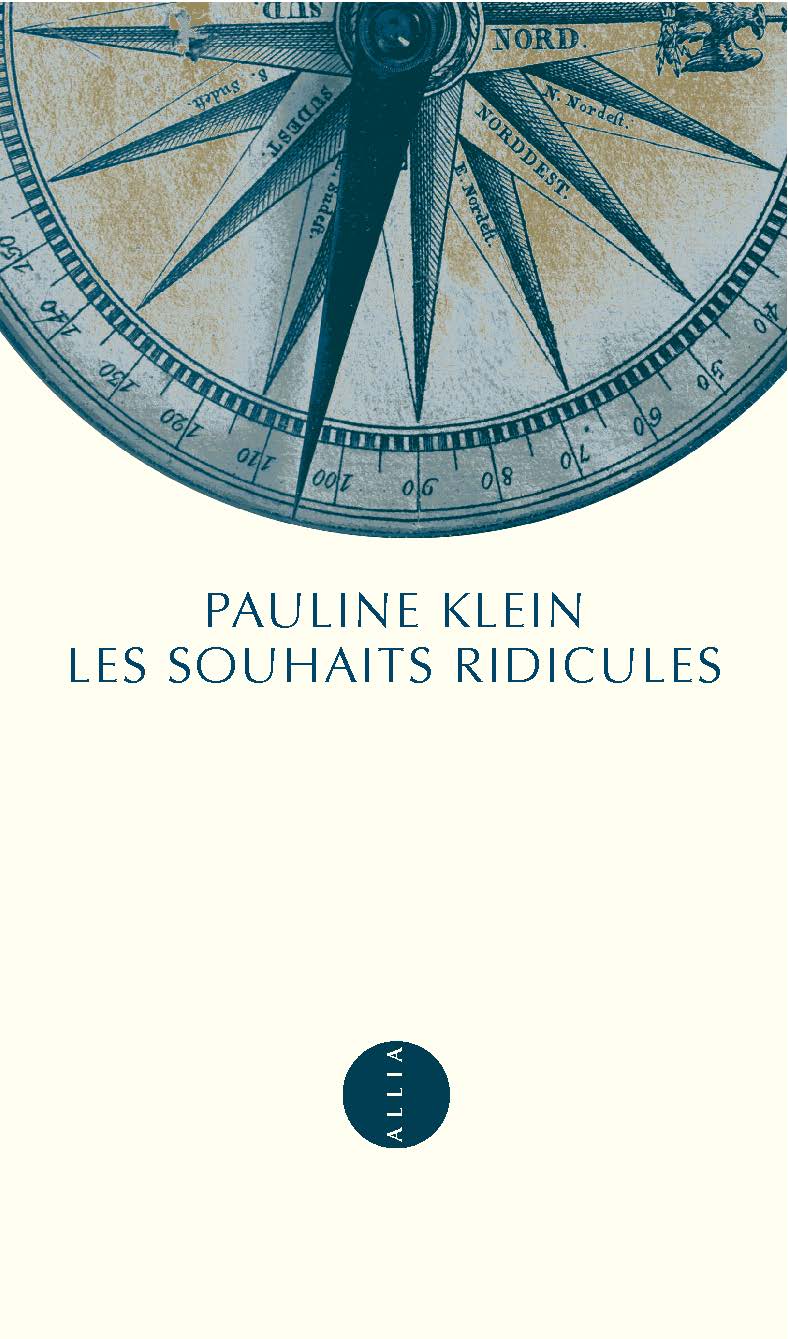 Pauline
Klein
est une
facétieuse
et une rouée. Elle s'amuse des codes qu'elle déconstruit et elle
orchestre un
subtil et espiègle roman de désapprentissage. En s'appuyant sur une
scène
fondatrice de son enfance (la perte traumatique d'une boussole offerte
par un
petit garçon aimé), la narratrice conduit son récit au fil d'une
désorientation
qui va s'aggravant. La perte de la boussole causa une crise allergique
contraignant la protagoniste à n'investir, désormais, que des
territoires
familiers et précisément quadrillés. L'inconnu, la surprise,
l'étrangeté sont
proscrits, elle n'appréhende plus du monde qu'un périmètre étroit et
contrôlé.
Pauline
Klein
est une
facétieuse
et une rouée. Elle s'amuse des codes qu'elle déconstruit et elle
orchestre un
subtil et espiègle roman de désapprentissage. En s'appuyant sur une
scène
fondatrice de son enfance (la perte traumatique d'une boussole offerte
par un
petit garçon aimé), la narratrice conduit son récit au fil d'une
désorientation
qui va s'aggravant. La perte de la boussole causa une crise allergique
contraignant la protagoniste à n'investir, désormais, que des
territoires
familiers et précisément quadrillés. L'inconnu, la surprise,
l'étrangeté sont
proscrits, elle n'appréhende plus du monde qu'un périmètre étroit et
contrôlé.
On retrouve la narratrice âgée d'une quarantaine d'années, flanquée d'un mari lambda, dotée de deux charmants enfants et engluée dans une vie parfaitement formatée. Les rouages de cette existence millimétrée se détraquent pourtant insensiblement. Plongeant dans la matière obscure et touffue des contes qu'elle lit le soir à ses enfants, la narratrice renoue avec des figures sauvages et, notamment, avec celle du loup qui se met à la hanter. Elle désire soudain qu'un loup fasse effraction dans cette vie trop rangée. Ledit loup prendra les traits et l'apparence de Baptiste, appétissant collègue versatile, sans épaisseur ni substance véritable, mais fort de sa jeunesse, de son charme mordant et de son irrésistible goujaterie.
C'est une variation incisive autour du thème éculé du "démon de midi" ou de la fameuse "crise de la quarantaine". C'est aussi l'occasion, pour l'auteur, d'épingler, sur un mode ironique et distancié, les fétiches factices et frelatés qu'on propose à nos forces désirantes dévoyées.
C'est, en mode mineur, la satire d'une société qui a perdu le sens de l'érotisme et du sacré. C'est aussi, par petites touches corrosives, le portrait au fond poignant d'une femme évidée de l'intérieur, en quête d'un absolu qui se dérobe.
BH 03/17
"La distance de fuite" de Catherine Safonoff (Zoé)
 On
est
heureux de
retrouver
l'écriture buissonnière de Catherine Safonoff, ses voltes et rapines,
ses
trésors de contrebande, sa voix saline, râpeuse, haletée, ses saccades
tour à
tour exaltés ou abattues, ses longues périodes inspirées, azimutées,
son inquiétude
vibrante qui tout imprègne.
On
est
heureux de
retrouver
l'écriture buissonnière de Catherine Safonoff, ses voltes et rapines,
ses
trésors de contrebande, sa voix saline, râpeuse, haletée, ses saccades
tour à
tour exaltés ou abattues, ses longues périodes inspirées, azimutées,
son inquiétude
vibrante qui tout imprègne.
Elle nous livre, une fois encore, l'or bousculé de sa vie, nous fait cadeau de ces chroniques touffues, cabriolantes, qu'elle tient. Elle continue, inlassablement, de prélever la limaille, les pépites, au cœur de sa vie qui tinte, cahote. Sa vie qui, plus qu'à son tour, est chahutée, brinquebalée.
C'est une vie qui s'écrit sous nos yeux, une sensibilité à vif qui communique, sans fard et sans filtre, aux lecteurs ses angoisses, ses éblouissements, ses étonnements, ses peines lesquels, chaque fois sont d'une étrangeté hors normes, d'une acuité hors de la mesure commune.
Il est question de Léon, l'ex-mari qui s'invite régulièrement, sans motif explicite, chez notre diariste. Laquelle s'interroge ad libitum sur les causes de cette énigmatique réapparition.
Il y a Z., l'analyste qui fut l'objet d'un précédent ouvrage et d'une passion aussi tardive qu'impossible. Les séances thérapeutiques avec cet homme auréolé sont toujours vécues comme des points d'orgue et de cristallisation lumineuse.
Il y a la difficulté d'écrire qui occupe, qui ronge. Les amies bienfaisantes, salvatrices ou d'une frontalité salubre.
Les proches, les mieux aimés, les deux filles, la puissance toujours déracinante et sans pareille de l'amour maternel.
N., l'amant grec, l'escroc mort dont l'étoile ne pâlit pas.
Il y a surtout une poignante nouveauté : les ateliers d'écriture en prison qui mettent Catherine Safonoff aux prises avec ses angoisses fondamentales, et sa peur panique de l'altérité.
Et puis les éblouissements qu'elle connaît face aux détenues.
Le tout est restitué dans une langue hirsute, écorchée et avec une élégante et minutieuse précision.
Un livre d'une rare, d'une totale humanité.
BH 02/17
"Gestuaire" de Sylvie Kandé (Gallimard)
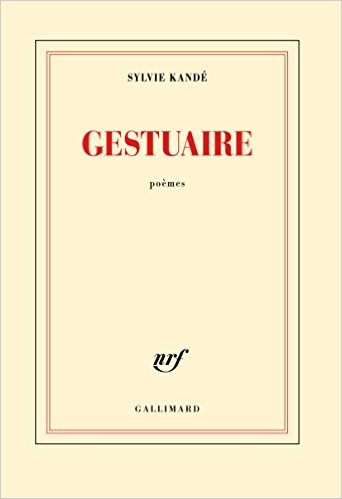 C'est
une langue
chargée
d'histoire et de sensations brutes que celle qui anime "Gestuaire"
recueil de Sylvie Kandé, langue scandée, incantatoire, qui charrie une
vie
océane, battante, inassignable.
C'est
une langue
chargée
d'histoire et de sensations brutes que celle qui anime "Gestuaire"
recueil de Sylvie Kandé, langue scandée, incantatoire, qui charrie une
vie
océane, battante, inassignable.
Ce sont des instants chapardés dans le vif des courses, des fuites, des fêtes, improvisées ou non.
C'est une esquisse et un combat pour que vive la note plus haute, pour que se dresse la vie verticale.
C'est un hommage, habité, à tous les poètes qui ouvrirent la voie de la percée et du dévalement sans frein.
Ce sont des évocations, à la fois très précises (fragments de dialogues, scènes épinglées) et cependant insituables, aspirées par le souffle universel.
C'est une poésie dense, charnue, longue en bouche. Une poésie insurgée aussi, parfois imprécatoire, qui dénonce mensonges, exactions, et exhorte à résister.
Ce sont des fragments minuscules (les errances d'un moustique, le dessin d'un doigt qui court, la quête d'un geste inqualifiable...) mais qui prennent des dimensions fantastiques, emplissent tout l'espace sensoriel et sont élevés au rang de symboles sacrés.
C'est une langue riche qui s'irrigue de flux personnels, réchauffe aux souvenirs d'Afrique mais ne s'y arrête pas.
Langue battante, combattante, qui s'immerge dans l'humus et se gorge de sucs individuels, mais pour mieux dégager le geste, pour ainsi dire archétypal, qui préside à toutes les brassées et turbulences humaines.
Ainsi :
"Car
du geste
qui ne s'étend ni ne s'écrit
n'est-il pas juste de dire qu'il est
pensée qui s'effile dans l'air
propos qui cogne dans le vide
ombre portée du néant... (...)
Il
est une signature
qu'on paraphe ou rature
Son luxe son parfum
aux quatre vents on sème
quand d'aventure
la main d'elle-même
s'éprend"
Une langue opaque qui étincelle, qui enchante inquiète et trouble comme se doit de le faire toute grande œuvre.
BH
02/17
"Soudain, j'ai entendu la voix de l'eau" de Kawakami Hiromi (Philippe Picquier)
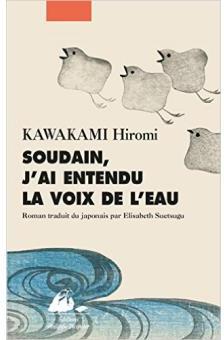 C'est
un récit tout
en lignes
subtiles, ténues, presque estompées.
C'est
un récit tout
en lignes
subtiles, ténues, presque estompées.
La narratrice, revenue sur les lieux, chargés, de son enfance, restitue une généalogie des plus étranges, un roman familial composé d'enchevêtrements inextricables, fondé sur des secrets jamais levés.
Au fil des souvenirs exhumés apparaissent les figures saillantes qui, peu à peu, se dressent et se précisent. D'abord Ryô qui est le frère de Miyako, la narratrice mais aussi son seul et impossible amour véritable. Puis leur mère, prématurément disparue, personnage fantasque, discrètement flamboyant, qui magnétisait irrépressiblement tous ceux qui croisaient sa route. Le père, lui, est une silhouette plus floue, une personnalité plus indécise. Autour de la cellule familiale, gravitent plusieurs présences prégnantes. Dont Takeji, énigmatique et impénétrable ami du couple parental, et Nahoko, espiègle et frondeuse amie du couple fraternel.
Au fil de la narration, elliptique et bousculée, les secrets viennent au jour. Miyako et Ryô apprennent la vérité sur leurs origines et l'invraisemblable arrangement qui présida à l'organisation de la vie familiale. Mais la grande affaire de la narratrice, quand bien même elle évoque avec force détails et ferveur sa mère disparue, est et demeure sa relation vibrante avec son frère. Elle forme avec lui un noyau brûlant qui absorbe toute son attention, toute son énergie. Miyako perçoit Ryô de l'intérieur, du plus profond d'elle-même et les plus belles pages du récit sont sans doute celles dans lesquelles elle prélève, au plus près de leur pulsation secrète, les gestes, les affleurements, les sourires, les regards qui rendent compte de l'amour et du désir, sans nom et sans exutoire, qui unissent le frère et la sœur.
La beauté réside aussi dans les ellipses, dans toute la part retranchée, inassouvie, de cette relation.
Un récit à la pointe fine, tissé de buées subtiles, de murmures à peine audibles, de souffles estompés, d'ardeurs et de dévotions rentrées.
Une partition aérienne, presque arachnéenne, toute en finesse fluide et cependant irriguée par un feu qui, l'air de rien, embrase toutes les pages.
Une ode poignante à la déglingue féconde des familles folles.
BH
01/17
"Le silence n'est plus à toi" de Asli Erdogan (Actes Sud)
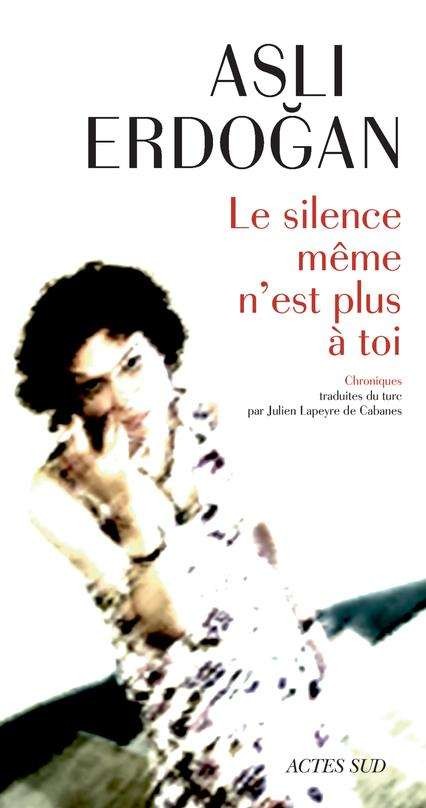 Par
une cruelle
ironie du sort,
le recueil d'Asli Erdogan paraît alors même vient tout juste d'être
libérée de
prison (le 29 décembre 2016). Cette romancière et journaliste turque a,
en
effet, purgé une peine de plus de quatre mois et le chef d'accusation
qui
pesait contre elle était le suivant : elle appartiendrait à une
organisation
terroriste pour avoir publié des chroniques dans un journal pro-kurde.
Par
une cruelle
ironie du sort,
le recueil d'Asli Erdogan paraît alors même vient tout juste d'être
libérée de
prison (le 29 décembre 2016). Cette romancière et journaliste turque a,
en
effet, purgé une peine de plus de quatre mois et le chef d'accusation
qui
pesait contre elle était le suivant : elle appartiendrait à une
organisation
terroriste pour avoir publié des chroniques dans un journal pro-kurde.
L'impact de ces chroniques qui nous parviennent aujourd'hui se trouve accru par les faits. Ces textes prennent un accent prémonitoire. C'est comme si Asli Erdogan avait eu la prescience du sort inique qui lui serait réservé. Où l'on vérifie, négativement, par l'absurde, que l'écriture est un acte. Car celle d'Asli Erdogan, emportée, véhémente, est une résistance farouche sans cesse réaffirmée.
Intrépide, insurgée, l'écrivain n'a cessé de dénoncer exactions et injustices et de se tenir au plus près de ceux qui la subissent.
Ce recueil s'ouvre sur les éclats recueillis du coup d'Etat manqué le 15 juillet 2016. Restituant son errance, slalomant entre salves mitraillées et explosions, Asli Erdogan rend hommage à l'homme anonyme qui lui a sauvé la vie et elle dresse, simultanément, un état des lieux effroyable.
Ailleurs, elle dénonce avec acuité la complicité coupable de ceux qui se taisent, la collusion entre les tortionnaires et ceux, dans son entourage immédiat (un commerçant de son quartier par exemple) dont le silence est une approbation tacite.
Il y a aussi une évocation, poignante, des proches ou amis qui ont écopé d'une incarcération à perpétuité ou sont morts en prison.
Elle va jusqu'à établir un parallèle entre Auschwitz et les crimes actuellement perpétrés en Turquie.
Comme remparts et bastions de résistance elle convoque, entre autres, la littérature, la poésie qui sauvent, au moins provisoirement, du désespoir.
Les beautés de la langue sont un gisement dans lequel elle puise du réconfort. Dire l'insoutenable ne répare ni ne soulage mais dire au plus juste est une lutte nécessaire, une façon de rendre justice.
Asli Erdogan elle-même use des ressources du lyrisme et sa langue, rythmée, luxuriante, émaillée d'éclats frappants, est d'une beauté souvent fulgurante. Beauté qui, loin d'outrager la douleur, lui restitue sa place, sa dignité entière.
BH
01/17
"Le dernier livre des enfants" de Ariane Dreyfus (Flammarion)
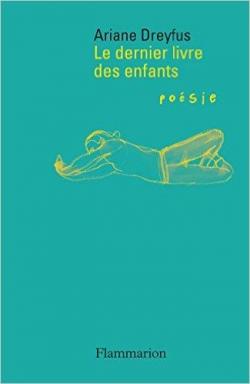 Selon
son propre
aveu, Ariane
Dreyfus se risque, dans ce recueil, hors de ses brisées, de son champ
exploratoire attitré. Elle ne cherche plus à dire les soulèvements du
corps et
de l'amour adulte, elle se penche sur les territoires de l'enfance et
de
l'adolescence à son orée, saisie dans des premiers frémissements. Deux
motifs
s'entrecroisent, deux gisements sont sollicités dans lesquels elle
puise
alternativement. D'une part, l'intrigue du roman de Richard Hugues "Un
cyclone à la Jamaïque" lequel met en scène des enfants embarqués par
des
pirates et, par ailleurs, des adolescents qui voient éclore leur
premier amour.
Selon
son propre
aveu, Ariane
Dreyfus se risque, dans ce recueil, hors de ses brisées, de son champ
exploratoire attitré. Elle ne cherche plus à dire les soulèvements du
corps et
de l'amour adulte, elle se penche sur les territoires de l'enfance et
de
l'adolescence à son orée, saisie dans des premiers frémissements. Deux
motifs
s'entrecroisent, deux gisements sont sollicités dans lesquels elle
puise
alternativement. D'une part, l'intrigue du roman de Richard Hugues "Un
cyclone à la Jamaïque" lequel met en scène des enfants embarqués par
des
pirates et, par ailleurs, des adolescents qui voient éclore leur
premier amour.
Dans la veine aventureuse se détache un personnage, celui d'Emily, dix ans, qui accueille dans son corps le monde marin et ses mystères et qui, par moments, se confond avec la grande poétesse éponyme, Emily Dickinson.
Quant aux adolescents aux prises avec leurs premiers émois, Ariane Dreyfus pose sur eux un regard d'une infinie tendresse.
Le risque pris est payant : en plongeant dans les eaux, d'abord glacées et qui saisissent le corps, d'un âge révolu, Ariane Dreyfus affine et affûte son écriture spontanément charnelle : l'attention qu'elle porte aux détails les plus infimes, aux pulsations les plus ténues, se fait d'autant plus vigilante et fructueuse. En résultent des textes d’une beauté cristalline, d'une vibrante précision, d'une clarté piquée de mystères, d'une sensualité captée à la source et d'autant plus bouleversante.
Les battements les plus secrets sont restitués avec une justesse confondante.
Ainsi :
"Tu
soulèves mon pyjama
Le ventre
La peau de mon ventre, tu n'attends pas
La réponse de mes bras
Fais-moi
Aimer la nuit en te rapprochant
La salive donne de fraîches lueurs
Aux baisers
La bonne
nouvelle s'articule"
BH 12/16
"Je crois qu'un jour" de Fabrice Guénier (Filigranes éditions)
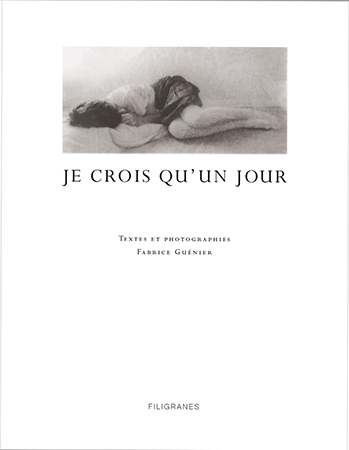 C'est
un recueil de
courts textes
qui voient s'afficher, en regard de chaque fragment, des photographies
en noir
et blanc lesquelles semblent des dessins tracés au fusain qui laissent
dans leur
sillage des traînées poudreuses et rêveuses.
C'est
un recueil de
courts textes
qui voient s'afficher, en regard de chaque fragment, des photographies
en noir
et blanc lesquelles semblent des dessins tracés au fusain qui laissent
dans leur
sillage des traînées poudreuses et rêveuses.
Ce sont des instants prélevés sur la tristesse ordinaire des jours et, semble-t-il, la radioscopie d'une rupture amoureuse, mais comme perçue à travers une buée et restituée avec une si grande délicatesse qu'on pénètre dans cette matière poétique à pas de loups, intimidé par l'élégance et la douceur de ce désespoir ouaté.
Pour autant, les textes n'ont rien de nébuleux : le trait est précis, percutant et d'une simplicité nue qui force le respect.
Il est question, donc, de l'aimée perdue, évoquée avec une ferveur éperdue, mais aussi d'une petite fille dont les gestes quotidiens magnétisent le jour et sont épinglés, saisis au vol, et précieusement conservés comme autant de talismans ou viatiques.
Il y a aussi, en passant, des hymnes rapides comme des saccades et presque des coups de cravache, des odes aux laissés-pour-compte, aux prostituées, aux éclopés croisés et brièvement aimés.
Et puis des instantanés qui disent "l'ultra-moderne-solitude", le féroce isolement contemporain.
C'est le journal de bord d'un homme sensible et seul qui croque en peu de mots des états qui parlent à tous. C'est un homme qui parle, en poète natif, une langue universelle.
Ainsi :
"Tout est fragile, tout est volé.
Je tombe,
ce n'est pas un hasard.
Il n'y a personne à prévenir."
"C'est si bruyant ici.
Comment pourrait-on dire ?
On ne lui laisserait pas une chance."
Les photos qui donnent à voir mieux ces textes poignants sont des épures, des ombres et des voiles : des fragments de nus féminins infiniment gracieux, un gant d'enfant tombé dans la neige, une tache d'encre sur un livre, un fouillis de branches dénudées, une silhouette floutée, les nervures d'une feuille d'arbre, un corps abandonné...
C'est beau, tout simplement, et c'est une idée de la pureté.
BH 12/16
"Beckomberga" de Sara Stridsberg (Gallimard)
 C'est
une approche
sans précédent
d'une matière tragique. C'est une matière veloutée et vaporeuse posée
sur une
chair saignante.
C'est
une approche
sans précédent
d'une matière tragique. C'est une matière veloutée et vaporeuse posée
sur une
chair saignante.
C'est un triple hommage que déploie ce texte: au père, funambule de la folie, à l'établissement psychiatrique dans lequel il séjourna de longues années, et aux soignants comme aux patients qui l'entourèrent et qui sont saisis dans toute leur poignante humanité.
C'est aussi un hymne à l'enfance confondue avec Beckomberga, l'asile suédois qui accueillit et pansa l'âme divagante du père.
Le texte se développe sur plusieurs axes, en motifs alternés et entrelacés.
Il y a les manifestations proprement dites de la folie paternelle, il y a la façon dont son entourage, intime ou médical, absorbait ladite folie et trouvait avec elle des accommodements viables, et il y a, sur un plan autre, l'évocation, historique, architecturale et scientifique, du bâtiment de Beckomberga : l'asile, en tant que lieu, est approché depuis son édification jusqu'à sa ruine.
Par touches successives, légères comme des ailes, l'auteur parvient à faire entendre comment c'était d'avoir un père fou dans la Suède des années 80 et 90. Comment elle a, épineusement, négocié avec cette réalité intangible. Elle procède en restituant, dans une chronologie bousculée, des scènes emblématiques.
Elle fait apparaître des personnages plus singuliers, loufoques et attachants les un que les autres. Il y a d'abord Lone, l'épouse et mère, presque immatérielle, diaphane, qui traverse le drame avec une grâce aérienne. Puis le psychiatre aux méthodes peu orthodoxes et qui parait vivre, lui aussi, sur le fil du rasoir, mais qui entoure ses patients d'une si rude et bienfaisante bonté fraternelle, qu'il ne peut qu'être absous de tout. Puis Sabina, la tendre amie déraillante, petit elfe espiègle et inspiré qui sera, pour Jim, le père de la narratrice, une alliée de tout premier ordre.
Grâce à ces figures et à d'autres encore, l'enfance trouée de l'auteur aura aussi été une sorte d'enchantement vaporeuse proche du rêve.
C'est du reste, l'impression, entêtante comme un parfum, qui subsiste à l'issue de la lecture : grâce aux volutes des phrases déployées en écharpes brumeuses, on est frappé par un charme qui nous tient en lisière de l'onirisme.
Une bouleversante réussite. Une langue superbe en forme de mélopée lancinante, de nébuleuse incantatoire.
BH
11/16
"L'homme au lion" de Henrietta Rose-Innes (Editions Zoé)
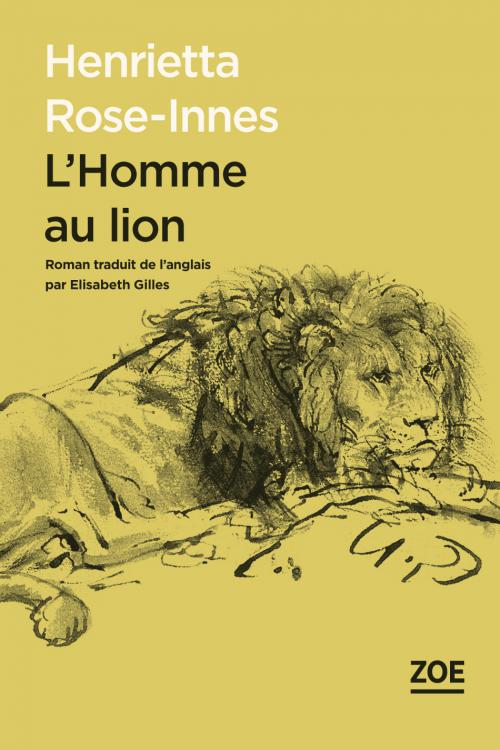 C'est
un texte
abrasif qui
s'avance sous des dehors soyeux. On peux croire qu'on a affaire à un
roman
traditionnel, une narration classique, mais l'illusion se dissipe vite,
elle
vole en éclats, pulvérisée par les glissements de sens, les ellipses,
les
gradations imperceptibles et les époques entrechoquées.
C'est
un texte
abrasif qui
s'avance sous des dehors soyeux. On peux croire qu'on a affaire à un
roman
traditionnel, une narration classique, mais l'illusion se dissipe vite,
elle
vole en éclats, pulvérisée par les glissements de sens, les ellipses,
les
gradations imperceptibles et les époques entrechoquées.
Stan, le narrateur, est un homme jeune qui traîne sa vie sans trop savoir qu'en faire. Son seul ancrage s'appelle Elyse, comédienne de son état, somptueuse, spectaculaire, et quelque peu castratrice qui a, incompréhensiblement, jeté son dévolu sur lui.
Stan végète donc plus au moins jusqu'au jour où il retrouve la trace de Mark, un ami d'enfance, un compagnon d'adolescence, figure tutélaire et charismatique, dont il fut autrefois très proche. Mark était employé dans un zoo et il gît actuellement dans le coma pour avoir été sauvagement attaqué par un lion, lequel fut, dans la foulée, abattu.
Magnétisé par ces "retrouvailles" singulières, Stan s'immisce peu à peu (et comme autrefois) dans la vie de Mark. Il prend bénévolement sa place au zoo, se rapproche dangereusement de sa petite amie azimutée cependant que ses rapports avec la sculpturale Elyse se dégradent. Dans le même temps, il renoue avec la mère, triplement éplorée, de Mark et se confronte progressivement avec de sanglants souvenirs occultés.
Au zoo, il est en charge de Sekhmet, la lionne veuve du lion meurtrier et abattu. Il entre, là aussi, dans un cercle magnétique : il est violemment attiré, il subit un envoûtement et noue avec la lionne une relation puissante, trouble, vénéneuse. On croit s'avancer sur les brisées de l'analyse psychologique classique or on est sans cesse débouté et propulsé en lisière du fantastique.
Les mots employés sont, en apparence, lisses mais ils s'articulent et interagissent de telle façon qu'on est sans cesse face à d'inédites aspérités, à de purs blocs poétiques.
Chaque page regorge de trouvailles et de sensualité.
Un texte qui, tout du long, tient en haleine et percute par l'inventivité et la rare beauté de la langue.
BH
11/16
"Jeux de vilains" de Iben Mondrup (Denoël)
 Voici
un texte qui
se
déploie au
fil de voix successives mais ce n'est pas un roman polyphonique
classique. Car
lesdites voix rendent moins compte d'un temps qu'elles couvrent que
d'un espace
qu'elles quadrillent et s'emploient à apprivoiser.
Voici
un texte qui
se
déploie au
fil de voix successives mais ce n'est pas un roman polyphonique
classique. Car
lesdites voix rendent moins compte d'un temps qu'elles couvrent que
d'un espace
qu'elles quadrillent et s'emploient à apprivoiser.
Soit une famille danoise qui débarque sur une île aux confins du Groenland. Les trois enfants prennent la parole à tour de rôle et disent, chacun à leur manière, la lutte qu'il faut mener pour exister sous ce ciel de glace et parmi les autochtones à la peau plus foncée que la leur.
Ce texte, cela dit, retrace aussi l'apprentissage et la traversée d'un âge : respectivement, selon les enfants, l'enfance, la préadolescence et l'adolescence. Il y a Björk, d'abord, fillette frondeuse, exigeante, goulue, qui noue des amitiés voraces, passionnelles. Puis Knut, vibrant, secret, tendre, d'une frémissante sensibilité, qui apprend à en découdre avec le manque foncier de justesse et de justice. Knut qui se collecte aussi avec la finitude et qui découvre, simultanément, ses soifs illimitées. De beauté et d'amour. Knut qui tisse une amitié éternelle, vit ses premiers émois amoureux et forme des pensées non pareilles et sans précédent. Enfin, il y a Hilde, l'aînée, superbe, impériale, impérieuse, l'élue du père, la favorite excessivement aimée. Hilde, frontale et violente, en apparence adoptée par les îliens, mais qui se heurte à l'étrangeté des autres et, notamment, à celle de son amoureux, le trouble, l'inquiétant Johannes.
Pour chacun des enfants, l'auteur crée une langue aux accents particuliers, aux inflexions singulières, une langue radicalement neuve qui rend compte de l'éclat, du jaillissement des sensations, et qui épouse la virginité de la pensée face aux découvertes inédites.
Ce texte s'écrit au fil de mots en apparence usuels, ordinaires, mais qui sont agencés de manière telle que les paresseuses habitudes sont bousculées et les perceptions révolutionnées.
Un tour de force doublé d'un enchantement.
BH
11/16
"Les chemins contraires" de Mariette Navarro (Cheyne éditeur)
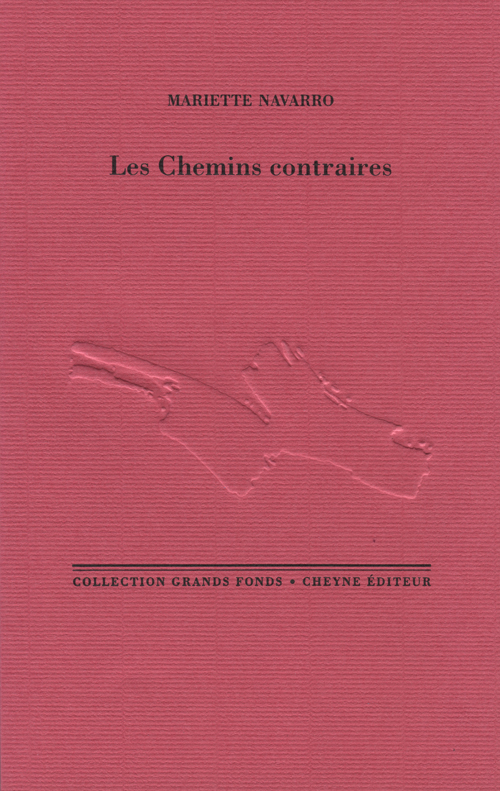 C'est
un texte
comme
une battue
rageuse. Un texte où les mots se percutent et les temps se télescopent.
C'est
une adresse impérative, une succession d'injonctions, déguisées en
questions, mais
péremptoires, toujours,
et castagnées. C'est un texte qui exige et n'accorde pas de répit.
C'est
un texte
comme
une battue
rageuse. Un texte où les mots se percutent et les temps se télescopent.
C'est
une adresse impérative, une succession d'injonctions, déguisées en
questions, mais
péremptoires, toujours,
et castagnées. C'est un texte qui exige et n'accorde pas de répit.
C'est un état des lieux accablant auquel succède une envolée allègre, solaire et jubilatoire.
Ce texte est composé de deux parties distinctes qui se présentent comme des hypothèses, des options ou propositions de vie.
La première partie décline les états et modalités de ceux qui vivent sur un mode docile, soumis et désubst antifié. Deux graphies alternent : l'italique qui met en jeu et en scène un "ils" indéfini et représente l'infra humanité réduite à seulement obéir, et un "tu" injonctif sur qui pleuvent des adresses comminatoires, des impératifs auxquels se plier sans sommation. Vies balisées et fliquées dans un territoire quadrillé et barbelé.
Le second volet est un contrepoint salubre et salvateur. Soudain, au cœur de ce brouet indistinct et écrasé, se lève un homme, un Il fantasque et vibrionnant qui oppose sa joie foncière et sa liberté inaliénable à toute tentative de réduction et d'incarcération. Le texte devient alors insurgé, il se mue en traité d'insoumission à l'usage des âmes séditieuses qui ont la vie chevillée au corps.
Dans les deux parties du diptyque, la langue, précise, martelée, incantatoire, qui colle au plus près des sensations, fait merveille.
Une lecture salutaire en ces temps délétères.
BH 07/16
"Gare d'Osnabrück à Jérusalem" de Hélène Cixous (Galilée)
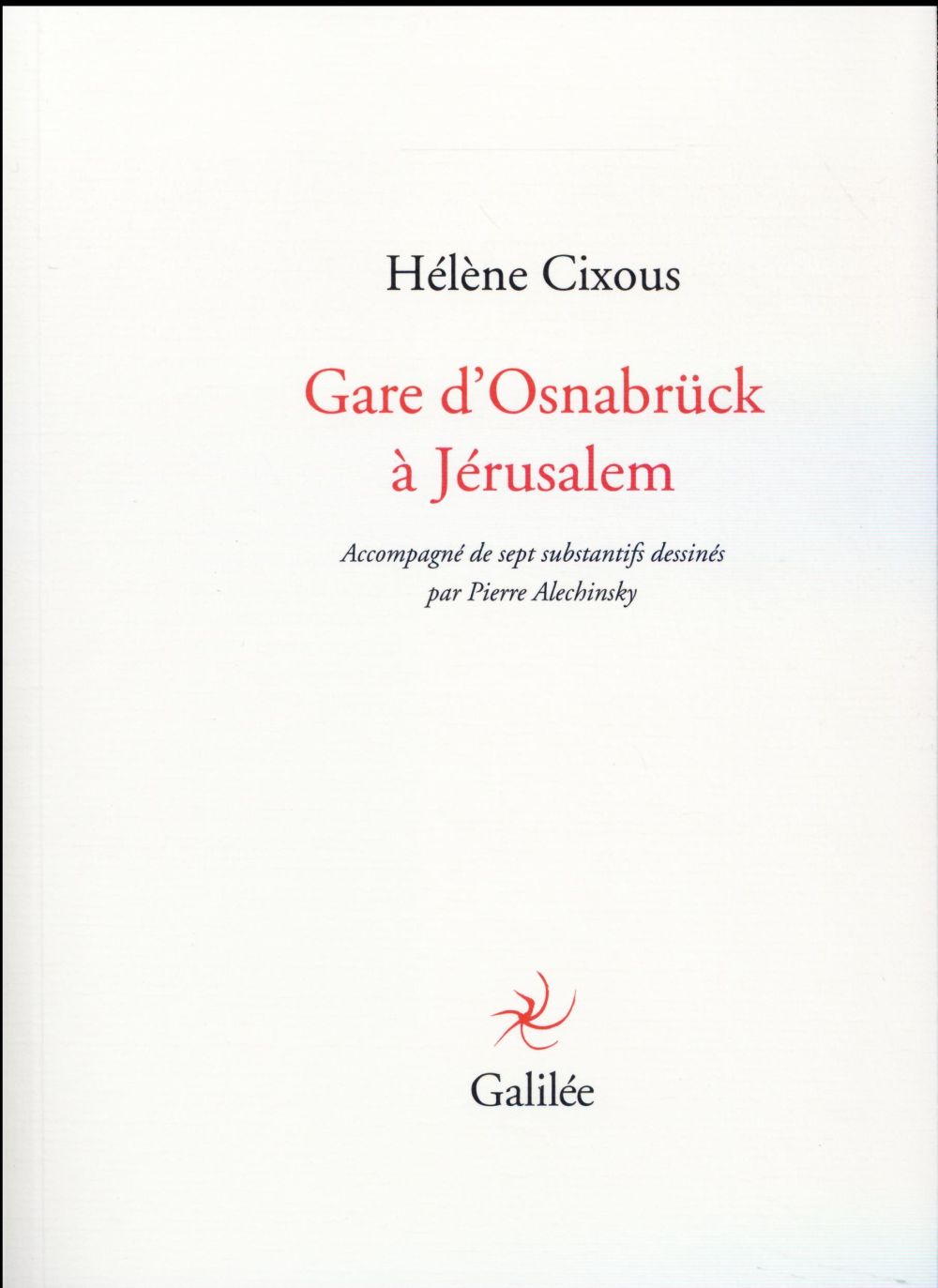 C'est
un livre d'heures
nocturnes, presque posthumes, et qui, pourtant, délivre une étrange et
puissante lumière. C'est le compte-rendu d'une quête, d'un voyage à
caractère
mystique et mythologique. C'est un pacte de haute exigence conclu avec
soi-même
et avec la mémoire vive d'une lignée meurtrie car Hélène Cixous, à
travers ce
texte, se "rend à un ordre venu de sa plus haute antiquité
intérieure". C'est Jérusalem et Osnabrück, pôles névralgiques et
pierres
angulaires, villes confondues, visées par le même élan rageur et
réparateur.
C'est
un livre d'heures
nocturnes, presque posthumes, et qui, pourtant, délivre une étrange et
puissante lumière. C'est le compte-rendu d'une quête, d'un voyage à
caractère
mystique et mythologique. C'est un pacte de haute exigence conclu avec
soi-même
et avec la mémoire vive d'une lignée meurtrie car Hélène Cixous, à
travers ce
texte, se "rend à un ordre venu de sa plus haute antiquité
intérieure". C'est Jérusalem et Osnabrück, pôles névralgiques et
pierres
angulaires, villes confondues, visées par le même élan rageur et
réparateur.
C'est un voyage aussi fantasmatique que réel, où passé et présent se blessent et se couturent mutuellement.
C'est la mémoire à vif qui balaye et défigure chaque instant. C’est une approche de la ville par la topographie, par les temps télescopés, et par la prescience hypnotique.
C'est un rite qui convoque la mère morte et tend à l'accroître d'une ultime offrande. Hélène Cixous effectue, en allant à Osnabrück, le voyage, indéfiniment reporté, qui devait la porter sur les traces de la jeunesse allemande de sa mère. Sur les traces d'un destin familial massacré et passé sous silence. Il s'agit d'aller à la rencontre d'une histoire taboue et de la débusquer. Hélène Cixous rend visite aux fantômes de sa famille et, à travers ceux qu'elle rencontre, c'est l'histoire, secrète et publique, et c'est l'innommable qui la percutent de plein fouet.
Et, une fois encore, la langue de Cixous, qui ne recule devant rien, qui prend en charge le plus haut péril, rend compte, à travers ses méandres, volutes ondoyantes, ses voltes et courts-circuits sidérants, de ce qui, en principe, ne peut se dire.
La langue médiumnique, émaillée d’éclats cocasses, en prise directe sur l'inconscient et le viscéral, retrace une quête, à la fois originaire, substantifique et ultime, sous la forme de chancellements intensément incarnés, de fragments arrachés au non-sens et de fulgurantes saccades intimes qui éblouissent.
BH 06/16
"Le Détrônement de la mort" de Hélène Cixous (Galilée)
 Hélène
Cixous a
écrit, avec
"Le Détrônement de la mort", autrement intitulé "Journal du
Chapitre Los", un antécédent, une pièce liminaire apportée
postérieurement
au dossier dudit "Chapitre Los". Lequel "Chapitre Los"
consistait en une remémoration, on ne peut plus vivace, d'une période
amoureuse
chargée, dense, cataclysmique.
Hélène
Cixous a
écrit, avec
"Le Détrônement de la mort", autrement intitulé "Journal du
Chapitre Los", un antécédent, une pièce liminaire apportée
postérieurement
au dossier dudit "Chapitre Los". Lequel "Chapitre Los"
consistait en une remémoration, on ne peut plus vivace, d'une période
amoureuse
chargée, dense, cataclysmique.
Le présent "Détrônement de la mort" se distingue en ce qu'il s'est imposé comme nécessaire mise au point et au jour, le 'Chapitre Los" à peine achevé, et en ce qu'il concentre sur la figure de l'amant Carlos. L'amant mort qui irrigue ces pages d'une force de vie peu commune.
Comme toujours, chez Hélène Cixous, le texte progresse par blocs de sens et de sensations dont l'agencement s'opère selon une logique secrète et toute organique.
Carlos y apparaît comme une figure absolument rayonnante qui continue, au-delà du temps imparti, à diffuser joie, élan, espoir et foi.
Il est question de lettres inespérément conservées, de l'impact percutant des reliques, de la place (primordiale) accordée par l'auteur au rire dans ses relatons amoureuses... Apparaissent aussi les silhouettes, plus ou moins furtives, des autres amants (notamment celui avec lequel on ne riait pas et qui fut, pour cela, répudié), des enfants, de la mère...
Les écrivains fécondants, aussi, sont cités et présents.
Mais il s'agit surtout, comme chaque fois, de roulements et torsions de la langue, de plongées vertigineuses dans tout ce qui sous-tend et fonde la langue sans pareille d'Hélène Cixous.
Car on n'aborde pas aux rivages d'Hélène Cixous. On est, sans ménagement, immergé dans un brouet, un maelström violent, un alambic en perpétuelle surchauffe, un laboratoire génial dont le surrégime est la loi et qui accouche de textes médiumniques et grisants. Hélène Cixous, en ses textes, témoigne d'un inframonde et d'une transcendance verbale. Textes qui s'écrivent en-deçà et au-delà des mots de la tribu, textes qui bafouent allégrement la langue commune et nous sont des pistes pionnières et salvatrices.
BH 06/16
"Point d'autre livre que le monde" de Leah Hager Cohen (Christian Bourgois)
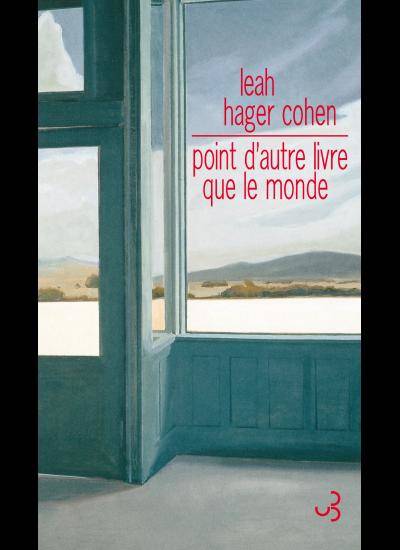 C'est
une quête, non
pas
amoureuse mais aimante, aimantée, une enquête déchirée, d'un type très
particulier, qui court le long de ces pages.
C'est
une quête, non
pas
amoureuse mais aimante, aimantée, une enquête déchirée, d'un type très
particulier, qui court le long de ces pages.
C'est un amour en forme de dédale et de miroir déformant. C'est une exploration, gracieuse, pénétrante et tendre, des conditions et des limites de la liberté.
C'est un ballet ambigu et envoûtant qui met en scène deux duos, deux binômes composés d'un frère et d'une sœur. Des alliages se produisent entre les fratries, des pactes se scellent qui rendent la situation confuse et presque inextricable.
Il y a d'abord Ava et Fred, enfants tardifs de Nell, théoricien marginal de l'éducation qui choisit d'élèver sa progéniture à l'écart du monde, au sein de la nature sauvage et selon les principes d'une liberté sans frein. En cours d'enfance, Ava et Fred se découvrent de nouveaux voisins, les Manceau, qui se rallient un temps aux méthodes de Nell. Kitty, la fille des Manceau, deviendra brièvement l'élève de Nell et durablement l'amie d'Ava. Quant à Dennis, le frère aîné de Kitty, il épousera Ava.
L'enfance est mouvementée, marquée, notamment, par les écarts et esclandres de Fred lequel s'avère être un enfant "différent", dérangeant, plus qu'étrange et absolument non soluble dans la société.
Ce roman débute alors qu'Ava, adulte, s'apprête à rendre visite à Fred, incarcéré pour le meurtre présumé d'un enfant. Ava, singulière, obstinée et fragile, est intimement convaincue de l'innocence de son frère et entend la faire éclater au grand jour.
Les chapitres alternent retraçant, pour les uns, des épisodes saillants de l'enfance et, pour les autres, la quête acharnée et essoufflante d'Ava. Grandie sous la même gouvernance, ayant subi le même conditionnement fanatique et forcené, Ara a développé, vis-à-vis de Fred, plus qu'une proximité : une quasi gémellité dans l'étrangeté. Elle est convaincue qu'elle est seule capable de le déchiffrer et de lui restituer son innocence originelle et foncière. Pourtant, à la faveur de cette épreuve, elle se découvre essentiellement autre au sein de cette proximité aussi malade que belle.
C'est un texte qui tourne au vertige tant il brasse des questions substantielles qui, sans trêve, s'entrechoquent. Celles, par exemple, de la responsabilité, du poids de l'éducation et du conditionnement, des pouvoirs et des limites de l'amour et de l'amitié.
Les scènes prélevées sur l'enfance des protagonistes célèbrent une nature foisonnante, rebelle comme les personnages, et sont d'une beauté et d'une sensualité prodigieuses. La langue regorge de trouvailles poétiques.
Un récit ambitieux, maîtrisé, dont les enjeux complexes et la langue charnelle fascinent.
BH 05/16
"Rivière fantôme" de Dominique Botha (Actes Sud)
 C'est
un livre qui
donne la
nostalgie d'une enfance qu'on n'a pas eue. Tout baigné qu'il est du
sang de la
perte, frappé d'un sceau inconsolable. Mais avant la mort annoncée ou
pressentie, il y eut une vie. Une enfance, une adolescence qui furent,
elles,
somptueuses, perfusées de beauté à n'en plus finir.
C'est
un livre qui
donne la
nostalgie d'une enfance qu'on n'a pas eue. Tout baigné qu'il est du
sang de la
perte, frappé d'un sceau inconsolable. Mais avant la mort annoncée ou
pressentie, il y eut une vie. Une enfance, une adolescence qui furent,
elles,
somptueuses, perfusées de beauté à n'en plus finir.
Ce texte c'est, sculpté par Dominique Botha, le tombeau de Paul Botha, son frère génial et suicidé. Mais c'est aussi une longue litanie incantatoire qui célèbre les splendeurs d'une enfance en Afrique du Sud, au sein du Veld et d'une nature luxuriante.
Paul et Dominique, flanqués d'une nuée de frère et sœurs, grandissent dans un fastueux et vaste domaine administré par leur famille depuis des générations. Dominique est témoin des démêlés de ses parents avec les autorités et de leurs tentatives pour composer avec une situation brûlante puisqu’il s’agit pour eux de rétablir l'égalité entre noirs et blancs. Mais, dans l'enfance, tout ce qui est de nature politique parvient à la narratrice comme amorti, tamisé, presque désamorcé. Ce qui domine, c'est l'intense jubilation de vivre, sans entraves dans l'Orange Free State, une vie gorgée de sensations intenses et parfaitement assouvissantes. C'est aussi l'émerveillement face à une beauté foudroyante, toujours recommencée, et que rien n'entache.
Les premières ombres viennent de Paul, le frère étrange et dérangeant. Paul, adolescent extrême, extrêmement doué, écorché dans la même mesure, révolté et foncièrement inassimilable. Paul qui oscille entre créations artistiques inspirées et conduites autodestructrices. Et qui se heurte aux fins de non-recevoir de ses parents : ces derniers, bien que politiquement progressistes, sont tenants d'une éducation traditionnelle et se montrent intransigeants quand Paul commence à dériver (désertion, tentative de suicide, toxicomanie).
La singularité de ce texte réside dans le double parcours que Dominique narre simultanément. Le sien propre, son éclosion modérément heurtée mais, au fond, harmonieuse. Et, en contrepoint, la trajectoire chaotique de Paul, comète enflammée qui consume et corrode sa vie. La langue qui colle au plus près des sensations crues, est une merveille de délicatesse et de sensualité.
Et ce texte réussit ce tour de force : Dominique Botha évoque une fracture constitutive de sa vie sur un ton presque détaché en isolant des blocs de sensations, en s'attachant aux descriptions, frémissantes et ciselées.
On est d'autant plus admiratif et bouleversé.
BH
05/16
"Un été polaire" de Anne Swärd (Buchet-Chastel)
C'est un livre à l'envers. Le commencement exhale déjà un sauvage parfum de dénouement. Tout parait scellé, comme poignardé par une lumière post apocalyptique. C'est aussi un livre en diagonale: tout advient de biais et l'étrangeté qui baigne chaque page brouille tous les repères.
 C'est
Kristian, le
fils prodigue
qui, après avoir longuement déserté, regagne le bercail et retrouve sa
demi-sœur, Kaj, jeune bâtarde auréolée et potentiellement radioactive.
Kaj est
le pivot incertain de ce récit flou, flottant en eaux troubles. Kaj,
demi-sœur,
semi-sorcière qui exerce sur Kristian pouvoirs et fascination et semble
opérer,
sur lui et les autres, par d'invisibles passes magnétiques, de longs
envoûtements. Kaj, bancale, décrochée, féroce, enfantine, animale,
imprenable,
irrésistible. Redoutable d'innocence torse.
C'est
Kristian, le
fils prodigue
qui, après avoir longuement déserté, regagne le bercail et retrouve sa
demi-sœur, Kaj, jeune bâtarde auréolée et potentiellement radioactive.
Kaj est
le pivot incertain de ce récit flou, flottant en eaux troubles. Kaj,
demi-sœur,
semi-sorcière qui exerce sur Kristian pouvoirs et fascination et semble
opérer,
sur lui et les autres, par d'invisibles passes magnétiques, de longs
envoûtements. Kaj, bancale, décrochée, féroce, enfantine, animale,
imprenable,
irrésistible. Redoutable d'innocence torse.
C'est l'histoire, fragmentée, d'une famille éclatée. Les scènes se déroulent, pour une part, sur une île suédoise frappée par les ardeurs de l'été. Kristian réintègre la demeure familiale à la faveur d'un double départ : celui de sa mère, Ingrid, et de son frère Jens. La mère et le fils, formant un étrange attelage, sont censés partir ensemble en Floride pour jouir d'un séjour gagné par Kaj à la loterie ou assimilé. Kristian revient parce que Jens fait place nette. Kristian fut autrefois proscrit par sa propre mère, ayant été surpris par elle en train de copuler avec Lisbeth, la séduisante épouse de Jens. Cette famille déglinguée est sommée et complétée par Jack, le père absent et radié. Car, un beau, jour, jadis, surgit à la nuit tombée une femme inconnue, portant un bébé dont elle certifia qu'il était de Jack. Et qu'elle confia audit Jack sans autre forme de procès. C'est ainsi que Kaj, rapidement adoptée par une Ingrid d'abord rétive, fît une entrée remarquée. Mais l'intrigue et la complexité des relations importent moins que le ballet sensoriel, la chorégraphie, ondoyante et suggestive, qui se déploie dans chaque scène. Ces fragments successifs sont gorgés d'une sensualité brûlante et inquiète et tous sont orchestrés, en sous-main, par une Kaj à peine consciente de ce qu'elle déclenche. Une ambiguïté jamais levée imprègne tous les rapports humains et chaque moment du récit.
Kristian se retrouve, seul, face à une double impossibilité : Kaj qui le happe, le vampirise, et à qui il ne peut résister, et Lisbeth qui cristallise ses désirs secrets.
Peu à peu, tous les membres de cette parentèle décousue et désaccordée réapparaissent. Kaj, la vénéneuse candide, distille le poison ingénu sécrété par son âme déraillante, et l'inéluctable se produit.
Un prétendu roman familial complètement déstructuré, écrit au ras de tout, dans une langue épidermique et frissonnante.
BH
04/16
"Pense à respirer" de Janice Galloway (Cambourakis)
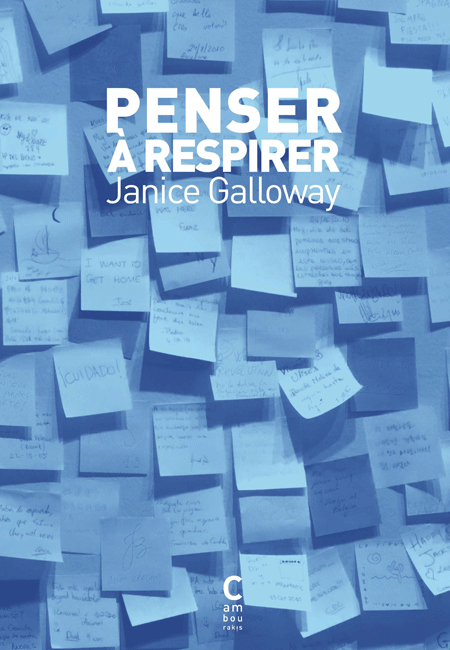 Ce
n'est pas un livre, c'est
un
territoire saignant, un pan de vie à vif, un cri, mais dansé et
virevolté.
C'est un territoire hurlant étrangement quadrillé, composé de pas de
côté où le
pire peut devenir sautillant.
Ce
n'est pas un livre, c'est
un
territoire saignant, un pan de vie à vif, un cri, mais dansé et
virevolté.
C'est un territoire hurlant étrangement quadrillé, composé de pas de
côté où le
pire peut devenir sautillant.
C'est un bloc de vie arraché à l'expérience du deuil. C'est un thrène qui casse tous les codes du chant funèbre, qui flirte dangereusement avec la cocasserie, l'incongruité, et n'en est que plus poignant.
C'est un patchwork, une mosaïque bourgeonnante, un texte taillé et couturé de partout, constitué de ressassements, de descriptions à fleur de peau, de listes et énumérations, de dialogues ahurissants (il s'agit, le plus souvent, d'entretiens abasourdissants avec les psychiatres et thérapeutes), de coupures de presse, de fragments d'horoscopes...
Le texte oscille, essentiellement, entre deux pôles : le récit, séquencé, du drame (la mort de l'amant par noyade) et le compte-rendu scrupuleux des effets dudit drame sur la narratrice. Mais l'auteur ne se contente pas d'alterner classiquement passé et présent de l'écriture, elle utilise tous les supports à sa disposition pour rendre compte de la difficulté à consigner ce qui relève de l'incommunicable. En outre, le ton est tout sauf classique et prévisible, lui aussi : la tragédie est approchée sous ses angles les plus inattendus : Janice Gallaway fait saillir tous les aspects ironiques et déjantés de la situation et cependant les descriptions sont d'un vérisme déchirant.
Voici donc une femme qui a perdu (accidentellement?) l'homme qui justifiait sa vie et la faisait tenir ensemble, une femme qui, à la suite de cette perte, sombre dans le plus profond désespoir mais l'écrivain, en elle, parvient à transmuer l'horreur en déambulation presque joyeuse.
Grâce à cet angle d'attaque inattendu, l'auteur nous donne accès à des aspects inédits, inusités, du deuil. Elle met au jour des états interstitiels ou mélangés (la stupeur mêlée à la colère, l'amusement mêlé à l'incompréhension, une forme paradoxale de plaisir engendré par la douleur, la peur alliée au soulagement, l'étonnement vierge face à toute chose) qu'on n'a pas coutume de débusquer.
C'est un tour de force doublé d'un tour d'adresse d'une infinie délicatesse.
Une bouleversante réussite.
BH
03/16
"Quelque chose approche" de Christiane Veschambre (Les Arêtes éditions)
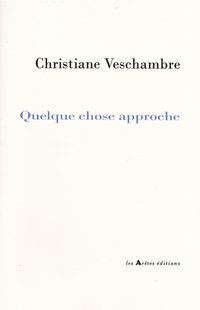 Ce
sont des textes de
ballerine
et de ballet. Des textes étirés et de pointes. Des textes sur la pointe
des
pieds. Elégants, élancés, et qui ne touchent pas terre.
Ce
sont des textes de
ballerine
et de ballet. Des textes étirés et de pointes. Des textes sur la pointe
des
pieds. Elégants, élancés, et qui ne touchent pas terre.
Ce sont des textes comme des battements d'antennes, des empreintes d'élytres, des traces délicates, arachnéennes, de pattes impondérables. Ce sont des vers comme en passant (et pourtant minutieusement ouvragés et même orfévrés) qui disent sans jamais appuyer mais saisissent le cœur et frappent immédiatement la conscience. Quelques mots déposés qui disent, l'air de rien, l'essentiel et emportent, dans un lyrisme sobre, l'adhésion.
Ce sont des états déchirables, des vibrations fines, inaudibles au commun des mortels, et qui relèvent presque de l'infrason.
Ainsi :
"Une corneille horizontale
traverse le ciel
il me semble faire beau
entre les côtes
le cœur amer
Relance un sang
pas propre
pour la journée"
"Se faire passereau
sept grammes pour toute une vie
combien les minuscules poumons ?
dans la poitrine une enclume
prend ses quartiers
d'hiver"
"l'amour cherche
espace
entre glaise et pierres
s'approche
la vaste bête
tient contre elle
embrassée
la demeurée du chemin creux."
"amour vaste bête
tenue à distance
son souffle
de l'autre côté
des hauts murs de parpaing
entre lesquels on arrose
le petit vivre
a toujours soif
craint le respir puissant
de la bête amour qui rôde
demande asile
et ne saurait tenir entre nos murs"
"la poche d'eaux amères
la poche d'eau soulevante
hontes
grâces
rendues
battements de l'être"
Le temps qui pèse, la vie à soulever, l’amour qui, dans l'affolement et l'imminence de sa propre perte, cherche, crie, implore, toujours.
Mais sans dire. Et sans bruit. A mots tranchés, poncés et rabotés jusqu’à la trame quintessenciée.
Et le grand mystère inépuisable quelquefois entrevu. "battements de l'être", exactement.
BH
12/15
"Des mots jamais dits" de Violaine Bérot (Buchet-Chastel)
 Voici
un conte
gothique tamisé,
une forme de tragédie classique
filtrée
par le "on" indistinct qui la rapporte et qui inclut aussi bien le
lecteur que le chœur antique, témoin et arbitre du carnage.
Voici
un conte
gothique tamisé,
une forme de tragédie classique
filtrée
par le "on" indistinct qui la rapporte et qui inclut aussi bien le
lecteur que le chœur antique, témoin et arbitre du carnage.
C'est l'histoire d'une enfance singulière qui fore et déforme l'héroïne. Elle est le fruit d'un amour hors- normes, presque contre-nature. Son père et sa mère, en effet, se vouent une passion extrême, absolue. Le père, en particulier, élève sa femme au rang d'icône et d'idole qu'il vénère. Cette adoration exclusive aurait dû, en toute logique, exclure aussi l'enfantement, la descendance. Or, la mère, après avoir vécu son premier accouchement comme un martyr, un écartèlement, une dépossession, se met à nidifier à n'en plus finir. L'hypothèse qu'avance l'héroïne est la suivante : l'enfantement est un aiguillon qui ravive la passion du père car il redoute à chaque fois de perdre son épouse adulée.
L'héroïne est l'aînée de cette nombreuse fratrie et elle tiendra bientôt lieu de mère substitutive à ces frères et sœurs qui ne cessent de surgir. La mère en effet, princesse à plein temps, se mue, au fil du temps, en belle au bois dormant. Elle passe ses jours alitée cependant que le père, confit en dévotion, la veille et que l'aînée se retrouve en charge de toutes les tâches fastidieuses et quotidiennes.
L'héroïne devient une enfant puis une adolescente grave et mystérieuse avec qui le père entretient de très ambivalents rapports. L'adolescence est l'âge des cristallisations et en l'héroïne se développe une maladie potentiellement mortelle dont elle sera sauvée in extremis, notamment par l'extrême délicatesse dont l'entoureront "les amoureux de quinze ans", une poignée de garçons sensibles et protecteurs. La suite du texte déroule les conséquences de cette enfance dévoyée, difforme. Les répercussions seront parlantes, frappantes, palpables et désastreuses dans le rapport que l'héroïne entretiendra avec son corps et avec les hommes.
Par petites touches vibrantes, elliptiques, subtiles, Violaine Bérot dépose des mots, des images, des scènes qui composent les fondements d'une vie dont les bases furent sapées.
De même que l'enfant assiste, entre fascination et effroi, à l'amour dément qui unit ses parents, le lecteur assiste, le cœur serré, au déploiement heurté de cette vie empêchée.
C'est un conte cruel narré dans une langue limpide et d'un lyrisme feutré.
Une lecture poignante dont on ressort hanté.
BH
12/15
"Extrêmes et lumineux" de Christophe Manon (Verdier)
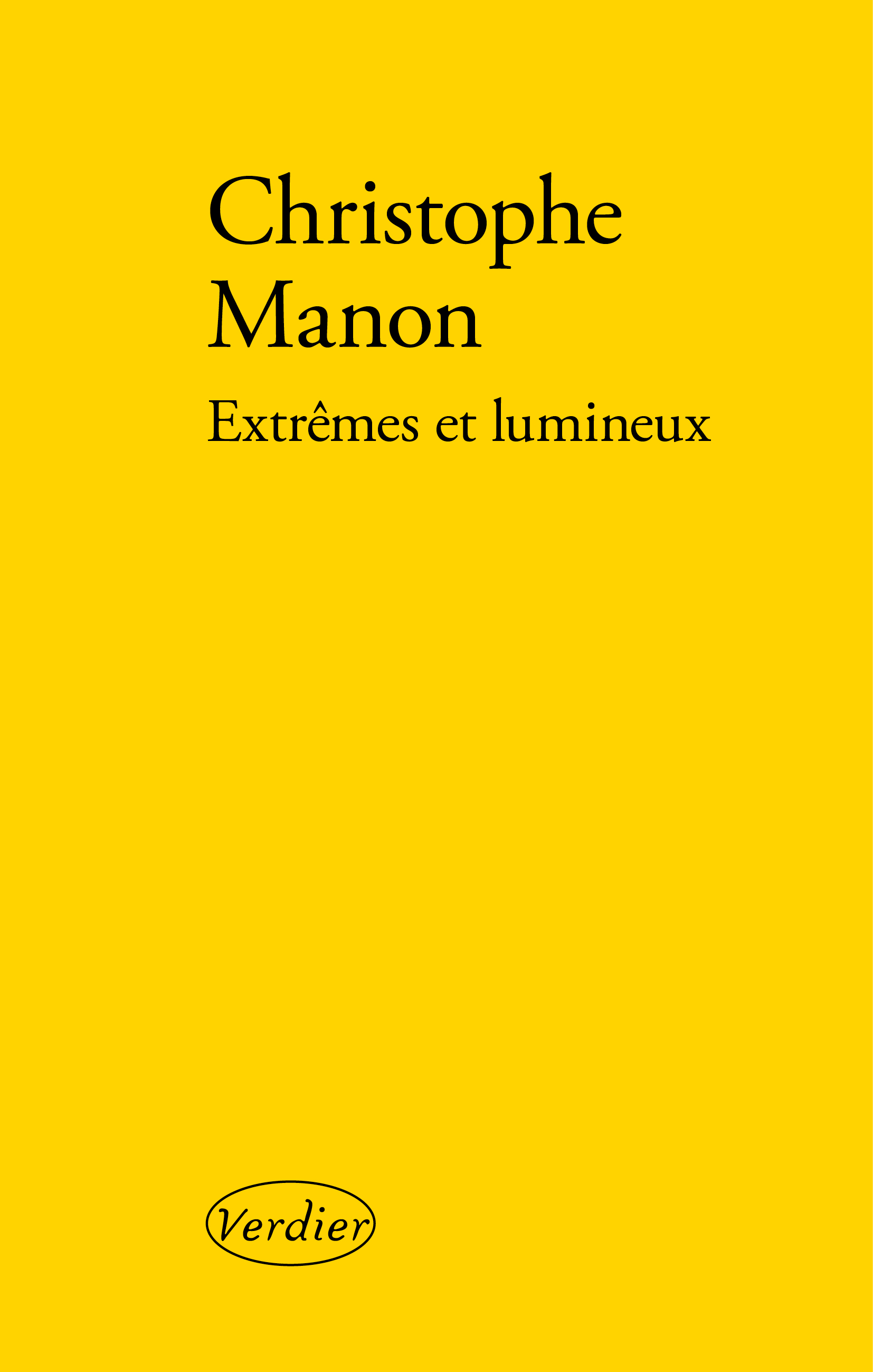 C'est
un texte
enchâssé,
sourdement incantatoire et lancinant. Des fragments juxtaposés, de
sensations
et de souvenirs, comme les blocs arrachés d'une banquise
mémorielle.
C'est
un texte
enchâssé,
sourdement incantatoire et lancinant. Des fragments juxtaposés, de
sensations
et de souvenirs, comme les blocs arrachés d'une banquise
mémorielle.
C'est une seule phrase, litanique, scandée, lyrique, qui se divise en fractions aléatoires et prend des virages imprévisibles. Ces fragments se succèdent et se rattachent les uns aux autres par un procédé singulier : la voix profératrice sectionne un mot à l'issue d'un lambeau de texte et la part manquante dudit mot constitue le début de l'extrait suivant, lequel développe un tout autre sujet.
Cette voix ressassante qui charrie une charge existentielle puissante, épaisse, alluviale, nous parle, en vrac, d'une parentèle de forains ressuscités, d'aïeux figurant sur des photos jaunies et exhumées, de voyages effectués en voiture, en avion, et des sensations afférentes, d'une grand-mère très aimée, de phrases énoncées sur un mode imprécatoire et qui conditionnent une vie entière, d'états de conscience modifiée, de moments de transes hallucinatoires, des empreintes indélébiles et des moments de grâce remontés de l'enfance, des premiers émois, d'étreintes fauves et débridées saturées d'une excédante sensualité...
C'est une prose hantée, affolée, qui brasse toute cette matière impure, profondément charnue et charnelle. C'est une succession de figures et figurations acrobatiques, des scènes ou des mises au jour profondément incrustées dans les fibres sensibles du narrateur.
C'est de la matière organique mise en mots.
C'est un tour de force et un texte entêtant.
BH 12/15
"Le voyage infini" de Malcolm Lowry (Buchet-Chastel)
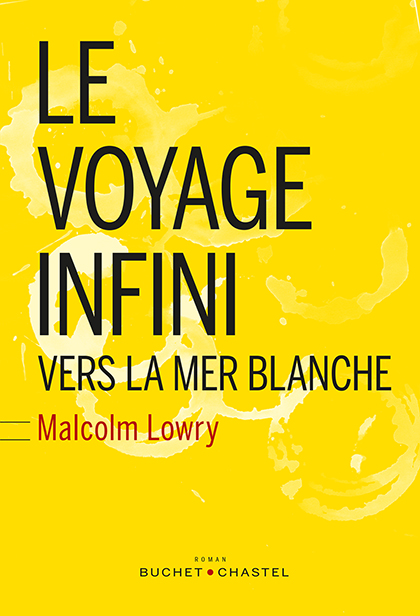 Y
a-t-il un texte
de
Malcolm
Lowry qui ne nous soit pas parvenu miraculé, ayant réchappé, d'extrême
justesse, aux flammes ? Il n'en est pas, en tout cas, qui ne soit
brûlant et
cela, bien que sa prose soit une drôle de pyromane, une incendiaire
d'un genre
particulier, qui gèle sensations et sentiments tout en les exacerbant.
Y
a-t-il un texte
de
Malcolm
Lowry qui ne nous soit pas parvenu miraculé, ayant réchappé, d'extrême
justesse, aux flammes ? Il n'en est pas, en tout cas, qui ne soit
brûlant et
cela, bien que sa prose soit une drôle de pyromane, une incendiaire
d'un genre
particulier, qui gèle sensations et sentiments tout en les exacerbant.
Il en est ainsi dans "Le voyage infini", texte inachevé et récemment exhumé.
"Le voyage infini" se présente, a priori, comme un roman de formation classique qui procède et progresse par vagues discursives enveloppantes, entêtantes, irritantes parfois.
On est témoin de l'évolution d'un jeune étudiant, SigbjØrn, qui, partant de sa ville d'origine et port d'attache, Liverpool, finira par s'embarquer à Preston en direction d'Arkhangelsk, sur la mer blanche. Entretemps, il sera allé de chocs en ruptures, affrontant, à intervalles réguliers des infortunes de nature diverse. Il doit faire face à la débâcle et à l'opprobre qui frappent son père, capitaine de navire échoué. Il est ensuite confronté au suicide son frère Tor, raisonneur, péremptoire, orateur de haute volée mais jeune homme secrètement brisé et pétri d'un profond désespoir existentiel. SigbjØrn rompra enfin avec Nina, sa fiancée fantasque qui se partageait entre les deux frères. Il nous donne aussi à lire une partie de sa correspondance : les lettres (tout ensemble soulevées par un idéalisme juvénile et empreintes d'un pessimisme radical), jamais expédiées, qu'il adresse à l'écrivain norvégien William Erikson (lequel fut, pour Malcolm Lowry, une figure tutélaire de premier ordre).
L'intérêt majeur de ce roman tient dans son rythme, sa scansion proprement maritime qui se déploie soit au fil d'éblouissantes descriptions soit au cours des échanges (dont la portée est souvent mystique) qui opposent le héros à ses interlocuteurs.
On est pris, chaque fois, dans des périodes qui enflent sous une puissante poussée organique et qui brassent toutes les tentations, tribulations et questions métaphysiques qui agitent Malcolm Lowry.
On peut aussi, bien entendu, lire ce texte comme une prémonition recelant tout ce qui fera la matière d' "Under the Volcano" (la fascination pour la mer, pour les joutes spéculatives sans fin, les thèmes de la difficulté d'être, de l'alcool, de l'impossibilité de vivre, de l'amour brisé...), mais ce récit vaut d'abord en soi et par la houle ivre d'elle-même, éperdument éprise d'absolu, qui s'y déploie et nous emporte.
Il faut s'immerger dans cette prose chaloupée, déhanchée, "plus marine que la mer."
BH11/15
"Corollaires d'un vœu" de Hélène Cixous (Galilée)
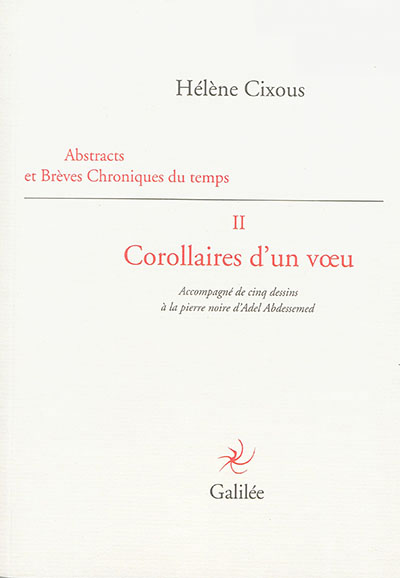 Hélène
Cixous nous
convie,
directement et sans ciller, au cœur du mystère. Elle place sur un plan
d'égalité les vivants et les morts et dialogue de la même façon avec
les uns et
les autres. Plus précisément, elle nous initie à ses morts tant aimés
qui
irriguent profondément, et toujours davantage, sa vie. Se reportant à
ses cahiers
des années 60 et au-delà, elle fait surgir une époque, des silhouettes,
une
atmosphère, trépidante, des amours, brûlantes, des amants et des
amantes.
Hélène
Cixous nous
convie,
directement et sans ciller, au cœur du mystère. Elle place sur un plan
d'égalité les vivants et les morts et dialogue de la même façon avec
les uns et
les autres. Plus précisément, elle nous initie à ses morts tant aimés
qui
irriguent profondément, et toujours davantage, sa vie. Se reportant à
ses cahiers
des années 60 et au-delà, elle fait surgir une époque, des silhouettes,
une
atmosphère, trépidante, des amours, brûlantes, des amants et des
amantes.
Outre la mère, qui toujours surplombe et étend son règne, des figures saillent et se détachent. En particulier Isaac, l'amant capital qui prononça le vœu et scella les destins autour d'une impossibilité.
Par la grâce de son écriture ductile, fluante, Hélène Cixous se joue de toutes les frontières. Ainsi Isaac et son vœu deviennent-ils contemporains, consubstantiels.
Ce vœu va conditionner la vie de l'amante (alias H. Cixous) bien au-delà de sa date d'expiration ou de péremption. Il va aussi modifier, et attaquer dans leurs fondements, l'existence des très proches, en particulier les autres amants (lesquels ne sont pas seulement substitutifs d'Isaac mais entrent quand même en compétition avec lui) : John, grande passion rapidement consumée et Carlos, amour bien plus durable.
Ce vœu, donc, qui est l'axe rotatif du texte (et dont les conséquences affectent tous ceux qui gravitent autour de l'amoureuse) est le suivant : Isaac, ayant vécu la maladie de sa fille comme un avertissement divin, fait promettre à Hélène, en guise d'expiation, de suspendre tout contact entre eux sur une durée d'un an.
La vie d'Hélène s'en trouve, intégralement, et irréversiblement, remaniée. C'est donc l'énigme de ce vœu, son impact, ses "corollaires" qui constituent la matière du texte et c'est cette même énigme que l'auteur, quelques décennies plus tard, s'attache à explorer.
Ce faisant, Hélène Cixous nous introduit dans un fascinant ballet, un incessant va-et-vient entre le passé et le présent. Le temps ayant fait son office, opéré son œuvre de décantation, elle réévalue, au crépuscule de sa vie, ses amours, et mesure leur impact réel. Et s'aperçoit qu'elle n'a pas forcément aimé ceux qu'elle a aimés ni ne les a aimés comme elle croyait les aimer. Ainsi de J., pour qui elle crut vouloir mourir, et qui s'est évaporé sans laisser d'empreinte prégnante. Cependant qu'Isaac, ordonné autour de son vœu, perdure, avec violence et en profondeur. Au fil de ces pesées de l'âme, Hélène Cixous nous baigne dans sa prose limbique, médiumnique, hyper mnésique, et nous débusque là où nous ne savions pas être.
Elle nous invite aussi, comme chaque fois, à nous faire spectateurs du processus de l'écriture en cours, dépositaires d'un scintillant et prismatique secret qui jamais ne sera levé.
Surtout, Hélène Cixous nous plonge, comme personne, au cœur du mystère d'aimer. Sur la foi des cahiers qu'elle tenait à l'époque, elle ressuscite, intacts, le trouble et la brûlure qui continuent d'agir en elle.
Il ne s'agit pas d'hommage, de commémoration, de remémoration, de traces mnésiques : il s'agit, au présent, d'un hymne, d'une célébration sacrée. "Aimer ne finit pas" déclare ce texte d'une poignante beauté.
BH 11/15
"De rage et de douleur monstre" de Térézia Mora (Piranha éditions)
 C'est
un texte
fracturé, scindé
sur toute sa ligne, toute sa longueur, et sur tous les plans. Partagé,
distinctement, entre deux voix, deux genres, deux temps. Entre le
masculin et
le féminin, le passé et le présent et, surtout, entre la vie et la
mort. Pour
autant, il ne se présente pas comme "Le livre brisé" de Serge
Doubrovski
car la mort n'advient pas en cours d'écriture, elle est inaugurale,
présente
dès avant la parole, ou plutôt, génératrice de la parole affolée.
Affolée,
fragmentaire et affûtée. Que la mort soit préalable à l'écriture, à la
profération, ne rend pas le texte moins saisissant.
C'est
un texte
fracturé, scindé
sur toute sa ligne, toute sa longueur, et sur tous les plans. Partagé,
distinctement, entre deux voix, deux genres, deux temps. Entre le
masculin et
le féminin, le passé et le présent et, surtout, entre la vie et la
mort. Pour
autant, il ne se présente pas comme "Le livre brisé" de Serge
Doubrovski
car la mort n'advient pas en cours d'écriture, elle est inaugurale,
présente
dès avant la parole, ou plutôt, génératrice de la parole affolée.
Affolée,
fragmentaire et affûtée. Que la mort soit préalable à l'écriture, à la
profération, ne rend pas le texte moins saisissant.
C'est le parcours d'un homme allemand, Darius Kopp, né en RDA, installé à Berlin, et qui part sur les traces de sa femme Flora, profondément aimée, suicidée, d'origine hongroise, et dont il découvre (ayant fait traduire son journal écrit en hongrois) qu'il ne savait rien d'elle.
C'est une disjonction temporelle, géographique, linguistique dont le texte rend compte en partageant les pages (sur une grande partie du roman) entre les réflexions et la quête désordonnée de Darius d'une part, et le journal restitué de Flora d'autre part.
Il apparaît alors que les époux ne parlaient pas la même langue. Au sens plénier. Absolu.
On suit donc, simultanément, les pérégrinations chaotiques de Darius et les tribulations intimes de Flora. Darius cherche, à travers l'Europe de l'Est, un lieu où disperser les cendres de sa femme cependant que Flora est aux prises avec un délitement intime. Darius se débat avec son deuil, sa perdition, ses rencontres fortuites, Flora dresse des inventaires, elle établit la liste clinique de ses amants (ou compagnons de débauche) et des symptômes et pathologies dont elle souffre.
La ligne de partage, au cœur de texte, est d'une pertinence déchirante. Se déploient ainsi, sur la page, deux soliloques éperdus et on ne peut plus déphasés. En bas de page, celui de Flora qui, en proie à ses démons, inventorie, pour juguler peur et douleur, médicaments, traitements, diagnostics, mais aussi scènes de fiasco amoureux, de rebuffades professionnelles ou intimes, toutes marquées par de cuisantes humiliations. Flora qui met au jour, et à retardement, les ressorts profonds qui l'animaient et qui, probablement, ont motivé son geste. Cependant que, sur le haut de la page on suit l'équipée tragicomique de Darius Kopp, son odyssée orphique ponctuée de rencontres insolites, parfois cocasses, souvent profondément émouvantes. Et alors que nous découvrons l'enfer secret de Flora, Darius Kopp qui, lui aussi, en prend enfin la mesure, est envahi, par bouffées quasi hallucinatoires, de réminiscences poignantes.
La langue est sans ambages, souvent elliptique, cassée et concassée, toujours percutante.
Une mise à nu dérangeante et envoûtante, un texte très singulier, déroutant, qui, profondément et douloureusement, fascine.
BH
10/15
"Giacomo Joyce" par James Joyce (éd. Multiple), traduction par Georgina Tacou
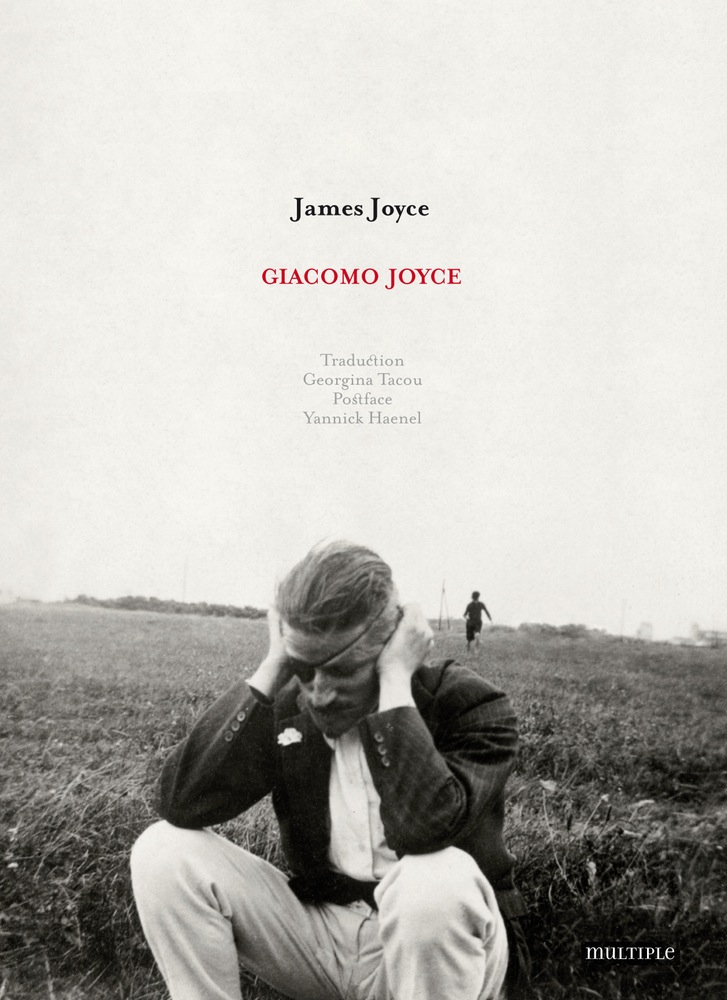 C'est un fruit
sortant de
l'abîme. Fruit acide et qui agace la faim. Et qui pourtant forme une
courbe
pleine, un tout complet.
C'est un fruit
sortant de
l'abîme. Fruit acide et qui agace la faim. Et qui pourtant forme une
courbe
pleine, un tout complet.
C'est une brève transe rythmique, une ivresse musicale scandée, orfévrée et dédiée.
C'est une impossibilité amoureuse, existentielle, transmuée, sublimée et, dans une mesure certaine, conjurée par l'alchimie joycienne.
L'argument est classique, le thème quasiment éculé puisque nous voici face à un Joyce aimanté, érotiquement requis par l'une des jeunes étudiantes à qui il enseignait l'anglais entre 1912 et 1914 alors qu'il vivait à Trieste. Mais cette situation potentiellement génératrice d'assommants poncifs donne ici lieu à tout autre chose qu'au tissu d'âneries mièvres et de niaiseries attendues.
Joyce s'empare du cliché et, avec l'aisance et l'inventivité souveraines qui lui sont propres, il le pulvérise d'emblée. Il s'improvise troubadour espiègle et pratique une autodérision salubre et cathartique. Il se campe en Giacomo (Dom Juan) éconduit et cependant pas vaincu. Sous sa plume ébouriffante, le revers amoureux, les traverses successives, deviennent l'occasion d'un défi qui transcende le simple camouflet : l'infortune de "Giacomo" Joyce est désormais le creuset d'une création aux formes et aux tonalités très pures.
Il faut écouter claquer et vibrionner cette langue que Joyce démembre comme personne (et qu’il émaille d’italianismes pimpants) pour donner à entendre l'aporie inaugurale du désir et son triomphe différé, poétiquement réarticulé.
Le sexe, présent partout, infuse sa fièvre et sa trépidation à cette fière et entêtante incantation. Et c'est un texte si profondément organique, si proche de l'oralité, du bouche à bouche, qu'il se dit et se récite bien plus qu'il ne se lit.
Ainsi :
"Encore. Jamais plus. Sombre amour, sombre désir. Jamais plus. Ténèbres. Crépuscule. Traversant la piazza. Aube grève s'abaissant sur de vastes pâturages vert sauge, semant en silence la nuit et la rosée. Elle suit sa mère avec une grâce gauche, la jument menant sa pouliche. Un crépuscule gris enserre délicatement les hanches fines et rondes, le cou fin, souple, tendineux, le crâne délicat. Soir, paix, la poussière de l'émerveillement... Hé, ho ! L'aubergiste ! Ho hé ho !"
Une rareté longtemps introuvable, enfin exhumée, rendue à sa crudité originelle par la traduction, superbe, de Georgina Tacou. Une féerie littéraire qu'il importe de découvrir de toute urgence.
BH 10/15
"Comme Ulysse" de Lise Charles (P.O.L.)
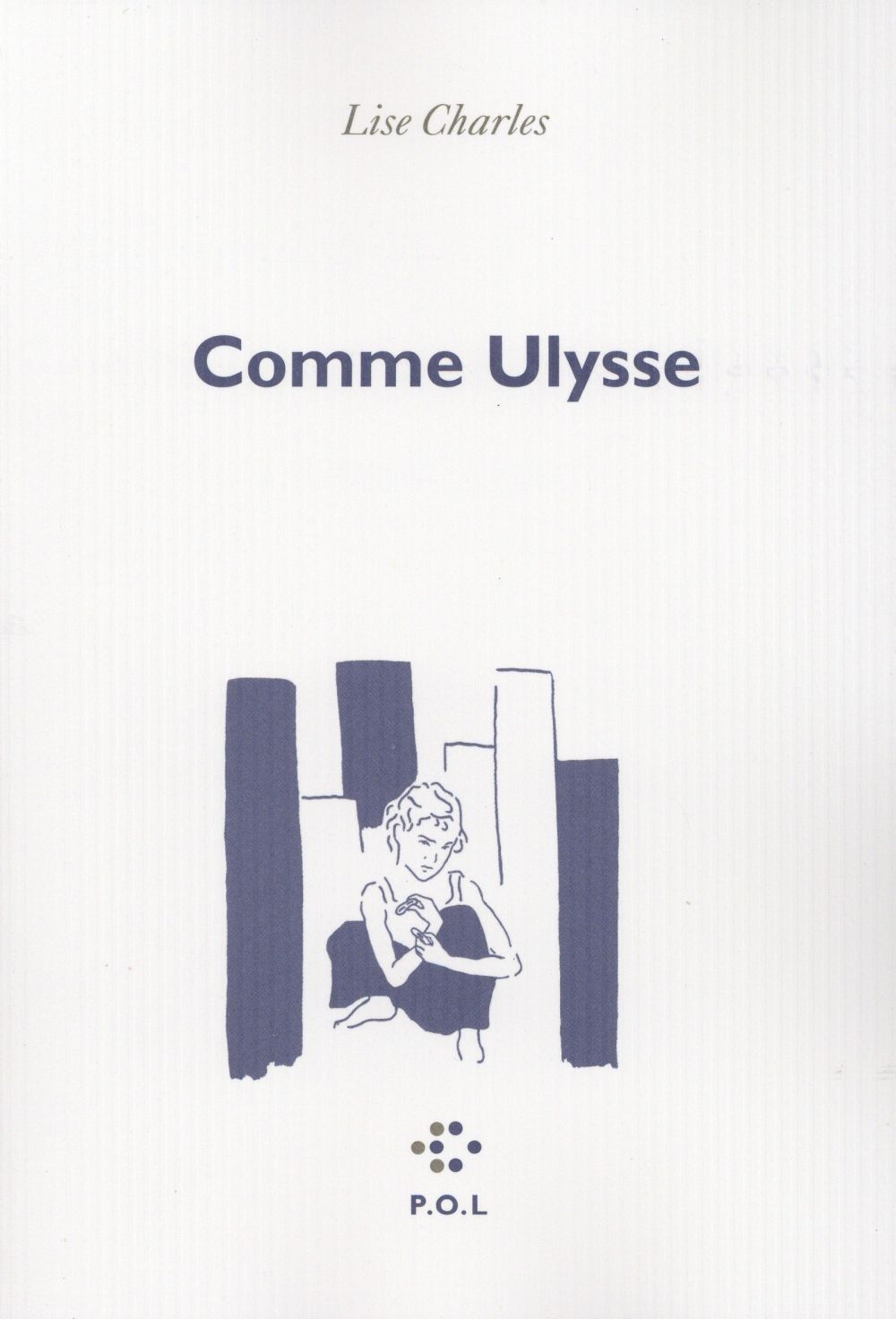 Ceci
n'est pas un
roman, c'est
une facétie majuscule, une provocation incessante et trépidante qui
court sur
près de quatre cent pages.
Ceci
n'est pas un
roman, c'est
une facétie majuscule, une provocation incessante et trépidante qui
court sur
près de quatre cent pages.
C'est une voix mordante, extraordinairement frondeuse et polissonne, qui s'attaque, l'air de rien, à une forme surannée, une version obsolète et littéraire du rêve américain (un rêve américain aux accents victoriens et germanopratins) lequel rêve se retrouve débité en tranches, troué au vitriol du verbe corrosif et de la verve incendiaire.
C'est un précipité d'effronterie pure, un traité d'insolence sans frein.
La narratrice est une espèce de lolita mal embouchée qui nous embarque dans un improbable périple à travers les Etats-Unis. D'abord hébergée par sa sœur Jeanne avec qui elle entretient des rapports peu amènes, elle se laisse prendre et modeler au fil des rencontres fortuites qui rythment son odyssée caracolante. Ladite narratrice (qui s'est rebaptisée Loo pour l'occasion) aimante successivement un jeune poète germanique, un peintre d'âge mûr et un rentier obèse qui, tous, sont sensibles à son charme, son naturel désarmant et sa verve inimitable. Elle devient donc muse de Wolfgang le poète, puis égérie de Peter le peintre qui lui confie le rôle de gouvernante auprès de ses enfants. Loo rencontre Rebecca la femme de Peter, sublime, adulée, revêche, perverse et écrivain à ses heures perdues, et elle s'installe à demeure dans leur vie de château. Ces diverses péripéties nous valent des portraits caustiques d’un milieu artistique aussi dégénéré que boursouflé de suffisance. Mais ce ne sont pas tant les tribulations de "Loo" chez les ricains raffinés qui importent : ce qui fait la matière et l'intérêt du texte, c'est son regard, à la fois candide et implacable, qui épingle les travers de ce petit milieu et brocarde à tout va.
Et, ce qui requiert plus que tout, c'est la langue, culottée, mal peignée, directe et crapoteuse, de cette gamine sans fard qui éclabousse de sa fraîcheur carabinée les lieux et les gens qu'elle traverse. On est sans arrêt surpris et séduit par les saillies de cet esprit fantasque et, en apparence mal dégrossi, mais qui fait preuve d'une rare force de pénétration.
Il s'agit donc moins d'un voyage, d'un exil géographique, que d'une équipée à travers la verdeur d'une langue incroyablement inventive et parfaitement jubilatoire.
C’est un jeu de miroirs et d’échos, une balade facétieuse au cœur d’une culture amidonnée et soudain bousculée par des salves d’irrévérence. Le texte fourmille de références subtiles, décrochées, incongrues et amenées d'insolite façon. Les mises en abyme sont multiples et toutes sont en forme de clin d'œil. On sort tout réjoui de cette logorrhée foutraque, mal léchée, et d'une irrésistible drôlerie.
BH
10/15
"L'oragé"
de Douna Loup (Mercure de
France)
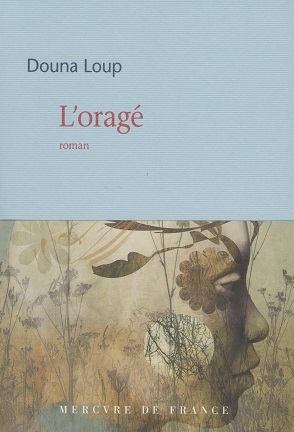 C'est
un texte pétri
dans la
chair nue, infusé à même la peau,
brassé
au cœur de la langue. Un texte sur une langue en train de s'inventer et
qui
s'invente à mesure. Un texte qui s'irrigue à la source alchimique qui
préside
aux découvertes et créations majeures.
C'est
un texte pétri
dans la
chair nue, infusé à même la peau,
brassé
au cœur de la langue. Un texte sur une langue en train de s'inventer et
qui
s'invente à mesure. Un texte qui s'irrigue à la source alchimique qui
préside
aux découvertes et créations majeures.
Douna Loup prend et tient le pari de retracer le destin de deux figures d'exception, deux écrivains malgaches qui sévirent au cœur du XXème siècle. Il s'agit de Jean-Joseph Rabearivelo (dit Rabe) et d'Esther Razanadrasoa, son aînée de dix ans.
La rencontre entre ces deux âmes fiévreuses, pulsatiles, anormalement vibrantes, génère un amour d'une nature étrange et, surtout, scelle un pacte indéfectible : chacun des deux créateurs est en charge de veiller sur l'œuvre de l'autre.
Les trajectoires se croisent, se percutent, évoluent en parallèle ou en courbes embrassées.
C'est l'histoire de ceux vies créatrices qui s'épaulent et se confortent, de deux affranchissements simultanés et conjugués.
Pour Esther comme pour Rabe, l'émancipation passe par le dépouillement des peaux et le cisèlement des mots. Les corps se façonnent dans les étreintes multipliées de même que la langue se modèle dans la friction incessante entre le français et la poésie hova.
Esther ouvre la voie, elle est la pionnière des amours sans loi ni codes convenus et elle fomente et tisse, au cœur d'une vie à l'air libre, une langue parallèlement débridée.
Rabe s'inscrit, intrépide, dans le sillage de son aînée et sporadique amante. Il sculpte, lui aussi, les corps et la langue. Esther initie Rabe à la beauté complexe des amours plurielles et, réciproquement, Rabe aiguillonne Esther de ses audaces langagières. Ils se trempent mutuellement dans des bains de corps et de langue. C'est une double désincarcération, une double et jubilatoire appropriation au sein d'un territoire colonisé.
Et Douna Loup sait dire comme personne la libre percée des peaux et des mots, les redditions victorieuses signées avec le sang.
Sa langue est faite de psalmodies lentes, de longs déhanchements poétiques, de balancements charnels et hypnotiques et d'éclats drus. Sa langue, en longues foulées solaires, épouse au plus près les mouvements d'essor et d'envol de deux destins alliés.
Une splendeur.
BH 10/15
"Cordélia, la guerre" de Marie Cosnay (éditions de l'Ogre)
 Voici
un texte
multiple et
dévoré, colonisé par sa propre surabondance. C'est une longue psalmodie
heurtée, épelée dans une langue scandée et hantée. C'est une joyeuse
cavalcade,
aussi. Un espace quadrillé, une dramaturgie bousculée, un espace-temps
éclaté,
et des personnages projetés comme des éclats de rire.
Voici
un texte
multiple et
dévoré, colonisé par sa propre surabondance. C'est une longue psalmodie
heurtée, épelée dans une langue scandée et hantée. C'est une joyeuse
cavalcade,
aussi. Un espace quadrillé, une dramaturgie bousculée, un espace-temps
éclaté,
et des personnages projetés comme des éclats de rire.
C'est une fantasque enquête policière contemporaine couplée avec une version coruscante du "Roi Lear". C'est une trépidation enjouée qui brasse du tragique et de l'irrémédiable sans ciller. C'est une prose durement et gaiement cadencée, une langue faite d'éclats soyeux et de coins cisaillés. C'est une chevauchée effrénée qui juxtapose et mêle époques, drames et affects.
C'est une fantasmagorie endiablée qui nous tient en haleine et en joue au fil de ses étourdissantes divagations. C'est une course-poursuite haletante car nos personnages sont en danger de mort et en situation de guerre. Il ya tout le personnel d'un commissariat en crise qui croise et percute les personnages du "Roi Lear".
Il y a Durruty, commissaire dépassé, Ziad, Zelda et Tom très jeunes lieutenants de police, le Grec et sa femme Gabrielle convoitée par Ziad. Il y a aussi une énigmatique femme chauve, maigre et amnésique, prénommée Hannah et son alter ego ou sa copie conforme, une infirmière, qui répond au prénom de Mélodie. L'une des deux est la victime d'un meurtre. Il y a une non moins énigmatique vieille rousse qui, dans un lit d'hôpital, se substitue à Ziad. Car ce texte est le lieu et le creuset d'incessantes métamorphoses quasi ovidiennes. Et, au cœur de ce chaos, de cette enquête policière torpillée de l'intérieur, passe, altière, Cordélia qui, flanquée d'une armée en déroute mène une croisade bancale en faveur de son père.
C'est donc un texte aux accents mythologiques et tragiques et c'est aussi une épopée incendiaire et cocasse qui, facétieusement, se joue des codes qu'elle reproduit.
On perçoit, ici et là, un timbre d'une grande acuité qui évoque Duras, Jacques Serena ou encore Pierre Jean Jouve.
Une grande célébration païenne, une machine de guerre ludique et jubilatoire, un furieux festin verbal qui nous emporte sans faiblir.
Une lecture euphorisante, un hymne éblouissant aux ressources inépuisables de la littérature.
BH
09/15
"Une fille est une chose à demi" de Eimar Mac Bride (Buchet Chastel) (traduit par Georgina Tacou)
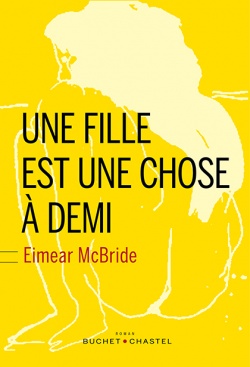 Voici un
récit comme
un choc
thermique, comme une hydrocution, comme une implacable insolation ou un
uppercut dont les ondes de choc se propagent page après page et
secouent sans
merci le corps entier. Le corps du texte comme celui du lecteur.
Voici un
récit comme
un choc
thermique, comme une hydrocution, comme une implacable insolation ou un
uppercut dont les ondes de choc se propagent page après page et
secouent sans
merci le corps entier. Le corps du texte comme celui du lecteur.
Et c'est un texte dont on sort dans état de saisissement si grand que les mots font défaut pour qualifier ce qui s'est produit.
Car ce texte, c'est d'abord un auteur et une langue.
L'auteur est enragée, un état de fièvre et d'urgence et la langue claque à une cadence endiablée, au rythme des décrochements successifs d'un esprit bouillant et possédé. La langue est sans pareille. Elle a été fomentée dans le creuset des humeurs les plus farouches et de la chair à vif. C'est une langue d'arrachements, de syncopes, qui s'invente une syntaxe et des formulations aussi arbitraires que foudroyantes. Ce sont des phrases qui adhèrent où la peau, aux viscères, qui font saillir les veines et restituent la pulsation du sang. Ce sont des cognées brutes et des prélèvements à vif, sans préavis.
C'est une histoire haletée et purulente dite avec les mots d'une Ascension inversée d'une Babel affolée. Ce sont des phrases dynamitées, trouées, tronquées, cognées, cabossées de partout, des phrases nominales, souvent, et animales, toujours, des phrases roulées dans la fange, éruptées dans l'urgence, la crasse, la poisse.
C'est crachée par la narratrice, une enfance et une adolescence irlandaises marquées par l'absolue déveine, placées sous la gouverne et le signe d'une mère confite en dévotion, d'un père en allé, d'un frère adoré mais diminué par les séquelles d'une tumeur au cerveau. C'est le sentiment d'exclusion et de révolte. La blessure, la soif, la rage, le stupre, l'alcool, le dérèglement et les détournements dans tous les sens.
C'est un roman d'apprentissage à nul autre pareil car rien n'existe hors cette langue sauvage, déjetée, langue géniale qui restitue une vie carrossée et culbutée, dans l'extrême violence.
Il faut, à ce titre, saluer la qualité, exceptionnelle, de la traduction effectuée par Georgina Tacou.
Un texte qui arrache le cœur, les moelles et toutes les fibres.
BH 09/15
Retrouvez
également
l'interview de Georgina
Tacou traductrice du livre par
Bénédicte
Heim sur le podcast des Contrebandiers éditeurs.
"Au café du Rendez-vous" de Ingrid Winterbach (Phébus)
 Dans ce
texte, on
entre sans
préambule, on est tout de suite comme chez soi. De plain-pied, immergé
ou
plutôt aspergé, éclaboussé de perceptions aigües et multiples. On est
comme
chez soi sauf qu'on est aussi , et dans le même temps, dérouté, expulsé
de
l'évidence. Car une étrangeté envoûtante règne dans ce récit, une
étrangeté
sans équivalent connu, moite, poisseuse, languide, voluptueuse et
entêtante.
Dans ce
texte, on
entre sans
préambule, on est tout de suite comme chez soi. De plain-pied, immergé
ou
plutôt aspergé, éclaboussé de perceptions aigües et multiples. On est
comme
chez soi sauf qu'on est aussi , et dans le même temps, dérouté, expulsé
de
l'évidence. Car une étrangeté envoûtante règne dans ce récit, une
étrangeté
sans équivalent connu, moite, poisseuse, languide, voluptueuse et
entêtante.
Ce sont des vies qui se frôlent, se cognent et parfois explosent en plein vol. Des vies complexes, enchevêtrées, dont la matière charnelle, fibreuse, énigmatique, est restituée avec un art consommé et une acuité confondante.
Karolina Ferreira est le pivot et le prisme au travers du quel tout est perçu. C'est une entomologiste en rupture, de ban et de tout, qui débarque à Voorspoed, petite ville d'Afrique du Sud. Karolina est officiellement et prétendument venue pour recenser les papillons rares qui sévissent dans le veld. Elle est flanquée de Willie, un simili chamane perché, qu'elle a pris fortuitement en stop, et qui va œuvrer à ses côtés. Karolina effectue en effet ses investigations, mais elle va surtout éprouver et recomposer, dans les frottements et à la faveur des événements successifs, son corps émietté.
Karolina vaque, elle se partage, se distribue entre ses virées dans le veld et ses soirées au Café du Rendez-vous, point nodal et névralgique du roman. Dans ce café se rassemblent des personnages étranges, tout à la fois fascinants et inquiétants dont certains sont dotés d'une aura quasi surnaturelle. Dans ce lieu chargé d'affects et de puissantes vibrations sexuelles, Karolina se décape, s'écorce peu à peu. Elle se dépense, se dilapide voluptueusement dans la danse, le tango, qu'elle pratique jusqu'à épuisement, affûtant son corps contre celui des hommes qui se présentent. Elle joue aussi (au billard) et s'alcoolise de concert avec ses compagnons vespéraux. Elle observe, avec une grande minutie, une rare force de pénétration, les hommes qu'elle côtoie. Elle se frotte, par le corps et l'âme, à leur mystère qui l'aimante.
Elle tisse des relations singulières, pointues, sensibles, peu conventionnelles, avec ces vies dont beaucoup sont cabossées voire fracassées. Elle se laisse approcher, de plus en plus, au point de nouer, avec un dénommé Jess, un rapport d'abord fragile puis authentiquement amoureux. Jess, qui est un homme délicat, meurtri, et qui est en quête d'une vie spirituelle réparatrice. Ce récit est, du reste, baigné, à parts égales, par une sensualité et une spiritualité considérables toutes deux. Les âmes, dans ce texte, dans ce café, sont saillantes et elles circulent autant que les corps désirants. La transcendance se vit, se pratique quotidiennement. Willie, par exemple, communique avec l'invisible. Il est capable d'anticiper la mort de ceux qu'il croise. Et, de fait, la mort frappe à plusieurs reprises. Car les hommes comme l'atmosphère, sont à vif et saturés de violence. Eros et Thanatos règnent sans partage. Et Karolina est, par exemple, fascinée presque jusqu'à la possession, par un couple d'amants adultères d'une beauté foudroyante.
L'auteur navigue, avec une aisance stupéfiante, entre l'onirique, le quasi fantastique, et le charnel le plus cru. En résulte une chimie particulière qui provoque un état d'apesanteur et fait connaître au lecteur l'expérience de la lévitation.
Un texte réellement autre qui résiste à toute analyse et à toute comparaison.
Un ravissement.
BH 09/15
"Le bonheur comme l'eau" de Chinelo Okparanta (Zoé)
 C'est un
bouquet
d'instants
recueillis et reliés, un bouquet subtil, délicat, qui exhale un parfum
secrètement vénéneux. Ce sont des vies difficiles et chahutées,
cognées,
brinquebalées, entre le Nigéria et les Etats-Unis. Ce sont de
douloureuses
quêtes d'identité et d'appartenance. Sexuelle, originelle, ethnique.
C'est le
mirage américain à l'épreuve de "la vraie vie", des aspirations et
projections démesurées.
C'est un
bouquet
d'instants
recueillis et reliés, un bouquet subtil, délicat, qui exhale un parfum
secrètement vénéneux. Ce sont des vies difficiles et chahutées,
cognées,
brinquebalées, entre le Nigéria et les Etats-Unis. Ce sont de
douloureuses
quêtes d'identité et d'appartenance. Sexuelle, originelle, ethnique.
C'est le
mirage américain à l'épreuve de "la vraie vie", des aspirations et
projections démesurées.
C'est une écriture à la fois ciselée et enveloppante pour dire d'éternelles et cruelles vérités chaque fois trempées dans un bain d'extrême singularité. C'est une écriture souvent circulaire et, de ce fait, hypnotique, qui explore les parois et recels d'une impasse avant de nous renvoyer, in fine, à l'impossibilité inaugurale.
Ce sont presque toujours des femmes, des filles, qui se débattent au cœur de ces nouvelles. Elles sont tenaillées par le désir d'être ailleurs, autrement, ou taraudées par des amours hétérodoxes et aux prises avec les pressions et les exigences de conformité édictées par leurs proches. Ces héroïnes sont des résistantes secouées, transbahutées, baladées entre le Nigéria et les Etats-Unis, entre une identité plaquée, fabriquée, et celle qu'elles bâtissent au secret de leur corps.
L'une se plie à des méthodes barbares pour obtenir une peau décolorée, férocement javellisée, l'autre se soumet au viol conjugal cependant que sa mère, postée derrière la porte, épie les cris de douleur qu'elle s'empresse de confondre avec des plaintes voluptueuses. Une autre, professeur de lycée au Nigéria, s'éprend de sa fascinante collègue et engage des démarches éprouvantes pour la rejoindre aux Etats-Unis jusqu'à ce que, in extremis, elle comprenne qu'elle obéit à une injonction et un désir qui ne sont pas les siens. Il y a aussi celle qui, inlassablement, ressasse un amour fantasmatique, tressant une fable dont, à chaque nouvelle proie, elle propose une version plus idyllique et plus minutieusement peaufinée. Il est également souvent question de la maladie et de la déchéance des parents et l'une des protagonistes va se faire, fugacement, "dame de compagnie" dans le dessein de financer le coûteux traitement dont sa mère aurait besoin pour guérir. Seulement, la honte de l'acte commis la poignardera si profond que, non seulement, elle ne réitérera pas l'expérience, mais elle gèlera la somme gagnée laquelle servira, au bout du compte, à payer les obsèques. Il y a, enfin, une étudiante qui doit faire face à la relation perverse qui unit ses parents (le père sadisant la mère consentante), relation dont elle est l'otage, le rouage, l'élément sacrifié.
Chinelo Okparanta trousse ses récits d'une plume paradoxale, aérienne et acérée. Elle instaure une distance presque glacée, une paroi vitrifiée et crée des atmosphères feutrées, secrètes, d'une inquiétante étrangeté. Et, au cœur de ces écrins empreints d'une fausse douceur, elle dispose des explosifs qui tout dynamitent avec une cruauté et une justesse inouïes.
L'écriture est fluide, limpide, émaillée de salves féroces, mais tout est dit avec une sensibilité si exacte et poignante, que l'émotion voire le bouleversement l'emportent qui secouent en profondeur.
C'est doux et déchirant et souvent magnifique.
BH
08/15
"Lac" de Pascal Rambert (Les solitaires intempestifs)
 Ce sont
des voix qui
montent, qui
semblent surgir des limbes mais qui sont tout sauf
spectrales :
elles
sont, au contraire, très sensiblement charnelles, charnues et habitées.
Ces
voix sèment le trouble, elles distillent l'inquiétude et l'incertitude
en cela
qu'elles sont tout ensemble floues, vaporeuses, et précises, d'une
découpe
acérée, et elles sont aussi martelées et même dardées.
Ce sont
des voix qui
montent, qui
semblent surgir des limbes mais qui sont tout sauf
spectrales :
elles
sont, au contraire, très sensiblement charnelles, charnues et habitées.
Ces
voix sèment le trouble, elles distillent l'inquiétude et l'incertitude
en cela
qu'elles sont tout ensemble floues, vaporeuses, et précises, d'une
découpe
acérée, et elles sont aussi martelées et même dardées.
C'est un crime inexpiable, une mort incompensable. C'est, au bord d'un lac et entre les branchages, le corps retrouvé de Thibault, corps mort catalyseur de tous les désirs, de toutes les fulminations. C'est ce corps soudain retranché et objet de toutes les cristallisations qui déclenchera le récitatif hanté d'un chœur de jeunes gens qui, tous, gravitaient, autour de Thibault, qui, tous, à la faveur de cette perte, déverrouillent leur parole intime et habitée.
Tour à tour chaque membre du groupe prend la parole et se livre à une invocation incantatoire et parfois imprécatoire, qui confine à la transe. Les jeunes gens sont tous possédés par la figure et la perte de Thibault et chacun livre sa partition singulière, chacun incarne et chante un état, une émotion.
Il y a Mathias qui dit le désir et l'amour, Emma qui dit les liens tranchés vifs, Jérôme qui articule une quête mystique, Cyprien qui éructe la révolte, Lola qui décline les ravages du silence...
Mais chaque personnage n'existe qu'en tant que membre de la communauté, meurtrière et blessée. Chaque voix qui s'élève complète et poursuit la litanie amorcée et, si singulière soit-elle, elle est avant tout une facette du chœur qui brasse les grands courants universels.
Les monologues en témoignent qui reprennent et retissent les mêmes motifs et les mêmes termes. Se développe ainsi, de personnage en personnage, un fascinant jeu d'échos et de langue. Si bien que, sous les dehors les plus modernes et les plus crus qui soient, on retrouve le souffle puissant et les thématiques intangibles des chœurs antiques. C'est aussi une allégorie, une mise en abyme et une mise en acte de la geste théâtrale elle-même : ces jeunes gens qui cherchent à poser leur voix sont, dans le même temps, en quête de leur place exacte au sein de l'espace dramaturgique.
Mélopée lancinante, cantate charnelle, mystique, polyphonique, "Lac" est une œuvre entêtante qui s'incruste dans les cellules.
BH 08/15
"Nous le temps l'oubli" d'Isabelle Lévesque (L'herbe qui tremble)
 Ce
sont des
textes à bout portant et comme des balles en plein cœur.
Ce
sont des
textes à bout portant et comme des balles en plein cœur.
C'est une langue syncopée, une langue faite de détonations successives, une langue dure et dardée qui s’irrigue de longs flux de douceur.
C'est une ferveur crue, un lyrisme sans complaisance, sans baisse de régime et sans attiédissement aucun.
Ce sont les bords et les bouts calcinés d'une vie consumée dans la passion de vivre et d'aimer. C'est une langue qui décline inlassablement les visages, les corps et scande et psalmodie ses cadences singulières. C'est une langue qui claque, farouche et fière. Une langue d'ellipses, opaque, sombre et touffue et qui pourtant percute avec une force claire, une incisive limpidité.
C'est une langue qui fourche et trébuche volontairement pour dire les cahots, les creux, les percussions.
C'est une langue de décharges, de chocs et d'impossible retranché.
Ainsi :
"Pain pour
A faim se dit "cri".
Endors et corps à terre
sèche des étoiles.
Nous peindrons, doigts serrés.
Tu prendras mon corps (ta toile) et je.
Laisserai deviner mes soupirs, je veux tu.
Courant dément la saveur du pain."
"Pas poème.
Un jour seul.
Premier degré, sens littéral.
Rien pour martel en tête.
Habits très courts et dessous
rien.
Pas parler
(à dire trop, taire assez).
Bouches.
Je veux. Rien de conditionnel.
Toi, sans fin, tissu jeté même déchiré,
Pourquoi pas érigé
Crinière et force
à cœur de fibre,
cheveux longs laissés
oreiller, plumes à paille de loup.
Chasse gardée. Pas intrus,
laisse Verrou-Tiré.
Satiété."
"Sous un ciel immense" de Catherine de Saint-Phalle (Sabine Wespieser)
 C'est un
texte aux
floraisons et
ramifications multiples. C'est un concentré d'empathie, un précipité
d'humanité
pure. On est à Melbourne, dans les pas et les pensées d'une narratrice
qui épouse
étroitement les préoccupations de ceux qui l'entourent. La narratrice
est une
observatrice étrangère projetée dans le bush australien, immergée dans
milieu
humain bouillonnant et bigarré.
C'est un
texte aux
floraisons et
ramifications multiples. C'est un concentré d'empathie, un précipité
d'humanité
pure. On est à Melbourne, dans les pas et les pensées d'une narratrice
qui épouse
étroitement les préoccupations de ceux qui l'entourent. La narratrice
est une
observatrice étrangère projetée dans le bush australien, immergée dans
milieu
humain bouillonnant et bigarré.
Elle est jardinière chez Kim, une paysagiste maigre et revêche. Autour d'elle gravitent la douce et lumineuse Mitali, l'énigmatique et rude Sarah, la fille de cette dernière, Mary, et la chaleureuse Bernice. Ce gynécée est composé de figures peu communes, toutes secrètement blessées.
Il y a donc Mitali, collègue, d'origine indienne, de la narratrice, qui, tarabustée par une perte incompensable, se débat avec un deuil protéiforme. Il y a Sarah, tenancière d'un bar où convergent des spécimens d'humanité cabossée. Sarah dont la rugueuse beauté foudroie la narratrice cependant que sa personnalité, âpre et anguleuse, la requiert et l'intrigue. Sarah meurtrie par la relation durcie et fracturée qui l'unit à sa fille Mary. Il y a ladite Mary, dont la beauté, encore plus proverbiale que celle de sa mère, est voilée, souscrite et retranchée sous une burqa pour un motif que tout le monde ignore. Il y a Bernice, aussi, pétulante, attachante et vulnérable animatrice radio, qui aspire éperdument à se faire aimer d'un homme lequel ferait d'elle une mère avant qu'il ne soit trop tard. Il y a Jack, enfin, l'amoureux de la narratrice, géographiquement proche mais spirituellement propulsé aux antipodes depuis qu'un accident de voiture a partiellement détruit sa mémoire.
La narratrice navigue entre ces figures fantasques dont elle apprivoise les aspérités, dont elle panse peu à peu les blessures. Le récit consiste en des fragments de portraits qui s'étoffent à mesure et il est mené avec une fantaisie réjouissante qui n'exclut pas une étincelante virtuosité.
La langue est pétillante, précise, inventive et tendre. Mais ce qui frappe, surtout, c'est que ce texte irradie, il déborde d'une rare humanité, il regorge d'un amour de l'autre qui emporte tout.
BH 07/15
"Nous les vagues" de Mariette Navarro (Quartett)
 C'est
un texte immédiatement
dansé, gymnique, acrobatique. Un texte fait de bonds, cabrioles,
virevoltes, de
lancers très haut tenus. C'est une langue qui rue, rugit, saccade en
cascades
mais se déroule, se développe, aussi, voluptueusement, et enveloppe le
lecteur.
C'est
un texte immédiatement
dansé, gymnique, acrobatique. Un texte fait de bonds, cabrioles,
virevoltes, de
lancers très haut tenus. C'est une langue qui rue, rugit, saccade en
cascades
mais se déroule, se développe, aussi, voluptueusement, et enveloppe le
lecteur.
C'est une prosopopée hypnotique, une allégorie furieuse. Mariette Navarro orchestre minutieusement et scande savamment l'obscure chorégraphie des vagues. On dirait qu'elle dispose d'une science médiumnique, qu'elle s'appuie sur un savoir ancestral.
Ces vagues qui enflent, s'enroulent, éclatent et se réarment dans l'incessant ressac, sont artistiques, amoureuses et politiques. Successivement et simultanément. Elles en appellent au soulèvement des forces dissidentes, à l'insurrection des corps amoureux. On peut trouver en elles une empreinte, une lointaine réminiscence de « L’Amour fou » et de « Nadja » puisqu’il s’agit, pareillement, de réenchanter le monde par une offensive amoureuse et poétique (la poésie et l’amour étant indissociés), en faisant assaut de ferveur et d’inventivité. Ces vagues sont, en soi, des corps et une langue en résistance. Elles se déclarent et profèrent comme une menace la vie crue, l'expansion nue, l'affranchissement sans terme qu'elles visent.
Ainsi :
"- Apparaissons au cœur du monde et au centre des cités, et venons nous heurter aux pieds de leurs palais. Nous escaladerons la hauteur arrogante des grandes tours, nous salirons le marbre des étages. Nous serons la trace noire sur le costume blanc. L'inavouable au bas des robes. Nous serons les gouttes de boue qui éclaboussent jusqu'aux cuisses. S'il le faut, nous serons l'outrage."
Puis: "Ah les vivants d'extrême-vie, ah les grands incompréhensibles. Cela ne surprendra personne que nos cœurs prennent ensemble le rythme anormal et effréné des bombes, que nos regards se brouillent à l'heure du grand vertige. Nous remettrons nos sangs à l'unisson des révoltes et nos pouls au bon tempo. Nous rejoindrons l'action comme on rejoint une fanfare, comme dans une chorale on élève soudain sa voix bien au-dessus de toutes les autres."
Et encore : "Il n'y aura plus à avoir peur de rien : nous serons l'accident sublime, et la goutte de feu. Il n'y aura pas à froncer les sourcils, à rougir d'avancer. Nous irons tranquillement. Alors, peut-être, enfin, entre nous jaillira le sens. Prends ma main, maintenant, qu'il circule entre nous le nom des choses, le cours du temps, le pouls du siècle."
Tour à tour psalmodies ou incantations, les vagues de Mariette Navarro ne sont pas celles de Virginia Woolf. Elles sont une instante injonction à vivre sans attendre et au plus haut. Et elles inspirent au lecteur le désir d'obéir sans sourciller.
BH 07/15
"Quelques femmes" de Mihàlis Ganas (Quidam éditeur)
 Ce
sont des instants
arrachés et
ciselés. Des fragments peaufinés et ouvragés. Des hommages fulguraux et
d'une
délicatesse extrême. Ce sont des portraits de femmes sous forme de
radioscopies
supersoniques. Ce sont des précipités poétiques et sensoriels. Des
simulacres
de nouvelles mais comme concassées au maximum. Des instants, cocasses
ou
poignants, irrigués de sensualité de rage ou soulevés par une immense
compassion.
Ce
sont des instants
arrachés et
ciselés. Des fragments peaufinés et ouvragés. Des hommages fulguraux et
d'une
délicatesse extrême. Ce sont des portraits de femmes sous forme de
radioscopies
supersoniques. Ce sont des précipités poétiques et sensoriels. Des
simulacres
de nouvelles mais comme concassées au maximum. Des instants, cocasses
ou
poignants, irrigués de sensualité de rage ou soulevés par une immense
compassion.
Ce sont des femmes que l'auteur croque subrepticement et avec une délectation des plus sensibles.
L'une est saisie dans l'éperdu d'un coup de fil qui zèbre la nuit. Une autre est aux prises avec les affres et la hantise du vieillissement.
Une autre, engagée dans une tâche bureaucratique, est abruptement déshabillée, fantasmée mue par un regard d'homme. Une autre est un objet de douleur, un motif de regret pour un homme désemparé. Une autre encore, prénommée Anna, aussi opaque qu'irrésistible, entretenait avec un homme transi, une relation longtemps ambigüe mais marquée par la distance jusqu'à ce que la maladie, secrètement bénie pour l'homme, les rapproche. Une autre évoque un épisode de son enfance sur le mode et avec la puissance incantatoire des tragédies antiques. Une autre encore, femme de ménage de son état, s'octroie un temps ouvert, comme offert à discrétion, et prélevé sur les heures ordinairement dédiées aux tâches serviles et fastidieuses. Ce sont des coupes temporelles sidérantes. Les évocations sont si denses, si intenses, qu'elles nous donnent accès à l'épaisseur plénière de ces vies.
Toute l'étendue du passé, tout le déroulé du futur, sont contenus dans ces tranches, ces instantanés frappants.
BH 07/15
"Le nénuphar et l'araignée" de Claire Legendre (Les Allusifs)
 C'est
un précis
tout
à fait
singulier, un relevé circonstancié et d'entomologiste.
C'est
un précis
tout
à fait
singulier, un relevé circonstancié et d'entomologiste.
Claire Legendre a proposé en effet de recenser, d'épingler et d'explorer les peurs qui le gouvernent et la cisaillent. Elle s'attelle et s'attaque à tout ce qui la noue sans établir de hiérarchie, sans distinction et sans critère autre que l'intensité de l'angoisse suscitée.
Ainsi sont disséquées indifféremment, et avec une égale minutie, la peur de l'avion ou des araignées, la hantise de la maladie ou du séisme amoureux.
Claire Legendre procède comme une fileuse, comme un Pénélope habitée, obsessionnelle, par enroulements et déroulements successifs. Elle tisse, détisse, retisse les mêmes motifs approchés chaque fois sous des angles différents. Elle procède par gradations, par cercles concentriques qui vont s'élargissant. Elle part de sa personne pour rejoindre le monde. Elle examine, radiographie ses peurs très singulières après quoi sa réflexion prend de la hauteur et un tour spéculatif. Elle mêle, avec un art consommé et une habileté confondante, réactions épidermiques, notations viscérales et analyse de haute volée.
Il est beaucoup question de la maladie de l'hypocondrie effréné qui, un beau jour, se voit justifiée par l'apparition d'un "nénuphar" intempestif. L'autre chantier qui la requiert essentiellement est celui de l'amour et de sa perte, le thème du délaissement, de l'abandon amoureux. Elle met au jour les mécanismes et les grippages de l'amour. Elle en vient par exemple à établir que "il faut qu'un amour soit impossible pour qu'il dure". Elle s'intéresse aux symptômes et effets de la dépendance amoureuse et décrète que seul l'exercice de la fiction, de l'écriture romanesque peut constituer "un itinéraire bis", une alternative aux décharges d'absolu provoquées par l'état amoureux.
C'est une exposition sans fond, une mise à nu radicale et une exploration captivante menée dans une langue rêche, claquante et culotté.
BH
07/15
"La femme provisoire" d'Anne Brécart (Zoé)
 C'est
un récit
presque improbable
et qui se présente comme tel. Il avance à pas de loup et à voix
chuchotée.
C'est
un récit
presque improbable
et qui se présente comme tel. Il avance à pas de loup et à voix
chuchotée.
Une femme, d'un âge indéterminé, voit subitement surgir chez elle un jeune homme dont elle fut, pour ainsi dire, et à la faveur d'un étrange concours de circonstances, la "mère intérimaire" trente ans auparavant.
Cette réapparition inopinée réactive, chez la narratrice, tout un pan enfoui du passé: il s'agit de quelques mois qu'elle passa à Berlin, dans les années quatre-vingt, quelques mois décisifs qui modifièrent à jamais le cours de son destin.
A l'époque, meurtrie par une rupture amoureuse et un avortement plus subi que choisi, elle s'était réfugiée dans la traduction de l'œuvre d'Elfriede Wolf, redoutable auteur germanique, et s’était saisie comme d’une aubaine de la bourse qui lui était offerte et qui lui permettait de vivre quelques temps à Berlin.
La narration alterne de longs passages consacrés à la remémoration et de brèves notations qui rendent compte du face à face, dans le présent, entre la narratrice et l'enfant devenu jeune homme. La jeune femme d'alors ressuscite de longues déambulations, des errances songeuses et moments suspendus dans un Berlin neigeux et ouaté, comme soustrait aux morsures du réel.
Au cours de cet hiver de gel, elle rencontre fortuitement Javier, un homme singulier qui parait être un pur produit du paysage environnant tant il est lui-même flou, feutré, décroché, absent à lui-même. Une relation insolite se tisse entre les deux jeunes gens qui n'est ni d'amour ni d'amitié ni non plus purement sexuelle. C'est une relation circonstancielle empreinte d'une grande douceur, d'une grande poésie et d'un mystère que les mots ne disent ni n'épuisent. Cette relation cependant se complique lorsque Javier rentre, un soir, serrant sous sa pelisse le minuscule corps de Valentin, l'enfant qu'il a eue d'une jeune fille tôt évaporée. Par la force des choses, la narratrice s'improvise donc mère substitutive et noue, avec cet enfant chu du ciel, des liens de plus en plus étroits. Car, à mesure que la jeune femme s'investit davantage dans son rôle de mère, Javier, lui, se fait de plus en plus évanescent. Le rapport vital devient donc celui qui unit la femme et l'enfant. Et c'est à cet amour d'une étrange nature que Valentin vient rendre, trente ans plus tard, un troublant hommage.
Un récit vibrant portée par une écriture ciselée et de haute tenue, empreinte, cependant, d'un singulier détachement et d'un caractère tamisé et cotonneux.
Comme si l'hiver berlinois d'alors s'était communiqué aux mots.
Une grande réussite, un charme persistant.
BH 06/15
"La fin de l'autre monde" de Filippo d'Angelo (Notabilia)
 C'est
un roman
plein
de fracas et
de fureur. Un récit au vitriol, corrosif au possible, traversé et comme
fortuitement troué par des bouffées de tendresse. Le héros, Ludovico,
est un
jeune et prometteur doctorant en littérature qui, à l'université
génoise,
exerce avec brio son esprit caustique, porté sur le paradoxe comme sur
les
déductions et ramifications improbables.
C'est
un roman
plein
de fracas et
de fureur. Un récit au vitriol, corrosif au possible, traversé et comme
fortuitement troué par des bouffées de tendresse. Le héros, Ludovico,
est un
jeune et prometteur doctorant en littérature qui, à l'université
génoise,
exerce avec brio son esprit caustique, porté sur le paradoxe comme sur
les
déductions et ramifications improbables.
Un beau jour, il débusque une version inédite de la fin de "L'autre Monde" écrit par Cyrano de Bergerac en 1657. La perspective de faire une découverte majeure aiguillonne Ludovico qui se lance dans une quête effrénée. Des rivalités et des conflits d'intérêt vont l'opposer, non seulement à un autre étudiant ambitieux et mordant, mais aussi à son directeur de thèse.
Ce qui, cependant, requiert au premier chef l'attention et l'énergie de Ludovico, ce sont ses tribulations amoureuses et érotiques. Tribulations qui se déclinent dégradent souvent en turpitudes sans nom.
Affichant un esprit libertin, désinvolte et goguenard, mais aussi un goût prononcé pour l'érotomanie, Ludovico navigue, au gré de ses recherches universitaires, entre Gênes, Paris et Moscou et entre les corps toujours sublimes, mais plus ou moins récalcitrants, de Marta, Flore, Sonja ou Vanya et Natasha. Marta est une jeune ingénue de vingt ans et l'amante officielle de Ludovico, Flore une jeune bourgeoise parisienne autrefois furieusement ferraillée mais qui désormais se dérobe aux assauts et sollicitations de notre héros. Sonja est une étudiante russe avec qui Ludovico entretient une intense relation de séduction. Quant à Natasha et Vanya, jumelles et russes elles aussi, elles pratiquent l'amour tarifé. A ce cheptel, s'ajoute Alice, objet de fantasmes inassouvis, et Véronica, ex furibarde qui bombarde Ludovico de mails incendiaires. Lequel Ludovico cultive un rapport à l'amour empreint de cynisme, d'amertume et de frustration. La seule qui soit, au moins partiellement, épargnée par les travers et traits acerbes de Ludovico est Umberta, sa jeune sœur (et accessoirement meilleure amie de Marta) avec qui il a développé un amour incestueux jamais consommé, particulièrement retors et néanmoins sincère.
Une déambulation à la fois effective et trépidante, mais aussi affective et symbolique, dans l'Italie berlusconienne dont l'auteur brosse une redoutable satire.
Un texte incisif , érudit, d'une étourdissante intelligence et dont la causticité est atténuée par des îlots d'émotion vraie, des parenthèses d'une insolite douceur.
BH 06/15
"Contre
la nature" de Thomas
Espedal (Actes Sud)
 C'est
un texte tissé
d'une trame fragile
et déchirable. Ce sont les carnets d'un homme, un écrivain, en pleine
déroute
amoureuse et existentielle.
C'est
un texte tissé
d'une trame fragile
et déchirable. Ce sont les carnets d'un homme, un écrivain, en pleine
déroute
amoureuse et existentielle.
Le livre débute par une évocation sensible et pénétrante de la passion qui unit Héloïse et Abélard. L'auteur évoque simultanément une rencontre amoureuse insituable, suspendue, entre un homme mûr et une très jeune fille lors d'un réveillon mémorable. La passerelle créée, le passage opéré, relèvent de l'évidence. Les épisodes restitués, réinventés, de la passion entre Héloïse et Abélard sont particulièrement sensuels et suggestifs. Et, comme en écho, les instants inauguraux de la passion entre le narrateur et la jeune fille, sont décrits, et même ciselés, avec une grande délicatesse.
Dans une seconde partie, l'auteur-narrateur ressuscite la relation houleuse, turbulente, qui l'attacha à sa première épouse. Le portrait de cette femme, ingouvernable, bouillonnante, d'une singularité extrême, et morte d'avoir voulu se conformer, est poignant.
Enfin, le troisième volet est la chronique, sur le vif, d'un virulent chagrin d'amour. L'auteur nous livre, brutes, les pages de ses carnets qui couvrent les semaines succédant le délaissement, la défection de l'aimée. Car il vient d'être quitté par la très jeune femme qui lui inspire un amour fou et qui l'abandonne au motif qu' "elle a d'autres choses à vivre". On est donc face aux cris perçants, à la souffrance nue d'un homme dont la vie se délite, dont le corps et l'âme se désagrègent à une vitesse sidérante. Cet homme foudroyé porte un regard rétrospectif sur l'histoire d'amour achevée et, il note, entre autres choses frappantes, que l'état de bonheur recouvre toute chose d'une fine pellicule anesthésiante.
Cette saisie sur le vif est d'une sincérité qui impressionne.
Un texte sans fard dont la candeur et la pureté émeuvent durablement.
BH
06/15
"Prises" de Stephan Enter (Actes Sud)
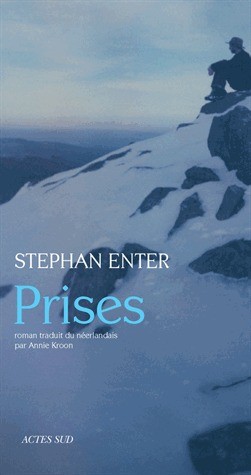 Voici
un récit qui
repose tout
entier sur des jeux de miroir et des phénomènes d'écho. Car les
protagonistes
n'existent que réverbérés les uns dans les autres et, surtout, dans la
confrontation avec eux-mêmes, avec celui ou celle qu'ils étaient vingt
ans
auparavant, quand ils avaient vingt ans. Car c'est essentiellement le
temps,
ici, en ses multiples déclinaisons et métamorphoses, qui doue les
personnages
d'épaisseur.
Voici
un récit qui
repose tout
entier sur des jeux de miroir et des phénomènes d'écho. Car les
protagonistes
n'existent que réverbérés les uns dans les autres et, surtout, dans la
confrontation avec eux-mêmes, avec celui ou celle qu'ils étaient vingt
ans
auparavant, quand ils avaient vingt ans. Car c'est essentiellement le
temps,
ici, en ses multiples déclinaisons et métamorphoses, qui doue les
personnages
d'épaisseur.
Il y a vingt ans, ils étaient quatre, trois garçons et une fille, réunis par leur passion commune pour l'alpinisme. Ensemble ils ont gravi, escaladé, éprouvé la beauté et l'effroi des montagnes. Il y avait Vincent, plein d'aplomb et de charisme, qui opposait aux autres une opacité troublante, Martin qui corsetait ses complexes et ses angoisses dans une régularité rigide, Paul, sensible aux nuances, complexe et délicat et enfin Lotte, entière, explosive, tranchante et pourtant secrètement fragile.
Ensemble ils se sont mesurés aux éléments, ont vécu des expériences fondatrices qui secrètement les soudent et les hantent. Vingt ans après, Martin et Lotte, qui se sont mariés et ont engendré une petite fille, ont acquis une maison au pays de Galles et ils y invitent Vincent et Paul pour honorer une promesse de jeunesse.
Vincent, venu de Tokyo et Paul, à partir de Bruxelles, effectuent le voyage ensemble. C'est Paul qui se charge de la narration dans la première partie laquelle épouse le rythme, les cahots, les secousses, les arrêts brusques et les accélérations du train. Simultanément, l'esprit subtil de Paul se déploie entre remémorations poignantes et notations aigües arrachées au présent. Passé et présent alternent fluidement, dans une prose limpide. Paul étudie, bien entendu, le cas de Vincent dont la présence est prégnante. Mais il apparaît très vite que c'était Lotte le point de convergence et le point névralgique du groupe. Lotte qui, avec ses embardées, ses reparties cinglantes, ses exaltations immesurées exerçait une fascination indéniable sur chacun des garçons. Lotte qui un jour fit une chute potentiellement fatale dont Paul - qui la sauva - fut le seul témoin. Or Lotte fit jurer à Paul de ne jamais rapporter l'incident aux autres. Et le récit est aussi construit autour de ce point aveugle, ce mystère jamais levé qui aimante les esprits.
Dans les volets suivants, C'est Martin, accompagné de sa petite fille et lancé (en voiture) vers ses anciens amis, qui endosse la narration, laquelle continue de livrer ses ramifications subtilement entrelacées. Et, dans un troisième temps, c'est la voix de Vincent qui se fait entendre cependant que le passé afflue et reflue par vagues successives.
Un
roman
psychologique d'une
grande finesse qui progresse au gré d'élancements poétiques et fait du
temps le
corps et la matière même du récit.
BH 05/15
"Ester ou la passion pure" de Lena Anderson (Autrement)
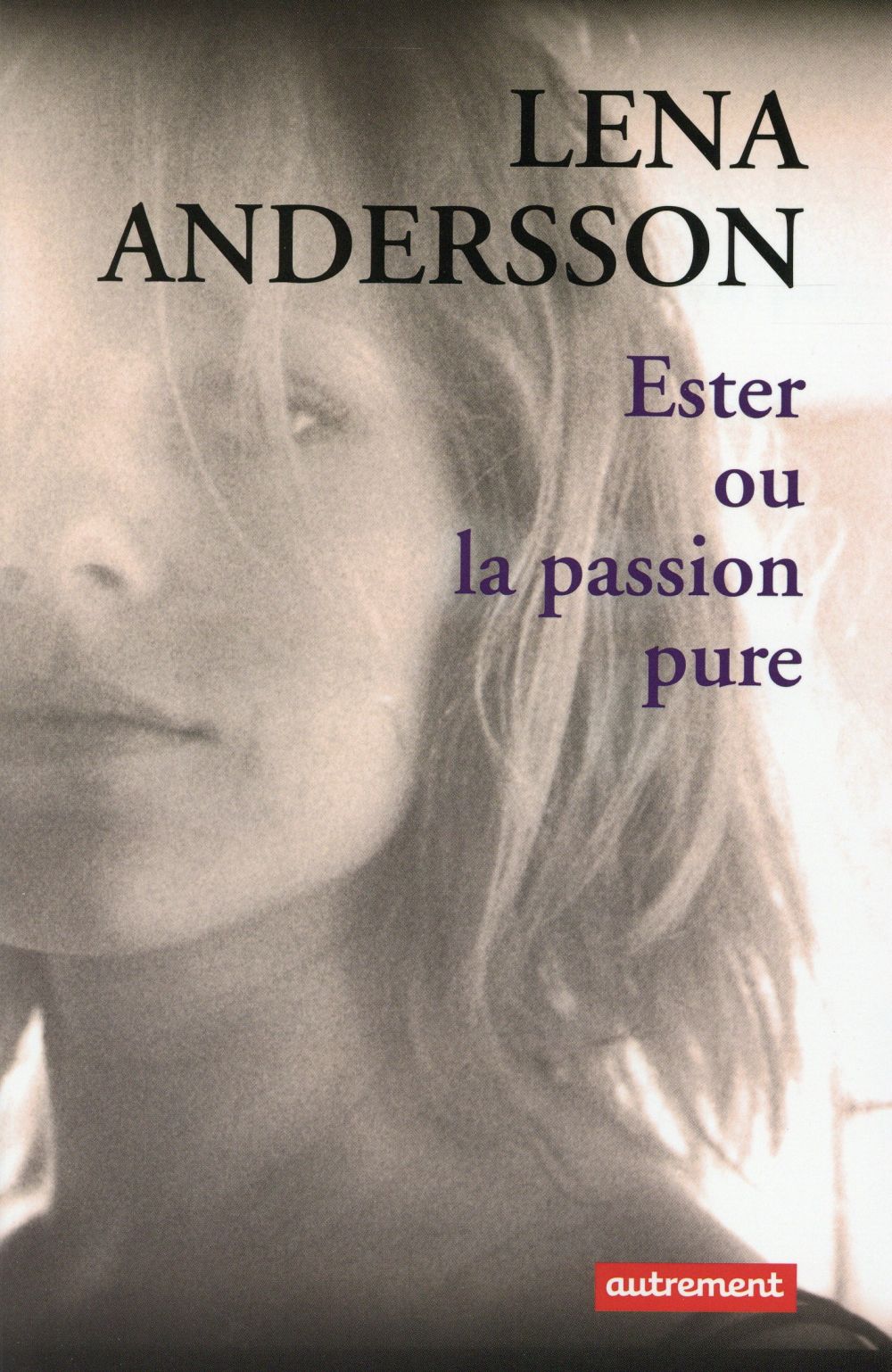 C'est
une tragédie
racinienne
scalpellisée, soumise au scanner, concassée dans des éprouvettes. C'est
Phèdre
quintessenciée, Andromaque réduite à l'os. C'est aussi "Adolphe" de
Benjamin Constant, c'est la désastreuse asymétrie amoureuse perçue
depuis la
lucarne d'Ellénore. C'est une expérience humaine universelle que
l'auteur a,
pour ainsi dire, menée en laboratoire pour en extraire le principe, les
axiomes
et postulats de base.
C'est
une tragédie
racinienne
scalpellisée, soumise au scanner, concassée dans des éprouvettes. C'est
Phèdre
quintessenciée, Andromaque réduite à l'os. C'est aussi "Adolphe" de
Benjamin Constant, c'est la désastreuse asymétrie amoureuse perçue
depuis la
lucarne d'Ellénore. C'est une expérience humaine universelle que
l'auteur a,
pour ainsi dire, menée en laboratoire pour en extraire le principe, les
axiomes
et postulats de base.
Soit, donc, Ester, jeune essayiste et poète suédoise. Femme supérieurement intelligente et exagérément cérébrale qui, un jour, décréta que sa vie serait tout entière subordonnée aux principes et diktats de la raison pure.
Jusqu'au jour où elle est chargée de rédiger une conférence sur l'œuvre d'Hugo Rask, artiste avant-gardiste en vogue. Contrainte de s'immerger dans l'œuvre, elle est bientôt subjuguée et cet envoûtement se décuple lorsqu'elle rencontre l'homme, éprouve la densité de sa présence, le charisme qu'il dégage. Aussitôt, Ester jette son dévolu sur Hugo, édicte qu'il est l'homme de sa vie et s'engage dans un processus qui la mènera à tout trancher et araser de sa vie antérieure. Sans consulter Hugo ni se soucier de savoir si ses sentiments sont partagés, elle rompt abruptement avec son compagnon, homme modéré avec qui elle entretenait une relation harmonieuse. Elle fonce tête baissée dans le mirage qu'elle a élaboré.
Mais, pour commencer, Ester est toujours seule alors qu'Hugo est toujours entouré d'une cour flagorneuse. Entre Ester et Hugo s'instaure une relation des plus retorses. Bien que très distant, Hugo adhère un temps, il entre dans la ronde, la parade amoureuse ou, du moins, séductrice. Mais même dans les débuts, il se montre étrangement peu empressé et très peu pressant. Cependant, il aime à être adulé, son ego boursouflé y trouve son compte. Ester finit, à l'issue d'une exténuante cour, par la circonvenir et par lui arracher trois nuits. A la suite de quoi elle s'imagine que l'homme est ferré et sien pour la vie. Or c'est alors qu'Hugo déploie un éventail étonnamment large d'atermoiements, tergiversations, stratégies d'évitement et manœuvres dilatoires. Car, en bon narcissique qui se respecte, il craint de perdre une adoratrice aussi inconditionnelle, un tel concentré de dévotion et jamais il n'aura le courage d'éconduire franchement celle qui lui est aussi agréable qu'importune et indésirable.
Quant à Ester, elle passe désormais son temps à bâtir, échafauder, surinterpréter le moindre signe, le moindre frémissement du bien-aimé. Elle carbure, turbine et gamberge à tout-va. Visée, cramponnée à son "mensonge vital", elle tourne à plein régime pour que ne s'effondrent pas les conditions de son enchantement. Elle n'est pas aveugle, loin de là, elle est même exceptionnellement lucide quant aux failles et travers d'Hugo. Mais, ce qui est fascinant, c'est que toutes ses facultés spéculatives si aiguisées, elle les emploie désormais non pour mettre au jour la vérité mais pour la distordre et la refaçonner conformément à ses vœux.
Ce processus pervers et toxique (mais si foncièrement humain) l'auteur l'ausculte et le transcrit avec une précision et une justesse aussi chirurgicales qu'éblouissantes.
Un précipité chimique analysé et mis en mots.
Une magistrale démonstration mathématique transposée dans le champ littéraire sur quoi se greffe une critique acerbe et féroce du milieu de l'art contemporain lequel sécrète des poisons et fabrique de factices objets de cultes. On est face à l’exécution sommaire d’un microcosme idolâtre, servile et veule.
Un précis de décomposition d'une force de percussion confondante (toutes les notations psychologiques sont d'une pertinence foudroyante). Une radioscopie exemplaire et corrosive de la passion unilatérale.
BH
04/15
"Ann" de
Fabrice
Guénier (Gallimard)
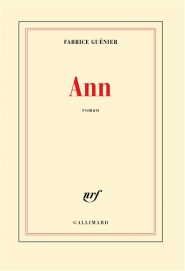 C'est un tombeau
vide. Comme si
l'écriture du récit opérait instantanément, et à mesure, l'acte de
résurrection. C'est un hommage déchirant à une amoureuse morte,
prématurément
ravie à son amant mais c'est aussi un texte incroyablement léger, ailé,
véloce
et tournoyant. C'est une expérience universelle mais dont les pointes
les plus
significatives et les angles les plus aigus vont se loger dans les
détails les
plus infimes, les plus singuliers, les plus insubstituables.
C'est un tombeau
vide. Comme si
l'écriture du récit opérait instantanément, et à mesure, l'acte de
résurrection. C'est un hommage déchirant à une amoureuse morte,
prématurément
ravie à son amant mais c'est aussi un texte incroyablement léger, ailé,
véloce
et tournoyant. C'est une expérience universelle mais dont les pointes
les plus
significatives et les angles les plus aigus vont se loger dans les
détails les
plus infimes, les plus singuliers, les plus insubstituables.
L'Eurydice que le narrateur éperdu tente d'arracher aux Enfers se prénomme Ann et c'est une jeune pute thaïlandaise subitement frappée par une tuberculose ravageuse.
Or le narrateur (lequel se confond bien entendu avec l'auteur) avait trouvé auprès de cette jeune femme, à cinquante ans passés, l'idéal, la quintessence esthétique et amoureuse qu'il avait vainement quêtés ailleurs sa vie durant.
"En la regardant de profil, penchée sur fond de mur gris-bleu, ses cheveux retombant devant ses yeux, cils baissés, je me disais que j'avais trouvé dans la vraie vie ce dont j'avais rêvé adolescent quand je dessinais."
"Ce n'était pas faire l'amour, il n'y avait qu'à être. Poupée qu'on manipule, tiède et docile, donnée, se donnant comme on en rêve, avec le sourire toujours, et ses yeux qui brillaient au centre de la nuit.
L'or de sa peau, frissonnante, parfumée, mystérieuse, étoilée de baisers - les lèvres, le front, le cou. Où aurais-je eu ça ailleurs ?
Sans autre temps que le temps présent. Sans s'être vus depuis des mois."
Notre homme développe donc pour Ann une passion qu'il qualifie lui-même de "délirante". Mais les puissances ne lui accordent que trois brèves années (de luxe, calme et volupté, véritablement) pour jouir de ce présent inespéré. Après quoi le joyau lui est arraché. Et la perte et le sort inique de cette jeune Ann lui arrachent ce cri :
"mon dieu, vous m'en avez donné une et il faut que vous me la repreniez"
"mon Dieu
aucune méchanceté ne peut rivaliser avec la vôtre mon Dieu j'aurais voulu enregistrer chaque conversation au téléphone
noter chacun de ses gestes
chacun de ses mots sa voix à pleurer pourquoi elle ?
laissez-la prenez-moi épargnez
attendez
que je la sauve"
C'est précisément ce qu'il s'emploie à faire dans ce récit qui consiste en un recensement maniaque, une notation minutieuse des gestes, paroles, attitudes d'Ann. L'homme foudroyé se livre à une traque obsessionnelle. Il consigne tout ce qui, d'Ann, peut être arraché à sa mémoire saignante. Il couvre tout le temps partagé, de la rencontre à l'agonie (longuement décrite).
Pour autant, ce texte n'a rien de lugubre. C'est comme si la grâce, l'enjouement, l'équanimité, la générosité, la légèreté rieuse qui caractérisaient Ann s'étaient communiqués à son amant.
Si bien que c'est avec une fraîcheur et une candeur confondante que le deuil se décline.
Et l'amour fou devient, sous la plume de Fabrice Guénier, au fil de ses phrases douces, tremblées, gracieuses et poignantes, la chose la plus simple et la plus belle qui soit.
BH 04/15
"Le pas du lynx" de Joana de Fréville (Les Allusifs)
 C'est
une histoire
simple. En
apparence. Un homme, une femme. Un peintre, une photographe. Entre eux,
via une
petite annonce, une alliance conclue, un étrange pacte contracté. Ils
conviennent de se retrouver tous les soirs pour danser ensemble et
seulement ça
: danser le tango sans rien se dire qui permette de les situer, les
agriffer, sans rien divulguer qui soit décisif et les assigne. Sans
rien éventer des secrets qui tissent leurs fibres. Tout juste
apprend-on
accidentellement (et parce que les fibres ne peuvent retenir cette
vérité
saignante) que la jeune femme a perdu un enfant, un fils de quatre ans
et, dans
la foulée, Svörg son homme éperdument aimé. De l’homme, on ne saura que
son
regard « Beckett », giclée glaciaire et brûlante,
décharge
azuréenne
radioactive. Et aussi, mais bien plus tard, au fil du temps décrypté,
que son
corps sinistré est au bord de le lâcher.
C'est
une histoire
simple. En
apparence. Un homme, une femme. Un peintre, une photographe. Entre eux,
via une
petite annonce, une alliance conclue, un étrange pacte contracté. Ils
conviennent de se retrouver tous les soirs pour danser ensemble et
seulement ça
: danser le tango sans rien se dire qui permette de les situer, les
agriffer, sans rien divulguer qui soit décisif et les assigne. Sans
rien éventer des secrets qui tissent leurs fibres. Tout juste
apprend-on
accidentellement (et parce que les fibres ne peuvent retenir cette
vérité
saignante) que la jeune femme a perdu un enfant, un fils de quatre ans
et, dans
la foulée, Svörg son homme éperdument aimé. De l’homme, on ne saura que
son
regard « Beckett », giclée glaciaire et brûlante,
décharge
azuréenne
radioactive. Et aussi, mais bien plus tard, au fil du temps décrypté,
que son
corps sinistré est au bord de le lâcher.
Pour le reste, les deux corps s'approchent, s'apprennent, se déchiffrent et se descellent à travers la danse qui, percussions, frottements, voltes, frictions, cabrades, figures déclinées à l'infini, livre autrement et infiniment plus que les mots plaqués, rivés à leur sens contractuel et indigent.
Dès lors, tout le texte consiste en une auscultation minutieuse, une décomposition maniaque des sensations et gestes les plus infimes. Et on assiste à des déclinaisons charnelles aussi insolites que fascinantes. Deux écorchés s'entrechoquent et s'apprivoisent à travers des gestes qui ne sont pas ceux du désir et de l'amour mais qui n'en sont pas éloignés non plus. Ce sont des gestes de réparation, d'accueil, de réconciliation. Et autre chose encore, que les mots ne sauraient ni épingler ni épuiser.
Cette
expérience,
intense,
singulière et captivante, est restituée à travers les voltes et volutes
d'une
langue infiniment sensuellement et ciselée. Chaque phrase est lustrée,
orfévrée
jusqu'à ce qu'elle délivre son plein éclat. Jusqu'à ce que les
cadences, salves
et saccades des corps passent dans le corps de la langue fouaillée et
retournée
toute.
BH
04/15
"D'argile
et de feu"
d'Océane Madeleine (Editions
des Busclats)
 C'est une
trajectoire en forme de
ligne ascendante et de percée profonde. C'est une fuite qui se mue en
reconquête, en réappropriation de soi.
C'est une
trajectoire en forme de
ligne ascendante et de percée profonde. C'est une fuite qui se mue en
reconquête, en réappropriation de soi.
C'est l'histoire d'une jeune femme déshabitée qui revient à elle-même au travers de la marche, d'une rencontre fortuite, corporelle, décisive, et d'une autre rencontre, incorporelle, celle-là, mais non moins incarnée et décisive.
Le récit débute par une rupture radicale. La narratrice quitte. Un lieu, un homme, un métier. Tout ce qui constituait ses repères et ses fondements. Elle fait table rase d'un passé qui ne concorde plus avec ce qu'elle est en train de devenir. Elle s'éprouve, se façonne, se définit par la marche qui l'aiguise et la dépouille. Par le feu qui l'anime, par la combustion interne qui la modifie à mesure.
Puis elle rencontre un géomètre vivant et une céramiste morte qui, chacun à sa manière, la modèlent et la guident.
Cette histoire est d'abord celle de deux femmes, pareillement prénommées Marie, qui se correspondent et se répondent en se jouant des limites spatiales et temporelles. Deux femmes et deux cahiers : un blanc dans lequel la narratrice consigne ses impressions, ses avancées, et un rouge qui relate l'existence de Marie Prat, céramiste intrépide qui marqua de son empreinte le XIXème siècle.
Le texte est constitué de l'alternance des deux cahiers et de leurs résonances et réseaux de correspondances. Les phénomènes d'écho se font de plus en plus troublants car la narratrice se nourrit et s'accroît, chemin faisant, du parcours de la potière qui fut, elle aussi, une femme de ruptures et une figure de haute liberté. La narratrice qui d'abord fuit, s'enfonce dans la forêt, dans l'humus originel et se terre dans une cabane de fortune, se délie peu à peu sous l'égide de Marie Prat et à la faveur de sa rencontre improbable avec l'homme qu'elle nomme "le géomètre".
Entre la narratrice et le géomètre se tisse une relation âpre et délicate, sensible et rugueuse, souverainement libre et au cœur de laquelle rayonne un désir intense mais sans appropriation. La narratrice nous fait donc témoins de ces apprentissages multiples, menés sur tous les fronts, dans tous les registres.
Et les expériences successives sont restituées dans une langue abrasive et cravacheuse mais une langue qui est, dans le même temps, terriblement sensuelle, chatoyante et suggestive.
Un grand petit livre.
BH
03/15
"Monologue
de la boue" de
Colette Mazabrard
(Verdier)
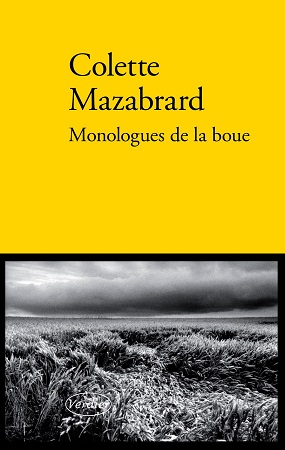 C'est
un récit qu'on
pourrait
croire de baguenaude et de maraude. Une déambulation à la fois rêveuse
et
observatrice qui pourrait ne revêtir qu'un caractère ludique. Mais il
s'agit
aussi d'un périple exploratoire, d'une quête passionnée et secrètement
suppliciée menée sur fond d’insatiable curiosité d'autrui.
C'est
un récit qu'on
pourrait
croire de baguenaude et de maraude. Une déambulation à la fois rêveuse
et
observatrice qui pourrait ne revêtir qu'un caractère ludique. Mais il
s'agit
aussi d'un périple exploratoire, d'une quête passionnée et secrètement
suppliciée menée sur fond d’insatiable curiosité d'autrui.
C'est une femme enclose dans une aride solitude mais qui est, simultanément, expulsée de cette solitude par des rencontres fortuites et par ce qui, incessamment, requiert son attention.
C'est une femme qui, pour mieux se scruter, s'écarquiller, se projette dans la deuxième personne du singulier. Mais ses trouvailles, sa diffusion, son rayonnement sont très largement pluriels. Elle remonte vers le Nord de quelque chose en elle, elle effectue un relevé typographique sensible et frémissant.
Elle trace une trajectoire qui ne va pas exactement du Nord au Sud mais qui bifurque, d'oblique en oblique. C'est un parcours qui semble se dessiner arbitrairement mais répond à une nécessité et à des lois intimes. Notre narratrice se porte donc du Pas de Calais à la Belgique, du Nord au centre de la France, des Ardennes à la Suisse et, enfin, dans l'Espagne des pèlerins fervents, sur la route de Saint Jacques de Compostelle.
Chemin faisant, elle prélève une myriade de sensations qui frappent par leur singularité et par l'acuité de la vision. Mais elle chronique et pétrit aussi secrètement la glaise humaine qui lui échoit. Elle détecte instantanément, chez les inconnus croisés et brièvement côtoyés, ce qui fait leur prix et leur beauté passée sous silence. Avec une rare sensibilité (et une grandeur d'âme certaine), elle élève ces passants au rang d'identités remarquables.
Il est aussi question d’une rupture, d’une séparation dont elle veut se dégager, qu’elle s’emploie à arracher au fil des kilomètres avalés, de la route brûlée comme poussière sous ses pas.
Elle métabolise la distance et le chagrin. Elle se fait géomètre et arpenteur de sa propre vie mais elle quadrille surtout le rien, elle se laisse traverser par le vide, la solitude et l’infinie gratuité qui s’offre à elle.
Réduite à son corps qui ne triche pas, aux sensations qui ne peuvent se fausser, cette femme trace une ligne de fuite et d’épure qui l’ancre au point névralgique et central. Se jetant aux quatre points, elle se ressaisit du cœur cardinal. Images et perceptions affluent par saccades mitraillées et vibrants instantanés.
La langue est pelée, abrasive, râpeuse et infiniment suggestive. La femme qui marche se remplit du monde et, au fil du temps et des espaces parcourus, se déleste et se ressaisit d’elle-même.
Le texte, bien que foisonnant, est pareillement dépouillé et le décapage opéré est de toute beauté.
BH 02/15
"Les hommes n'appartiennent pas au ciel" de Nuno Camarneiro (Lattès)
 C'est
un texte qui fait
entendre
trois voix distinctes, alternées. Trois voix qui disent l'étrangeté
d'être au
monde quand on porte sur ledit monde un regard sans filtre, un regard
altéré
par nul conditionnement.
C'est
un texte qui fait
entendre
trois voix distinctes, alternées. Trois voix qui disent l'étrangeté
d'être au
monde quand on porte sur ledit monde un regard sans filtre, un regard
altéré
par nul conditionnement.
Trois personnages, trois lieux, trois destins simultanés. Unis sous la voûte céleste et par le passage de deux comètes en 1910.
Il y a Karl, jeune immigré qui nettoie les vitres des gratte-ciels de New York et qui est doué ou affligé d'une sensibilité convulsive.
Il y a Fernando, rêveur décroché et visionnaire, qui erre douloureusement dans Lisbonne.
Il y a Jorge, enfin, jeune garçon livré à son hyperbolique imagination, qui édifie d'ébouriffants mondes parallèles.
Chacun de ces personnages éprouve douloureusement son altérité dans un monde pour lequel ils sont peu outillés et qui, en retour, est peu disposé à les accueillir tels quels.
Karl devenu, en raison de ses troubles, inapte à laver les vitres, pactise avec le tenancier d'une maison close et s'initie à un univers qui le sidère, le laisse pantois, mais s'avère, in fine, d'une douceur aussi insolite qu'inattendue.
Fernando, confiné chez l'une de ses tantes, cherche dans les mots la formule de vivre.
Quant à Jorge, il s'essaie, avant de trouver sa voie véritable, à divers jeux expérimentés en compagnie de sa sœur, des jeux qui agissent comme des passes magnétiques.
Pour ces trois-là, sous le signe fortuit de la comète, la vie est trop blessante et elle ne suffit pas.
Jorge la multiplie, l'étire et l'élargit en l'écrivant. En faisant de ses heures des épopées et de ses proches les héros bancals et erratiques d'une fracassante aventure.
C'est à travers des poèmes que Fernando, le voyant et l'hyperesthésique, prolonge et compense la vie.
Quant à Karl, c'est au cœur du bordel (dans toutes les acceptions du terme) orchestré par son ami Thomas, qu'il va, dans l'amour fou pour la catin Celestina, s'arracher à lui-même.
Ces trois vies convergent dans la soif incoercible et non négociable d'absolu.
La langue prêtée aux personnages, sans cesse novatrice et percutante, est d'une poésie frappante.
Et
ce récit, d'un
éclat très pur
et d'une fraicheur confondante en ces temps rassis, est un précis (et
un
précipité) à l'usage de ceux qui croient encore en la course des nuages
et aux
pouvoirs de la création.
BH 12/14